Dossier : Ingres
Jean Auguste Dominique Ingres
Né à Montauban le 29 août 1780 et décédé à Paris le 14 janvier 1867, Ingres fait l’admiration constante de Gautier. Il le mentionne très régulièrement dans sa critique d’art, et lui consacre notamment une étude dans L’Artiste du 5 avril 1857. Pour Gautier, Ingres est l’un des plus grands artistes de son temps, tout dévoué à la quête du beau et qui ne se laisse pas emprisonner dans une école. De manière désormais classique, Gautier met Ingres en face de Delacroix, chacun représentant une tendance forte de la peinture de son temps.
Une lettre d’Ingres à Gautier, reprise dans la Correspondance générale éditée par C. Lacoste (t.1, 1985, p.277), indique la réciprocité de l’amitié de Gautier pour le peintre :
Monsieur,
Permettez-moi de vous offrir ce livre comme un témoignage de ma haute estime.
J’ose espérer qu’il trouvera près de vous l’accueil bienveillant dont vous avez toujours honoré mes oeuvres.
Agréez l’assurance de ma considération la plus distinguée.
J. Ingres
saut
Textes de Gautier
Textes collectés et transcrits par Carine Dreuilhe dans le cadre d’un mémoire de D.E.A (septembre 2000).
Principes d’édition : l’orthographe d’époque a été respectée (notamment les finales en –ans et –ens là où nous écrivons aujourd’hui –ants et –ents), les graphies : poëme, poëte, entr’ouvert etc.
Ont été rectifiées d’office les coquilles évidentes. L’emploi de l’italique pour les titres a été systématisé.
La France littéraire, » Salon de 1833 « , mars 1833
À M. Ingres les honneurs du pas. – M. Ingres en est digne sous tous les rapports ; il a une fermeté de conviction malheureusement trop rare aujourd’hui. Ayant vu, dès son début, que le dessin était bon, il s’y est attaché par-dessus toute chose, et il a marché droitement et sincèrement dans sa voie, sans s’inquiéter du succès, et cherchant à se contenter lui-même plutôt que les autres. Il a fait l’Odalisque, il a fait Roger et Angélique, et le Vœu de Louis XIII, et l’Œdipe devinant le Sphinx, et cela a dû paraître singulièrement mauvais à des gens qui admiraient du fond de leur cœur MM. Abel de Pujol, Couder, Blondel, Meynier et compagnie. En effet, ce fut un feu roulant de plaisanteries très ingénieuses ; on cria à la barbarie ; on dit que c’était vouloir retourner à l’enfance de l’art, et mille autres belles choses de ce genre. – Les bonnes perruques ne se doutaient guère que bafouer M. Ingres, c’était bafouer Albert Dürer, Raphaël, Holbein, et autres barbares de cette force. M. Ingres persista. La foule voyant qu’il n’allait pas à elle, vint à lui : la foule est comme les femmes. Aujourd’hui, M. Ingres est sur le piédestal qu’il s’est si laborieusement construit. – Il est devenu un mythe ; c’est la personnification du dessin, comme Decamps est celle de la couleur.
M. Ingres n’a au salon que deux portraits, celui de Bertin de Vaux et celui d’une dame romaine peinte en 1807 ( au commencement de la galerie, à droite ) : c’est peu ; mais, n’eût-il jamais fait que cela dans sa vie, ce serait assez, à mes yeux, pour le proclamer grand-maître. – Parlons d’abord de la dame romaine ; c’est, selon moi, la plus belle chose du Musée, et je la met beaucoup au dessus du portrait d’homme. Elle a une robe de velours noir, à taille courte, d’après la mode de l’Empire, très décolletée ; un schall de couleur claire est drapé sur son épaule gauche avec un style et une élégance inimitables ; ses deux mains, posées l’une sur l’autre, sont rendues de la manière la plus candide. La charmante créature regarde devant elle avec cette bonhomie et cette sérénité particulière aux Italiennes. La bouche fine et mince, comme une bouche d’Holbein, rit de ce sourire doux et sérieux inconnu en France ; les yeux, admirablement enchâssés, sont d’une transparence et d’une limpidité sans exemple ; toute la tête vit et remue, et cela sans le prestige de la couleur, avec un simple ton local, habilement gradué selon les formes et le mouvement, que nous préférons beaucoup, pour notre part, au tricot prismatique dont l’école de Gros revêt ses personnages, et qui nous semble incontestablement plus vrai et plus agréable à l’œil. Il y a dans ce portrait une telle sainteté de lignes, une telle religion de la forme dans les moindres détails, le faire en est si primitif, que l’on a toutes les peines du monde à croire que cela ait été peint en plein règne de David, il y a quelques vingt ans. N’était la coupe des vêtemens, on pourrait croire ce tableau de la même main que la Marguerite d’Alençon. Le portrait de Bertin, malgré ses incontestables qualités, n’est pas aussi magistral ; le parti pris n’est pas, à beaucoup près, si franc : le peintre a plus visé au relief, et par cette raison même n’a pas produit quelque chose d’aussi complet. Au reste, le linéament des mains est d’une pureté rare, la pose vraie et vivante ; les vêtemens sont sévères, sans lazzis, comme tout ce que fait M. Ingres ; seulement, on regrette en voyant ce dessin si irréprochable, qu’il ne soit pas appliqué à un tout autre sujet. Tant de pureté et d’exactitude dans un pli de gilet et de redingote, qui pouvait être autrement sans cesser d’être vrai, nous paraissent dépensés en pure perte. M. Ingres ne devrait faire que des sujets nus, ou, tout au moins, antiques. — Les madones et les tableaux de sainteté lui iraient encore admirablement bien, à cause de leur gravité symétrique ; mais, en vérité, nos pauvres physionomies et nos misérables haillons sont indignes qu’un aussi grand peintre les immortalise. Ce que je dis là paraîtra clair à ceux qui, au risque d’un torticolis, auront vu et admiré l’Apothéose d’Homère dans le Musée Charles X.
La France Industrielle, » Salon de 1834 « , avril 1834
Pour le Saint-Symphorien de M. Ingres, c’est la plus belle fresque, le plus magnifique carton qu’il soit possible de voir. Quelques journaux ont dit que c’était un pas rétrograde, n’écoutez pas les journaux ; c’est un pas en avant. C’est la logique de la manière de M. Ingres, poussée jusqu’à la dernière conséquence. On a dit que M. Ingres imitait servilement Raphaël, et se traînait comme un écolier dans l’ornière ouverte par le divin jeune homme. Nous ne sommes pas de cet avis ; le sentiment de M. Ingres est bien plus allemand qu’italien. Albert Dürer est plutôt son patron que Raphaël. Les têtes de M. Ingres sont bien moins idéales que celle du Sanzio ; c’est une traduction de la nature beaucoup plus mot à mot : son dessin serre la forme de plus près ; et le caractère de son style est l’exagération dans un principe vrai des détails extérieurs, car M. Ingres soigne principalement le silhouette linéaire de ses personnages, et dessine plus sur le bord que dans le milieu : procédé qui, ôtant beaucoup de relief, a pour résultat un aspect large et simple tout à fait magistral, et qui ferait distinguer au premier coup d’œil le tableau entre mille. Un peintre de l’école angélique eût seul pu dessiner la tête du saint Symphorien. Le sentiment catholique qu’elle respire est admirable. On prétend que le tableau est d’une vilaine couleur. Nous ne nous sommes pas aperçu qu’il fût d’une couleur plutôt que d’une autre.
Le portrait de femme ne vaut pas à beaucoup près le portrait de la Romaine, la couleur est lumineuse, les mains parfaitement belles, l’ajustement du plus grand goût, les vêtemens exécutés d’une manière supérieure, — le modèle fin et savant, mais le modèle est moins heureusement choisi.
saut
Figaro, » Des beaux-arts et autres « , 16 octobre 1836
Nous n’avons pas encore dit notre mot sur l’art. Parlerons-nous de l’art ? Qui n’en parle pas ? Quel journal n’a pas son feuilleton d’art, spécialité régulière, qui devient deux mois de l’année, les deux mois du salon, un compte rendu fidèle, une analyse pareille à celles qu’on fait des ouvrages dramatiques, un feuilleton redoutable, entouré des sollicitations, des inimitiés, des terreurs et des dangers qui s’attaquent habituellement à la critique théâtrale ; les autres dix mois de l’année, le rédacteur d’art remplit ses colonnes à sa fantaisie ; il se lance dans de hautes considérations d’esthétique et de plastique qui impriment à l’abonné un grand respect pour l’auteur, et un plus grand pour ses articles, dans lesquels il ne se permet pas de pénétrer.
À vrai dire, l’art n’existe plus que dans ces feuilletons qui ont à remplir un nombre déterminé de colonnes par mois, et dans le cerveau de quelques grands génies isolés de la foule. L’état et le public s’en inquiètent médiocrement, et trouvent toujours qu’il s’en fait assez pour leur consommation. Pour l’état, la protection accordée aux beaux-arts est une vieille idée, une tradition morale qui se perd tous les jours avec tant d’autres. On voudrait bien être le grand siècle ; on ne demanderait pas mieux que d’être Louis XIV, si cela ne coûtait pas trop cher ; l’art est un luxe tout royal, il faut de cela avec un peu de gloire militaire, et de la poule au pot, pour composer les élémens d’un règne convenable ; mais on marchande tant qu’on peut, c’est tout naturel, et une nation de marchands et d’industriels comprend cela le mieux du monde. Du côté du public, l’art trouve encore moins d’aide et de protection, la société bourgeoise d’aujourd’hui lui est hostile quoi qu’il fasse ; il ne peut ni s’y introduire, ni s’y emboîter ; sans cesse elle le rejette à sa surface où il adhère ensuite plus ou moins. L’art ancien dit le public hostile à l’art nouveau ; l’art nouveau à l’ancien : le public est neutre, c’est-à-dire indifférent. Il considère peu les sculptures du moyen-âge, mais il n’a guère de sympathie pour les nudités classiques, et comme père de famille, il les blâme. Il ne tient guère à la peinture que par le portrait, mais il laisse à droite M. Gros, et M. Ingres à gauche ; il va droit à M. Dubufe, parce qu’il a remarqué que c’est l’artiste qui emploie la couleur la plus fine.
Contemplez l’illustre abaissement de l’art académique autrefois si fier, aujourd’hui misérable et menacé ; voyez comme il se traîne aux pieds du public, comme il se rapetisse, s’ébarbe, s’unit et s’utilise pour son usage. Il lui offre ses urnes, ses statues et ses bas-reliefs au prix du moulage, ses tableaux au prix des devans de cheminée ; il lui peindrait ses plafonds au rabais du badigeonneur. Il lui présente ses colonnes, les blanches filles de Grèce, coiffées de palmes et d’acantes ! Le bourgeois honore la colonne, mais il ne s’en sert pas ; des colonnes à sa maison lui semblent aussi inutiles que des béquilles à un ingambe. Du reste, son to kalon architectural se définit ainsi : tout ce qui est symétrique, blanc et nu ; et son grandiose, tout ce qui est très grand. Partez de ces deux points. La sculpture se trouve, il est vrai, représentée chez lui par la pendule à sujet, les ornemens estampés et les moulures en mastic : mais la peinture tient moins de place encore. La peinture est morte aujourd’hui ; elle est tombée de fresque en trumeau ; de tableau en gouache ; elle s’est faite si petite, qu’on l’a enterrée dans un album. Et l’album, c’est l’aumône que fait au riche l’artiste mourant de faim ; l’album se paie avec une lettre de bal, une poignée de main et un sourire. On dit que l’imprimerie a tué pour jamais l’architecture.
Hé bien ! c’est la même histoire : la glace a tué le tableau ; la glace, inconnue autrefois, a pris au tableau sa place au mur et son cadre doré ; le bourgeois aisé s’achète une glace tout d’abord ; qu’il s’arrondisse, et il en aura deux ; qu’il s’enrichisse, et la peinture n’y gagnera rien ; il achètera des glaces ; il mettra des glaces partout ; parce que c’est utile et beau, parce qu’il y voit tout ce qu’il a multiplié.
Pour qui donc se fait-il encore de la peinture ? est-ce pour MM. Demidoff, Seymour et Schikler seulement, qu’on produit au Musée trois mille tableaux par année ? Je demande où passent tous ces milliards d’aunes de toile qui servent tous les ans à nous fatiguer l’odorat, les yeux et les oreilles, et qu’on ne revoit plus jamais, ni dans les galeries, ni dans les salons, ni sur les enseignes ; que veut tout ce peuple barbu, qui se fait bâtir sans cesse d’innombrables ateliers dans la nouvelle Athènes et derrière le Luxembourg ? Comment se nourrit-il ? Mange-t-il ses productions en nature ? s’habille-t-il avec la toile ? C’est une grave question.
saut
La Presse, « De la composition en peinture », 22 novembre 1836
L’on a dans le monde les plus étranges idées sur la peinture.
Nous ne parlons pas ici des honnêtes bourgeois qui veulent des tableaux sans ombre et sans perspective, à la manière chinoise ;
Ni des amateurs délicats qui s’étonnent que l’on ne traite pas les cheveux un à un ;
Ni des femmes charmantes qui demandent que l’on épuise sur leur teint les roses et les lis ;
Ni des cuisinières abominables et des sapeurs-pompiers assortis, qui réclament pour leur argent de la couleur de chair plus fine ;
Mais bien des connaisseurs, d’un goût en apparence plus irréprochable et plus attique ; des critiques experts et assermentés près les journaux ; des littérateurs à dissertations, des nébuleux professeurs d’esthétique transcendantale, des femmes sensibles et impressionnables parvenues à un grand âge, de certains artistes plus ou moins rasés, et de tous ceux qui ont copié en pension des têtes de Lemirre, et qui se sont distingués en reproduisant, d’après la bosse, le nez majestueux de Jupiter-Olympien.
Tous ces braves gens déraisonnent à l’endroit de la peinture de la manière la plus impertinente du monde ; on croirait vraiment, à les entendre, qu’ils parlent musique.
La peinture a ce malheur, que quiconque jouit d’une paire d’yeux ou d’un binocle en place d’yeux, se croit en droit de la juger, et se regarde comme très compétent.
Rien n’est plus faux.
Il ne suffit pas plus de voir, pour se connaître en peinture, qu’il ne suffit d’entendre pour se connaître en musique.
— Certainement, des aveugles et des sourds ne peuvent parler ni de peinture ni de musique ; mais beaucoup ont des yeux plus grands que ceux de Junon Boopis, et des oreilles plus longues que celles de Midas, qui n’en voyent pas plus et n’entendent pas mieux pour cela : Oculos habent et non vident, aures habent et non audirent. — L’Évangile faisait sans doute allusion aux feuilletonistes de peinture et de musique.
Ceci a presque l’air d’un paradoxe ; mais il est très sûr que sur vingt personnes qui passent devant un tableau, il y en a dix-neuf qui ne le voient point. Il faut une longue étude pour apprendre à voir. Voir, c’est la moitié du génie : les grands peintres et les grands poètes sont tout bonnement des gens qui ont le coup-d’œil juste, et qui discernent instinctivement la forme de la nature dans les proportions les plus exquises. — Des gens de beaucoup d’esprit, du reste, forgent des descriptions ou des dessins absurdes, en présence des objets même qu’ils ont à rendre ; ils ne les ont pas vus. La routine ou l’éducation étendent sur leurs prunelles une taie épaisse ; ils se sont donnés un mal infini, et deux ou trois linéaments, quelques phrases fort simples qu’il semble impossible de ne pas rencontrer, eussent produit le plus excellent effet.
C’est ainsi que de vieilles réputations académiques trouvent moyen, avec un modèle nègre sur la table, de faire une Flore lutinée par Zéphire, et dessinent très bien un casque d’après un bonnet de coton.
Le spectacle de la nature est perdu pour ces hommes-là ; l’aspect des choses leur échappe, ils n’ont pas d’œil.
Il faut une longue et patiente étude pour apprendre à y voir, il faut une attention continuelle, un grand travail de comparaison, une persévérance d’observation qu’il n’est pas donné à tout le monde d’atteindre ; là où l’homme inexercé, le bourgeois ( qu’on me permette d’employer ce terme de l’argot d’atelier ) n’aperçoit qu’une seule teinte, l’artiste en découvre cinquante ; il suit jusqu’au bout des gammes de tons variés qui ne paraissent aux bourgeois qu’un tapage assourdissant de couleur ; certaines inflexions de lignes inappréciables pour tout autre, lui causent d’inexprimables ravissements ; il a toutes sortes de bonnes fortunes de détails, il pénètre dans mille petites beautés intérieures dont il a la possession exclusive ; il jouit de la beauté intime du tableau, le bourgeois n’apprécie que le cadre et le vernis.
La beauté a plus de voiles qu’Isis ; elle ne se présente pas tout d’abord et dans tout son éclat ; elle a ses heures d’éclipse et de défaillance ; son rayonnement n’est pas toujours aussi intense. Un amant discret et persévérant ne se rebute pas pour cela ; il sait attendre, il est là patiemment assis, le crayon à la main : le nuage se déchire, le rayon tombe, le profil se découpe, le front s’illumine, la beauté se révèle, mais aux initiés et aux adeptes seulement, l’homme vulgaire qui était peut-être présent ne s’est douté de rien.
Cette grossièreté générale du sens de la vue, et ce manque de finesse dans l’appréciation de la beauté de la forme, est cause d’une singulière aberration dans le jugement des œuvres d’art.
Les tableaux sont analysés, jugés et critiqués comme des livres ou des drames : on y veut un sujet, une anecdote, un espèce de mélodrame peint, qui est bien la plus insupportable chose du monde après le mélodrame écrit. Faute de pouvoir juger de la composition des formes et des lignes, on y demande une composition littéraire, et Dieu le sait, il n’y a rien de plus opposé sur la terre et au ciel que les vrais principes de la composition pittoresque et ceux de la composition poétique. Les littérateurs, en dépit du demi-vers d’Horace, sont de fort mauvais peintres, et les peintres seraient, je l’espère, de non moins exécrables littérateurs.
Ceci explique pourquoi M. Paul Delaroche, qui représente assez bien M. Casimir Delavigne comme valeur actuelle, a été généralement pris pour un peintre, ce qu’il n’a jamais été et ne sera jamais.
M. Paul Delaroche aurait fait les Messéniennes, si elles n’avaient pas été faites depuis longtemps ; M. Casimir Delavigne eût sans doute peint la Jane Grey : cette fraternité est si bien comprise de tous deux, que, dès que l’un a versifié un tableau, l’autre peint une tragédie sur le sujet de ce tableau, et réciproquement, ce qui est assez vous dire que ce n’est ni de la peinture ni de la poésie.
Tous les deux auraient peut-être été des vaudevillistes supportables.
Certainement l’éducation pittoresque d’un peuple capable de regarder M. Delaroche comme une gloire dont les rayons se confondaient avec l’auréole des plus divins maîtres, est entièrement à refaire.
Qu’on oublie pas que M. Ingres, qui avait fait l’Odalisque, l’Œdipe, le Vœu de Louis XIII, Angélique et Roger, M. Ingres, ce grand maître du seizième siècle, sur l’épaule de qui le doux Raphaël eût posé amicalement sa blanche main ; M. Ingres qui, dans son portrait de la Jeune Romaine, a créé le plus beau visage de femme que l’art ait réalisé depuis la Monna Lisa et la Jeanne d’Aragon, est demeuré inconnu et méprisé jusqu’à l’âge de cinquante ans précisément à l’époque où l’astre de M. Paul Delaroche se levait glorieusement à l’horizon.
La Presse, » Beaux-arts — ouverture du Salon « , 1er mars 1837
Voici que les portes du Salon vont s’ouvrir encore une fois. — L’inquiétude est grande au camp des artistes qui n’ont, dans l’année, que cette seule entrevue avec le public ; la curiosité est vivement allumée chez les bourgeois et les amateurs. Va-t-il s’élever de nouveaux astres sur ce ciel de toile verte, qui dérobe pendant trois mois la vue des tableaux des anciennes écoles ; les glorieux soleils reconnus du feuilleton auront-ils quelque éclipse à souffrir ? qui obtiendra la vogue ? Quelle toile est destinée à faire fureur ; car, nous autres Français, nous avons une si faible dose d’enthousiasme qu’un seul objet suffit pour l’épuiser, et que nous ne pouvons admirer plus d’un poète ou d’un peintre à la fois. Sera-ce, comme à l’ordinaire, M. Paul Delaroche, dont le talent sobre et prudent va si bien à la foule ennemie de toute témérité, qui se prélassera encore dans ce bienheureux coin destiné aux hommes en réputation et aux enfants gâtés de l’administration du Musée. — Nous verrons cela dans quelques heures aujourd’hui.
Sans doute les critiques, selon leur louable habitude, ne manqueront pas de dire que le salon de l’année précédente valait mieux que celui-ci ; c’est une chose convenue, et dont on nous permettra de douter comme de toute chose convenue. Il y a longtemps que les hommes et les salons dégénèrent, et que tout va de mal en pis, comme on peut le voir dans Homère et dans Horace. Heureusement que quelques exclamations imprudentes nous ont mis en état de juger la valeur de toutes ces gloires acceptées il y a dix ans ; et quoique nous ne soyons pas partisans du progrès indéfini, nous croyons qu’il y a eu amélioration dans toutes les parties de l’art.
Le coloris a été l’objet d’études sérieuses ; Paul Véronèse, Titien, le Tintoret, Giorgione, tous les grands Vénitiens ont été copiés, consultés, analysés, soulevés couche par couche ; des tons chauds et dorés, des teintes d’une solidité inconnue dans l’école française, ont enrichi la palette de nos jeunes peintres, et malgré la lourde atmosphère de notre climat sans azur et sans soleil, quelques-uns sont arrivés à l’ardeur éblouissante des maîtres italiens. Les Flamands n’ont pas été négligés non plus ; les furieuses peintures de Pierre-Paul Rubens et de Jordaens ont poudré de leur robuste vermillon la blancheur un peu grise, naturelle à nos plus fins coloristes ; — la gamme des tons s’est augmentée du carmin néerlandais, de l’ambre italien et de la verte pâleur des Espagnols. Nous savons bien que l’on a crié au pastiche ; mais l’imitation du procédé des maîtres a été de tous temps la base de l’art, et c’est un maigre orgueil de ne pas se servir des moyens que vous ont laissé vos devanciers. MM. Delacroix, Champmartin, Eug. Devéria, Louis Boulanger, Decamps, et quelques autres gens de cœur et de talent, ont été les plus ardents apôtres de cette révolution, et ont éloquemment prêché d’exemple.
Un mouvement semblable s’accomplit presque simultanément dans le dessin pur ; — M. Ingres tout seul, avec sa volonté de fer, en revendique l’honneur. Après la pauvre école de l’empire, dont les tableaux sont comparables aux poèmes et aux tragédies du même temps, après ce dessin si misérablement maniéré et poncif, après toute cette couleur blafarde et violâtre, il n’y avait d’autre ressource que de remonter violemment à la source éternelle de tout art et de toute poésie, au seizième siècle, époque climatérique du genre humain ; Delacroix sauta brusquement par-dessus David, Guérin, Meynier, Girodet, Fragonard, et tutti quanti, jusqu’au Titien ; Ingres ne se crût en sûreté que dans l’école de Raphaël, et il fit même de fréquentes visites au vieux Pierre de Perouge, tant il avait peur du dessin flasque et mou de ces Messieurs de l’Académie.
Ici, de crainte que l’on ne se méprenne au sens de nos paroles, nous nous hâterons d’ajouter que nous n’entendons pas dire que M. Delacroix ne dessine pas, et que M. Ingres ait seul le monopole de la correction. M. Delacroix dessine le mouvement et M. Ingres le repos ; l’un attaque les figures par le milieu, et l’autre par le bord ; celui-ci avec un pinceau, celui-là avec un crayon : voilà tout.
M. Ingres a fait beaucoup de bien. Par sa peinture calme, sérieuse et forte il a montré la puissance du style et de la simplicité ; l’aspect magistral de ses tableaux fait voir combien la disposition tranquille et symétrique, l’unité du ton local, la netteté de la silhouette l’emportent sur toutes les ruses mesquines et le papillotage misérable qui font l’admiration du vulgaire ; c’était une salutaire leçon pour tous ces jeunes artistes français qui cherchent avant tout, dans la peinture, l’esprit, le drame, l’intérêt, et qui traitent un tableau comme un vaudeville. M. Ingres ( et on le lui a souvent reproché ) a fait école, il a eu et il a des disciples enthousiastes et fervents ; c’est à nos yeux un de ses grands mérites, car, sans école, nous le répétons, c’est-à-dire sans une réunion d’hommes ayant les mêmes vues sur l’art et adorant le même maître, il n’y aura jamais que quelques talents exceptionnels, et l’on ne pourra rien exécuter de grand et de durable : Raphaël et Rubens n’ont pas fait le quart de leurs tableaux, ils se contentaient de les dessiner et d’y jeter quelques retouches.
De ces deux influences si contraires, M. Ingres et M. Delacroix, il est résulté une jeune génération de peintres vraiment remarquable, un ensemble de talents avec qui, si nous ne vivions pas dans une époque d’égoïsme mal entendu et d’originalité prétentieusement hâtive, il serait facile de mener à bout les plus grands travaux pittoresques si seulement ces jeunes peintres, au lieu de faire atelier à part daignaient être encore élèves de M. Ingres ou de M. Delacroix, et travailler de près les cartons du maître, dans les tableaux commandés à ceux-ci. De cette manière, M. Ingres ou M. Delacroix eussent pu exécuter les peintures de Notre-Dame-de-Lorette en quinze mois, et en place d’une ignoble cacophonie de couleurs, nous aurions un hymne plein d’unité et d’harmonie ; on a mieux aimé éparpiller quatre ou cinq mille francs sur une vingtaine de peintres médiocres, que de donner deux cent mille francs à un seul maître qui se serait chargé de tout à ses risques et périls.
saut
La Presse, « Salon de 1837 — École d’Ingres. — Leehmann, Amaury-Duval, Flandrin », 15 mars 1837
Ingres n’a rien exposé cette année ; c’est une vrai calamité dont on doit se consoler difficilement. La vue d’un tableau de ce grand peintre, au milieu de tout cet abominable fatras où l’art n’est pour rien, vous cause le même plaisir que l’entretien d’un homme qui n’a jamais transigé avec sa conscience. On peut se fier entièrement à M. Ingres, il n’emploiera jamais de petits moyens pour vous attirer et vous séduire ; il ne fera pas le moindre sacrifice à la vogue du moment, et quel que soit le sujet qu’il traite, il y mettra toujours la même volonté, le même soin rigoureux, et ne quittera l’œuvre que lorsqu’il la jugera digne de son austère réputation.
M. Ingres fait une très médiocre dépense de lis et de roses, et s’inquiète assez peu de l’avis des belles dames ; il ne sait pas ouvrir à propos un corsage, pour faire voir un sein veiné de bleu, comme Dubufe, l’Albane bourgeois ; il ne cherche pas dans les chroniques des anecdotes piquantes ; il ne fait pas des mélodrames peints, et n’a recours qu’aux seules ressources de son art pour fixer l’attention publique ; encore est-il d’une excessive réserve et d’un puritanisme singulier sur les moyens qu’il emploie.
C’est là un peintre consciencieux, sévère, plein de foi et d’enthousiasme, que les plus grandes nécessités n’ont pu faire descendre jusqu’à la peinture de commerce, et qui est resté depuis le commencement de sa vie dans les plus hautes sphères idéales, fidèle à Raphaël son dieu, comme Pétrarque à Laure, et Dante à Béatrice. Qu’un pareil dévouement est rare et louable dans un temps comme celui-ci, où l’on n’estime que Plutus, dieu de l’or ! — Combien de jeunes gens sont partis avec l’intention sincère de ne jamais trahir l’Art leur divin maître, et qui l’ont renié trois fois, comme Saint-Pierre Jésus-Christ, avant que le coq ait chanté.
L’on ne dit pas tout ce qu’il faut de courage pour persister en dépit de tous dans une œuvre incomprise et raillée. L’homme est en général plus humble qu’on ne le croit ; il n’y a que des natures bien énergiquement trempées qui puissent se donner toujours raison contre tout le monde, et poursuivre le sillon commencé dans un sol unanimement déclaré stérile. — M. Ingres a eu ce courage, et quand on songe que le portrait de la dame romaine que nous avons vu à l’une des dernières expositions, avait été fait en 1802, on est tout effrayé de l’audace d’une pareille peinture dans une époque semblable ; — cela devrait faire un effet aussi étrange qu’une orientale de M. Hugo intercalée dans les poésies de M. Palmezeaux de Cubières. — En effet, figurez-vous une pâleur d’ambre jaune, deux soleils noirs nageant sur un ciel de nacre, la bouche la mieux coupée, la plus amoureusement antique, une poitrine sans ombre, sans demi-teinte, d’un seul ton, et modelée cependant d’une manière admirable, des bras d’un tour divin, et des mains aux longs doigts effilés, comme Ingres seul peut en dessiner. Puis, pour l’exécution, toute la finesse gothique d’un portrait d’Holbein ou de Raphaël encore à l’école de Pierre Vannucci ; quelque chose comme la tête d’Anne de Boleyn ou de Jane d’Aragon. — Que cela devait paraître affreux aux braves gens de ce temps-là, et comme ils devaient plaindre M. Ingres du fond du cœur !
Quelle charmante peinture que l’Angélique et Roger ; le Roger couvert de pied en cap d’une armure d’or, sa lance appuyée au crampon de sa cuirasse, la jambe tendue, le coude faisant un triangle en arrière du corps, tout à fait dans la position des chevaliers de tournois, fond du haut des airs sur l’Orque terrible qui doit dévorer Angélique. La belle fille se détourne avec un mouvement plein de pudeur ; rien n’est plus gracieux que ce corps frêle et blanc qui se détache sur le fond noirâtre du rocher. L’hippogriffe a des ailes d’épervier, d’une exactitude d’imitation et d’une beauté de couleur que Veeninx envierait.
Vous souvenez-vous du sphinx, ce monstre au visage et aux mamelles de femme, qui lève en l’air sa patte aux griffes d’airain, et regarde, d’un air si sournoisement attentif, le jeune Œdipe debout devant lui, qui, le pied sur une pierre et le coude sur le genou, réfléchit à l’énigme proposée, et y cherche une solution. — Quelle invention poétique pleine d’une saisissante terreur, que cette paire de pieds bleuâtres, récente proie du monstre sortant toutes raides de la gueule d’une noire caverne, et ces ossements blanchis par le soleil, lavés par la pluie, semés aux alentours de l’antre, pour faire comprendre combien de temps déjà avait duré ce brigandage.
Quant à l’Odalisque, une belle lithographie l’a rendue populaire. — Remarquez, à propos de cette figure, combien l’art véritable sait imprimer de chasteté aux choses les plus nues. Une femme colletée jusqu’au menton, de M. Dubufe, est plus indécente mille fois que l’Odalisque de M. Ingres. L’Odalisque ne choquerait personne, même dans une église. Quel air de confiance et de calme ! et comme son visage respire bien cette heureuse sérénité d’un femme sûre d’être parfaitement belle et de l’être toujours ; ce n’est pas une femme qui vient de se déshabiller et qui s’est couchée sur des carreaux pour vous montrer ses épaules, son dos et ses reins ; c’est une femme qui a toujours été nue et que l’on ne peut concevoir autrement que nue. Ces pieds de marbre ignorent la chaussure, cette taille divine n’a jamais senti la pression d’une robe ou d’un corset ; rien ne réveille les sens dans cette beauté toute idéale ; l’esprit seul jouit de cette harmonieuse perfection ; — En peinture il n’y a d’indécent que ce qui est mal fait.
Dans le Vœu de Louis XIII, tableau qui vient d’être magnifiquement gravé, rayonne au milieu d’une gloire la seule Madone que l’on ait faite depuis Raphaël. Cette figure est de la plus angélique beauté ; le Sanzio lui-même serait fier de l’avoir dessinée et peinte. Une pareille tête n’est possible qu’à M. Ingres et n’eut-il fait que cette seule tête ou celle du Saint-Symphorien, il n’en serait pas moins le plus grand peintre moderne.
Pendant que M. Ingres enfantait ces belles choses, ces messieurs faisaient la peinture que vous savez.
Mais hélas ! M. Ingres est parti pour Rome, sa patrie naturelle, et ne veut plus rien exposer, à ce qu’on dit, blessé qu’il a été de quelques observations critiques. Noue espérons que ce grand homme cessera bientôt de bouder contre sa gloire, et qu’il nous sera donné de voir de lui de nouveaux chefs-d’œuvre.
En attendant que le peintre du plafond d’Homère se décide à rentrer dans l’arène du Musée, il y est représenté assez convenablement par trois de ces élèves, MM. Flandrin, Leehmann et Amaury-Duval.
GAUTIER critique d’INGRES
Charte de 1830, « Vente de la galerie de l’Élysée-Bourbon », 8 mai 1837
Si j’étais M. Hope, M. le duc de Sunderland, M. Demidoff, ou tout autre millionnaire, trillionnaire ou billionnaire, au lieu d’acheter à des prix insensés des tableaux usés repeints et vernis à outrance de maîtres, dont plusieurs n’ont pas grand mérite même quand ils sont purs et certains, j’aimerais beaucoup mieux me faire peindre de grandes galeries par Delacroix, Ingres, Decamps, Louis Boulanger, Camille Roqueplan, Cabat, et tous ces jeunes gens d’un talent si remarquable dont on tire si peu parti. — avec la même somme l’on aurait quatre fois autant de tableaux, incontestables, frais, jeunes et vifs, d’une valeur pour le moins égale, et l’on aurait encouragé et développé beaucoup de génies timides qu’un rayon favorable de la fortune ferait rapidement mûrir ; mais c’est plus au nom du peintre qu’à la valeur même du tableau que tiennent les amateurs, pour qui en général l’art n’est guère qu’un luxe comme les chevaux de race et l’argenterie anglaise.
Revue de Paris, 25 avril 1841
Assurément nous n’avons pas tout dit : nous avons été forcé de passer sous silence beaucoup de productions estimables et qui auraient droit aux honneurs de la mention ; car il y a dans l’école un progrès réel, incontestable. Si le génie est rare, le talent est commun. Tous font bien ; celui qui ferait mieux serait vraiment un homme prodigieux ; il est plus difficile que jamais d’être un maître, car à aucune époque les élèves n’en ont tant su. Examinez l’ensemble du salon, et vous serez surpris de voir qu’il y manque Ingres, Ziegler, Delaroche, Horace Vernet, Aug. Scheffer, Roqueplan, Decamps, presque tous les maîtres d’aujourd’hui, presque toutes les vogues consacrées, et que cependant c’est, après tout, un salon intéressant, digne de l’attention du public et de la critique, et qui témoigne favorablement de la situation actuelle de l’art.
La Presse, » Salon de 1844 « , 26 mars 1844
L’exposition vient de s’ouvrir. Elle est plus nombreuse que jamais. Une haute influence a, dit-on, engagé le jury à être indulgent ; ce qui ne veut pas dire que le dernier ouvrage accepté soit meilleur que le premier refusé, comme l’exigerait la stricte justice. Mais l’appréciation impartiale, en matière d’art, est une chose tellement difficile, que tout autre mode d’examen présenterait peut-être autant d’inconvéniens.
Nous avons, à une époque où deux écoles se trouvaient en présence, réclamé de toute notre force contre des juges exclusivement choisis dans l’un des deux camps. — De grandes injustices ont été commises ; il ne pouvait en être autrement ; bien des existences et des vocations d’artistes ont été détournées ou dérangées par des ostracismes systématiques, et, il faut le dire à la honte du jury, dans les noms des bannis ont figuré tour à tour les noms les plus illustres et les plus vivaces de notre temps, — en sorte qu’il était pour ainsi dire honorable d’être refusé, et qu’un tableau rejeté avait beaucoup de chances d’être excellent : la galerie d’un prince à jamais regrettable n’était guère formée que des rebuts du jury.
Cette fois, l’on n’a pas, que nous sachions, à déplorer autant de ces exclusions brutales et stupides ; cependant l’on n’a pas admis un médaillon envoyé par M.A. Préault, contre qui se continue cette lâche guerre, ce lent assassinat qui dure depuis dix ans.
Nous ne tomberons pas dans ce lieu commun de prétendre que le salon de cette année est inférieur aux salons des années précédentes ; à ce compte, il y a longtemps que la peinture en serait revenue aux essais de la fille de Dibutade, qui dessinait sur le mur l’ombre de son amant ; nous ne croyons pas à la dégénérescence de l’espèce humaine, ni du côté moral ni du côté physique. Il faut se défier de ces récriminations chagrines, qui ne sont qu’un moyen de ne pas admirer une chose actuelle et vivante. Le salon montre, dans la masse des artistes, une somme de talens considérable. Sans doute, les deux ou trois mille tableaux qui tapissent les murs du Louvre ne sont pas tous des chefs-d’œuvre ; mais quel pays et quelle époque a jamais pu produire, tous les ans, un lieu de chefs-d’œuvre ? Ce qu’il y a de certain, c’est que, dans aucune autre contrée de l’Europe moderne, il ne serait possible de réunir, à des dates si rapprochées, un pareil nombre de toiles satisfaisantes. — Il ne faut pas oublier qu’une exposition n’est pas un musée, et que les tableaux inscrits au livret ne sont pas proposés comme des modèles à étudier. C’est seulement un moyen de faire communiquer l’artiste avec le public et de faire naître entre lui et la foule des relations sympathiques ; l’art étant presque exilé de la vie moderne, ces occasions ne sauraient être trop fréquentes, le goût général s’éclaire par l’habitude de voir des tableaux. Les conversations et les journaux font du bruit et du mouvement autour de ces nobles arts silencieux, la peinture et la sculpture : la mode s’en mêle, et tel homme du monde qui n’aurait jamais regardé un tableau se trouve un samedi obligé d’admirer une belle peinture tout en lorgnant une jolie femme. — Grâce aux expositions, à l’ardeur qu’excite dans la jeunesse l’idée de se trouver en présence du public, dans la galerie même occupée par les grands maîtres, à l’espoir d’un renom promptement acquis, l’école française est aujourd’hui la première école du monde après avoir été longtemps la dernière. L’Italie n’est plus que l’ombre d’elle-même, l’Espagne n’existe plus, la Hollande et la Flandre vivent sur leur passé. — Düsseldorf et Munich composent, dessinent, et font plutôt de l’érudition que de la peinture. Overbeck, Cornelius, Schnorr, Bendemann, Lessing, Kaulbach sont assurément des artistes d’un grand talent ; mais ils ne sauraient lutter contre l’école française si brillante et si nombreuse. L’Angleterre possède d’excellens aquarellistes, mais elle n’a rien à nous opposer comme peinture sérieuse. Tel jeune homme qui se serait laissé aller aux facilités que les illustrations de livres, les ressemblances de bourgeois offrent pour gagner de l’argent sans talent ni efforts, fait un retour à l’art pur, aux sévères études, dans l’idée de produire de l’effet au salon, et se trouve ainsi sauvé de la vulgarité. — Seulement, depuis quelques années, nous avons remarqué chez les peintres en renom une tendance à se retirer des expositions, soit par dédain ou bouderie, soit par nonchalance ou crainte de compromettre une réputation déjà faite. Cette manie a fait de rapides progrès, et le livret cette fois est veuf de presque tous les noms célèbres.
C’est M. Ingres qui le premier s’est retiré sous sa tente comme un Achille grognon ; il n’avait pas été content de la manière dont avait été accueilli son Martyre de saint Symphorien. Pourtant, jamais œuvre n’avait été l’objet d’un examen plus attentif, d’une discussion plus respectueuse. Les beautés avaient été exaltées, les défauts indiqués avec tous les restrictifs et les linitifs désirables. On l’avait mis entre Albert Dürer et Raphaël. — Une belle place à contenter les plus difficiles ! surtout quand on pense que précédemment l’Odalisque, le Vœu de Louis XIII, l’Œdipe, avaient passé presque incognito, le goût de l’époque étant aux mythologies enluminées et aux troubadours en redingote beurre frais.
À dater de ce jour, M. Ingres n’a plus voulu se risquer au Louvre ; il expose chez lui. C’est ainsi qu’il a laissé entrevoir la Vierge à l’hostie, le Portrait du duc d’Orléans, celui de Cherubini couronné par la muse de la musique, etc.
Cet illustre exemple n’a été que trop suivi.
Les célébrités n’ont plus envoyé de tableaux que tous les deux ans, et maintenant elles semblent décidées à n’en plus envoyer du tout. Ingres, Delaroche, Delacroix, Scheffer, Decamps, Roqueplan, Meissonnier, Jules Dupré, Cabat et bien d’autres brillent au salon par leur absence.
La Presse, 30 mars 1844
M. Ingres, bien qu’il n’ait jamais fait, que nous sachions, un arbre de sa vie, a cependant eu une grande influence parmi les paysagistes. — Imbus de ses principes, de jeunes peintres ont cherché à donner du style à une branche, à un tronc ; ils ont élagué les détails, simplifié les localités de tons, traité les feuilles par masses, renoncé à tout artifice de touche, choisi pour le ciel une nuance variant du cobalt clair à l’indigo intense ; pour les terrains, une teinte saumon pâle, et pour les arbres, un vert-de-gris plus ou moins foncé. — Du premier coup d’œil, rien ne semble plus défavorable au paysage, qui vit d’ombre, de fraîcheur et de transparence, que ce régime d’anachorète en Thébaïde.
Eh bien, telle est la force du style, telle est la puissance des lignes que, suivant cette route âpre et pierreuse, plusieurs artistes ont produit des tableaux remarquables et d’une grande nouveauté.
La Presse, 11 mars 1845
Les noms de la plupart des membres du jury sont tout à fait inconnus. Qu’est-ce que MM. Lebas, Vaudoyer, Huvée, Debret, Achille Leclerc, architectes ? MM. Petitot, Ramey, Nanteuil, Dumont, sculpteurs ?
M. Lebas est l’auteur de Notre-Dame-de-Lorette ;
M. Huvée, de la Madeleine ;
M. Debret, des restaurations de Saint-Denis.
Ces ouvrages classent suffisamment leurs auteurs.
Pourquoi MM. Vernet, Delaroche, Ingres, David, laissent-ils le soin de juger de la peinture à ces inconnus ? à qui persuaderont-ils qu’ils sont indignés de ces exécutions à mort, quand ils se retirent philosophiquement du jury, sous prétexte qu’ils ne peuvent supporter de pareilles abominations ? Certes, cela est beaucoup plus commode.
La Presse, « La Croix de Berny », 31 janvier 1847
Une des plus charmantes galanteries que la France ait pu faire à la jeune duchesse de Montpensier, c’est le magnifique Album qui lui a été offert à son arrivée à Paris. — De l’or, des diamants ; rien n’est plus commun, cela se trouve partout, mais un Album pareil, Paris seul peut le composer !
Parmi les richesses qu’il renferme, nous avons remarqué un dessin de M. Ingres représentant Jésus-Christ enfant au milieu des docteurs, superbe composition renfermant un grand nombre de figures du plus grand style quoique hautes à peine de quelques pouces, et rappelant pour la beauté de l’ordonnance les plus nobles fresques des maîtres.
L’enfant Dieu est assis sur un banc de grande personne, et ses beaux petits pieds ne peuvent atteindre l’escabeau placé devant lui. Ce détail d’une naïveté charmante ne dérange en rien la gravité de la scène.
La Sainte-Vierge, vêtue d’un manteau bleu, avance, entre les physionomies barbues et revêches des docteurs, sa tête inquiète et pâle d’émotion maternelle : rassurée sur l’absence de son enfant, elle se laisse aller à la joie de le voir triompher par sa science précoce des questions insidieuses des Pharisiens.
Ce dessin extrêmement fait et coloré çà et là de faibles teintes d’aquarelles, a quelques rapports d’aspect et de manière avec les compositions d’Overbeck et de Cornelius. Buriné par quelqu’un de ces merveilleux graveurs allemands qui font des chefs-d’œuvre des médiocres croquis des artistes de Düsseldorf et de Munich, il acquerrait bien vite une immense popularité.
C’est le plus riche joyau de cet écrin splendide. — Un album royal peut seul posséder un dessin de M. Ingres de cette importance.
La Presse, « La Croix de Berny – Une visite à M. Ingres », 27 juin 1847
À côté de ce dôme des Quatre-Nations, devant lequel des lions d’un aspect bénin vomissant de l’eau claire, innocente et muette épigramme, au fond de la cour de l’Institut, se trouve un atelier étroit surmonté d’un logement incommode, qui renferme des richesses vraiment royales, un sanctuaire, une chapelle de l’art où les adorateurs se rendent en pèlerinage, lorsque le grand-prêtre veut bien en entrouvrir les portes.
C’est là que demeure M. Ingres, le peintre de notre temps qui a le plus d’influence sur la jeunesse, et dont la sévérité a créé de si vifs enthousiasmes, le maître qui, avec un regard irrité, faisait fondre les élèves en larmes, et dont un sourire approbateur leur causait des extases de joie.
M. Ingres, qui semble avoir pris pour devise le vers d’Horace : » Odi profanum vulgus et arceo » n’expose plus ; à moins que ce ne soit pour quelque exhibition particulière, comme celle de la galerie Bonne-Nouvelle, où l’immense succès obtenu lui prouve que le public n’est pas si indigne de l’admirer qu’il semble le croire : les occasions de voir de ses tableaux sont donc excessivement rares, et c’est une bonne fortune que d’être admis à en contempler quelques uns.
Cette bonne fortune, nous l’avons eue l’autre semaine, et nous en avons été heureux plusieurs jours. Quelle noble sensation de contempler une belle chose et de la comprendre ; il semble qu’on l’ait faite ! Après l’amour, la plus vive jouissance de l’âme est l’admiration ; les envieux sont fort à plaindre !
Par un hasard étrange et que nous raconterons tout à l’heure, un portrait de femme, peint par M. Ingres dans sa jeunesse, était revenu momentanément entre ses mains.
Ce portrait fut fait à Rome en 1807. L’artiste, qui n’avait guère plus de vingt ans, était loin d’être opulent : absorbé par l’étude de la nature et des maîtres, par la recherche du beau idéal, par ce rêve de perfection impossible qui tourmente le génie, il négligeait les soins matériels de la vie et s’était trouvé, dit-on, réduit souvent au point de faire lui-même ses pinceaux faute de pouvoir en acheter. Il se rencontra une femme alors belle, élégante et riche, qui ne craignit pas de confier sa tête charmante à ce jeune pauvre peintre inconnu, au lieu d’aller solliciter la brosse banale d’un artiste à la mode.
Il fallait sans doute un grand courage à cette belle dame, pour poser devant ce gaillard à mine farouche, aux yeux étincelans sous leurs épais sourcils noirs, à la chevelure inculte et touffue, au teint fauve comme un revers de botte ; car tel était l’aspect de M. Ingres en ce temps-là, s’il faut en croire un magnifique portrait où il s’est représenté lui-même, avec la férocité et l’ardeur d’un Giorgione, et qu’on voit suspendu dans son cabinet.
Quelle dut être la stupéfaction des gens à l’aspect de cette peinture, si différente de celle qui florissait à cette époque ? Les complaisans de la maison ne manquèrent assurément pas de déplorer qu’un aussi joli visage » pétri de lys et de roses eût été livré aux pinceaux gothiques de ce jeune barbare. «
Le portrait fut payé à M. Ingres, ravi d’une si bonne aubaine, quelque chose comme quatre ou cinq cent francs, une fortune…Cette toile, dont l’artiste avait perdu la trace, comme de vingt autres chefs-d’œuvre de sa jeunesse, nous l’avons vue l’autre jour chez lui.
Elle représente une jeune femme à mi-corps, assise sur un fauteuil, vêtue d’une robe de velours noir, à taille courte, les mains croisées et tenant un éventail, le coude pris dans les plis d’un cachemire admirablement drapé.
Ce qui étonne d’abord dans ce tableau, c’est la couleur ; si la forme du vêtement ne désignait pas la date, on croirait voir un Titien ; les tons ont cette chaleur d’ambre, cet éclat blond, cette force intense qui caractérise l’école vénitienne ; les nuances les plus vives sont abordées franchement ; le fauteuil est rouge, le châle jaune sans aucune de ces atténuations employées par les harmonistes en coloris. Est-ce le temps, ce grand maître, qui a doré cette peinture de ces glacis intelligens, rompu les teintes, adouci les crudités, réchauffé les tons grisâtres, ou M. Ingres serait-il, ce dont nous nous sommes toujours douté, un grand coloriste méconnu ? Dans tous les cas, cette figure est une merveille d’éclat et de réalité.
La tête est presque de face. Des cheveux fins, soyeux, à nuance d’écaille, sur lesquels glisse un reflet bleuâtre, se séparent simplement de chaque côté d’un front uni, dont la blancheur blonde rappelle l’ivoire, et vont se ranger derrière une oreille aux cartilages ourlés comme une coquille de la mer du Sud, et dont le bout, rendu transparent, est frisé par une touche de lumière.
Les sourcils minces, amenuisés comme des pointes d’arc, étendent leurs lignes pures au- dessus des deux yeux, les plus beaux que l’art ait fait ouvrir au fond d’une toile ; la vie, la lumière en débordent ; la prunelle noire y nage dans un cristallin si clair, si limpide, si mouillé de luisans onctueux, si diamanté d’étincelles, qu’au bout de quelques minutes on baisse les yeux comme devant un regard réel qui s’attacherait fixement sur vous.
L’enchâssement de ces yeux, ou plutôt de ces étoiles, les passages du front au nez, la manière dont les coins externes des sourcils et des paupières vont mourir vers les tempes ont de quoi vous retenir des heures entières : le nez, élégant et droit, aux narines finement coupées et d’une obliquité un peu moqueuse ; la bouche aux lèvres délicates teintées de cette nuance idéale, innommées, qu’on trouve au cœur des roses blanches et qui est comme la rougeur pudique de la fleur honteuse de s’ouvrir ; l’ovale qui enferme toutes ces beautés, et dont chaque inflexion sont un poëme, ont à la fois la puissance de la réalité et le charme de l’idéal. Cette femme est Mme ***, ou c’est une Vénus grecque qui a eu la fantaisie de revêtir une robe.
Le col et la poitrine ne sont pas moins surprenans ; de même que dans la figure toute trace d’art et de travail a disparu, nulle apparence de touche, point d’empâtement, point de martelage, aucun artifice, aucun moyen même. Ces chairs en pleine lumière où l’on ne saisit ni ombre, ni demi-teinte, et qui pourtant se modèlent avec tant de force et de finesse, semblent s’être épanouies d’elles-mêmes sans ébauche, sans tâtonnement ; on ne dirait pas que la brosse les ait transportées de la palette sur la toile ; on croirait qu’elles sont sorties du champ du tableau à l’évocation de l’artiste.
De cette forme de robe qui passe à bon droit pour ridicule, M. Ingres a fait un chef-d’œuvre de grâce ; il a su donner à l’échancrure du corsage des ondulations si harmonieuses que le costume antique ne serait pas plus agréable à l’œil.
Dites, la draperie de la Mnémosyne a-t-elle jamais fait sur son corps de marbre des plis plus purs que ceux de ce châle jaune à la mode de 1807 ? Et les mains, comme elles sont dessinées et peintes ! Holbein n’a rien fait de plus fin ; Raphaël, de plus noble ; Titien, de mieux coloré. L’éventail d’écaille, découpé à jour, est d’une beauté de ton et d’une puissance de trompe-l’œil incroyables ; ses feuilles déployées viennent de s’abattre en sifflant, et frémissent encore du vent agité.
La femme qui a le bonheur d’être éternellement belle dans ce cadre, et qui, comme la Monna Lisa, au mur du musée royal, fera rêver pendant les siècles à venir, les artistes, les poètes, les songeurs, les amoureux et toute la race choisie émue d’un beau contour, quoique le peintre fût inconnu de presque tous, éraillé de quelques uns, aimait ce portrait bizarre et merveilleux si en dehors des habitudes pittoresques du temps. Peut-être avait-elle été peinte aussi par Robert-Lefèvre, par Girodet ou Gérard ; mais elle ne garda que la toile d’Ingres, d’abord comme un miroir, ensuite comme un souvenir.
En ses fortunes, qui furent diverses et orageuses, le portrait l’accompagna toujours. C’était sa beauté, sa jeunesse, son temps de splendeur. Un regard jeté sur ce cadre la transportait aux jours regrettés. Elle se consolait de la glace en regardant la toile jadis aussi fidèle. Bientôt, elle ne se mira plus que dans le portrait, et, aux rares visiteurs, elle le montrait avec fierté, en disant : » C’était moi. » La beauté, c’est le génie de la femme ; une belle femme a le droit d’orgueil comme un grand poète.
Dans l’appartement appauvri, le portrait splendide étincelait et rayonnait, joyau digne d’un Louvre et qu’une reine eût envié. Les années qui détruisaient le modèle embellissaient la peinture, et moins elle lui ressemblait, plus la pauvre femme y tenait. Ce n’était que par ce tableau qu’elle ressaisissait la tradition d’elle-même.
Bien des fois on lui avait dit que cet Ingres avait acquis quelque réputation, et que peut-être un brocanteur se pourrait accommoder de la chose ; que cet argent viendrait fort à point, et qu’elle n’avait que faire maintenant d’un portrait décolleté en robe de velours noir et en cachemire jaune. Cela ne persuadait pas Mme ***. Il lui semblait qu’une fois cette image enlevée elle se sentirait laide et vieille, qu’on emportait avec lui sa grâce, sa jeunesse, tout le côté heureux et charmant de sa vie, qu’on la priverait d’un ami contemporain de ses beaux jours. L’idée de le vendre la faisait pleurer comme une ingratitude et une trahison, elle aurait cru livrer la meilleure partie d’elle-même, et se séparer d’une jeune sœur, parée de sa beauté d’autrefois.
Enfin, quelque parent, neveu ou autre, prit le portrait et le vendit à un marchand. On vint dire à M. Ingres qu’un tableau de lui, éblouissant de jeunesse et de couleur, figurait dans une boutique. Le tableau fut retiré, et M. Ingres reconnut la femme qu’il avait peinte à Rome.
M. R…, amateur distingué, possède maintenant ce chef-d’œuvre. On fait au modèle une rente viagère qui suffit à ses besoins. — Ainsi, pour avoir été belle en 1807 et avoir eu l’idée de se faire peindre par un grand artiste inconnu, une femme, dont l’opulence a disparu, trouve quelques adoucissemens dans les jours de sa vieillesse. Ces cinq cents francs donnés au jeune peintre, capitalisés par la gloire, ont produit mille francs de rente. Ce contour, fixé par la main du génie, fait la richesse du modèle, effacé par la main du temps. On dit que M. Ingres, ayant su les détails de cette histoire et cette touchante obstination à garder son œuvre a compris, avec cette matérielle intelligence du génie, les douleurs de cette pauvre femme qui n’est plus belle que par sa peinture, et lui a fait exécuter, par un de ses meilleurs élèves, une copie parfaitement exacte du portrait. Ainsi, dans sa chambre, égayée maintenant d’un peu d’aisance, Mme *** pourra se voir encore telle qu’elle était jadis, et grâce à ses yeux un peu affaiblis croire qu’elle possède toujours l’original de M. Ingres.
Nous avons aussi admiré deux portraits, l’un de femme, l’autre d’homme, peints à Florence il y a plusieurs années, et d’un aspect tout différent. Ils appartiennent à la seconde manière du maître ; les teintes argentées et grises commencent à s’y glisser ; l’aspect est doux, harmonieux, mais peut-être avec trop de sacrifices.
Un magnifique portrait de Mme de Rothschild, presque terminé, montre chez M. Ingres un de ces rares retours à la couleur, qui ne sont pas si rares chez lui qu’on voudrait bien le croire. Tout, dans ce tableau, respire l’opulence et le faste : une robe rose puissamment étoffée, des brocards à ramages touffus, une pose pleine de sécurité, des bras puissans et superbes, des mains renversées dans une de ces attitudes d’un galbe grandiose dont les maîtres seuls ont le secret, donnent à ce portrait un aspect somptueux bien en harmonie avec le sujet. Tous les accessoires sentent le luxe de la haute banque ; mais l’œil, qui est l’âme, a un regard charmant et une douceur intelligente. C’est peindre à la fois la position et le caractère de la personne ; ce regard suave éclaire le tableau.
Bien que le peintre n’y ait encore consacré que trois séances, et qu’on nous l’ait montré presque confidentiellement, nous ne pouvons nous empêcher de dire quelques mots d’un portrait de femme assise sur un canapé, et dont la main joue avec une tête d’enfant penché à ses genoux : jamais beauté plus royale, plus splendide, plus superbe et d’un type plus junonien n’a livré ses fières lignes aux crayons tremblans d’un artiste. Déjà la tête vit. Une main d’une beauté surhumaine s’appuie à la tempe et baigne dans les ondes de la chevelure un doigt violemment retroussé avec cette audace effrayante et simple du génie que rien n’alarme dans la nature.
Nous avons revu là, en train d’exécution, le Jésus parmi les docteurs, dont le dessin à l’aquarelle est la perle de l’album de Mme la duchesse de Montpensier : quelle charmante idée que celle des petits pieds de l’Enfant-Jésus qui ne peuvent atteindre l’escabeau. Comme tous ces vieux docteurs ont des poses à la fois familières et nobles, comme leurs gestes sont vrais et d’une force intime, comme on y lit l’étonnement à toutes les phases ! Et ces mains tendues de la mère à la recherche de son enfant, ne sont-elles pas d’un sentiment exquis, dignes du maître allemand le plus naïf et le plus plein de foi ?
Cette toile remarquable, une des plus importantes compositions de M. Ingres, n’est encore qu’à l’état d’ébauche ; mais viennent quinze jours d’enthousiasme et tout sera fini.
L’Événement, « Ateliers de peintres et de sculpteurs – I. M. Ingres », 2 août 1848
M. Ingres occupe à l’Institut un logement au-dessous duquel se trouve au rez-de-chaussée un atelier composé de plusieurs pièces, et qui n’a rien de caractéristique. Là, nul luxe, nulle coquetterie d’arrangement, aucune de ces curiosités pittoresques qui encombrent les ateliers des artistes à la mode et les font ressembler à des magasins de bric à brac, la pensée seule illumine ces chambres vulgaires ornées de quelques fragments de plâtres antiques et de toiles la plupart sans bordure accrochées çà et là aux murailles. Dans un coin, un élève muet et studieux copie religieusement quelque œuvre du maître : le jour amorti par des toiles tendues à mi-hauteur des croisées, tombe d’une arrière cour déserte où l’herbe encadre les pavés.
Et cependant, ce réduit froid, pauvre, silencieux et morne, est un des plus riches sanctuaires de l’art moderne. Raphaël, s’il revenait au monde, s’arrêterait là plus volontiers qu’ailleurs, et s’y trouverait comme chez lui.
Quoiqu’il ait eu son génie tout jeune, M. Ingres n’a eu sa réputation que fort tard : sa gloire s’est épanouie à son automne comme une fleur tardive. Mais cette renommée qui s’est fait si longtemps attendre, en venant, a donné à l’artiste une nouvelle jeunesse. À l’âge où l’esprit devient paresseux et la main pesante, M. Ingres a tout l’enthousiasme d’un néophyte, et jamais son pinceau ne fut plus ferme.
La vie de M. Ingres n’a été occupée que d’une seule passion, celle de l’art. Ce chaste amour sans déception l’a conservé jeune. Son œil brille de tout le feu d’un œil de vingt-cinq ans, et les années n’ont pas glissé un fil d’argent dans ces boucles noires que sépare sur le front une petite raie, hommage mystérieux et symbolique à la mémoire du maître adoré, du bel Ange d’Urbin. Sa main secoue la vôtre avec une vigueur qui ne sent en rien son sexagénaire : M. Ingres fournira une carrière aussi longue que celle du Titien, et ses tableaux centenaires seront les meilleurs, car, chose étrange, il fait chaque jour des progrès, et ce maître souverain, arrivé au bout de l’art, apprend encore.
Le tableau qui nous attirait dans son atelier, outre son mérite intrinsèque, offre un curieux sujet d’étude. Quoiqu’il ne porte qu’une signature, il a été peint par deux artistes, par l’Ingres d’autrefois et par l’Ingres d’aujourd’hui. Un intervalle de quarante ans a séparé l’ébauche de l’achèvement. Cette Vénus, qui a commencé à sortir de l’onde à Rome en 1808, n’a totalement émergé de l’azur qu’à Paris en 1848. La jeune fille de treize ans qui avait prêté sa tête enfantine à la naissante Aphrodite, a eu le temps de devenir une auguste matrone, entourée d’un cercle de petits-fils, à moins que la terre jalouse n’ait recouvert prématurément sa beauté printanière. Un des amours, celui qui tient le miroir et que le peintre a féminisé par une idée ingénieuse et délicate, a grandi et posé depuis pour la fameuse Odalisque, sans que le tableau se finît. Ô divin pouvoir du génie ! éternelle jeunesse de l’art ! toutes ces formes pures et charmantes que le peintre ravi contemplait dans leur chaste nudité, se sont effacées comme des ombres, et l’ombre fixée sur la toile a survécu. Tes blonds cheveux ont blanchi, ô Vénus ! et l’artiste, pour terminer ton image, est forcé de demander aux belles d’une autre génération de laisser tomber leurs voiles devant lui. C’est peut-être ta fille, à toi qui posais pour l’amour-enfant, qui sert aujourd’hui pour la mère des amours, — si elle n’est pas trop vieille.
Ces réflexions mélancoliques, qui nous venaient en foule en regardant le tableau, ont sans doute longtemps troublé le peintre. Plus de cent fois il a retourné la toile posée contre le mur, et l’a placée sur son chevalet, puis, après une contemplation muette, il l’a remise au même endroit sans y toucher.
Nous concevons ces hésitations et ces lenteurs. En face de ce rêve de ses premières années, gardé pieusement par la toile, de ces légères teintes de l’ébauche à travers lesquelles la pensée transparaît toute nue, autre Vénus sortant de la mer, il n’osait pas saisir la palette, craignant de recouvrir sous le travail même le plus savant, ces incorrections de l’esquisse que nulle perfection ne peut quelquefois égaler ; ne sachant pas s’il retrouverait cette inspiration perdue, ou tout au moins oubliée. Il est si difficile de reprendre, lorsque le temps a coulé, la ligne au point interrompu, le chant commencé, le tableau figé sur le chevalet !
Et puis, s’il faut le dire, et tout artiste nous comprendra, M. Ingres avait peur de lui-même : il redoutait, sans peut-être s’en rendre compte, ce combat de l’homme d’aujourd’hui contre le jeune homme d’autrefois. Dans cette lutte dont il était le champ de bataille, il redoutait la victoire et la défaite. Sa profonde et souveraine expérience vaudrait-elle le frais enchantement du début, et cette charmante surprise de l’artiste, disciple encore hier, en face de la nature découverte par lui comme un nouveau monde. S’il restait inférieur au travail commencé, toute une vie d’études, de méditations et de labeurs, aurait donc été inutile ! Triste leçon pour l’artiste glorieux et plein de jours ! S’il lui était supérieur, n’y avait-il pas comme une espèce de barbarie à mesurer de ses forces de vieil athlète contre ce chef-d’œuvre juvénile. Dans l’ordre intellectuel, n’était-ce pas une impiété que de galvaniser cette pensée à demi morte, et de lui faire dire autre chose que ce qu’elle aurait voulu.
Elle était si belle d’ailleurs, cette pauvre Vénus Anadyomène, dans la douce pâleur de sa grisaille réchauffée légèrement de tons roses, au milieu de l’azur éteint de sa mer et de son ciel embrumé par la poussière de quarante années, dans ce charmant coloris neutre qui laisse toute sa valeur à la forme ! les amours jouaient si bien parmi cette écume indiquée à peine par des caprices de brosse, que chacun disait au peintre : » N’y touchait pas ! «
Eh bien ! un jour de printemps, malgré les émeutes et les révolutions, M. Ingres s’est senti si jeune qu’il a repris le rêve de ses vingt ans et l’a audacieusement mené à bout : la Vénus Anadyomène est finie, et c’est la même ! Rien n’eût été plus facile au grand maître que de peindre sur cette toile une autre figure supérieure à la première peut-être, mais que fut devenu le prodige ?
Fraîcheur, naïveté, timidité adolescente, tout s’y retrouve ; c’est la candeur adorable du génie, mais sans l’inexpérience et les erreurs. C’est l’étude d’un élève peinte par son maître : le don y brille, joyau inestimable serti dans la science ; tout ce qui vient de Dieu y est avec tout ce qui vient de l’homme.
L’heureux possesseur de ce diamant l’a fait enchâsser dans une riche monture d’or où se jouent des dauphins sculptés, et qui peut se dresser au milieu d’un appartement comme le David de Daniel de Volterre. Si M. Ingres vit cent ans, peut-être peindra-t-il l’autre face.
Il ne nous est rien resté des merveilleux peintres grecs ; mais, à coup sûr, si quelque chose peut donner une idée de la peinture antique telle qu’on la conçoit d’après les statues de Phidias et les poëmes d’Homère, c’est ce tableau de M. Ingres : la Vénus Anadyomène d’Apelle est retrouvée. Que les arts ne pleurent plus sa perte.
Aphrodite est presque enfant. Le flot d’écume qui l’enfermait vient de crever et bouillonne encore. La déesse a l’apparence d’une jeune fille de treize à quatorze ans. Son visage où s’ouvrent des yeux bleus doucement étonnés, et où s’épanouit un sourire plus frais qu’un cœur de rose, a toute la candeur et l’ingénuité du premier âge ; mais, dans son corps frêle et virginal, la puberté éclôt comme une fleur hâtive. Vénus est précoce : la gorge se gonfle soulevée par un premier soupir ; la hanche se dessine, et les contours s’enrichissent des rondeurs de la femme. Rien n’est plus fin, plus pur, plus divin, que ce corps de Vénus vierge. Grande déesse des amours, c’est là le seul charme qui te manquait ! En te faisant ce don plus précieux que celui du ceste, M. Ingres, t’a mise en état de lutter avec Marie, la Vénus chrétienne !
Ses bras levés au-dessus de sa tête avec un mouvement d’une grâce indicible, tordent ses cheveux blonds d’où ruissellent des perles, larmes de regret de la mer désolée de porter ce beau corps au rivage.
Ses pieds blancs comme le marbre et d’où la froideur de l’eau a chassé le sang, sont caressés par les lèvres argentées de l’écume et les lèvres roses de petits amours, chérubins païens, en adoration devant leur reine.
L’un d’eux, se haussant sur la pointe d’une vague, tend à Vénus un miroir, c’est-à-dire la conscience de sa beauté. La main potelée de l’enfant se réfléchit avec un art admirable dans le métal bruni.
Au fond, les Tritons s’agitent ; les dauphins sautent ; tous les habitans du moite empire célèbrent l’heureuse naissance.
Il n’est personne qui n’admire le dessin pur, le modelé fin, le noble style de M. Ingres. Toutes ces qualités se retrouvent ici avec celle d’un coloris charmant. Rien n’est plus doux à l’œil que cette figure d’une blancheur dorée entre le double azur du ciel et de la mer. M. Ingres, depuis quelques années, a gagné énormément comme palette. L’âge le réchauffe ; heureux homme, qui a commencé à dessiner comme Holbein, et finira par peindre comme Titien !
Dans une pièce voisine rayonnait sur un chevalet une peinture toute moderne et d’un sentiment tout opposé. — C’était un portrait, celui de madame de R.
Il est difficile de rendre plus compréhensible par le choix de la pose et l’arrangement du costume un caractère et une position sociale.
L’artiste avait à peindre une femme du monde, et de ce monde qui nage dans une atmosphère d’or ; il a su être opulent sans être fastueux, et a corrigé par l’étincelle de l’esprit des bluettes des diamants.
Madame de R., vêtue d’une robe de satin rose d’un ton vif et brillant, vient de s’asseoir dans les plis splendides de la riche étoffe qui bouffe encore ; un des ses coudes s’appuie sur son genou ; sa main droite joue négligemment avec un éventail fermé ; la gauche, demi repliée, effleure presque son menton. L’œil brille éclairé par une répartie prête à jaillir de ses lèvres. C’est une conversation spirituelle, commencée dans la salle de bal ou au souper, qui se continue ; on entendrait presque ce que dit l’interlocuteur hors du cadre.
La coiffure se compose d’un béret de velours noir qu’accompagne gracieusement une plume blanche. — Cet Athénien de la rue Mazarine a eu la coquetterie de mettre son grand goût au service du journal des modes, et ce béret, que signerait Mme Baudrand, est, malgré son exactitude, du plus beau style grec.
Lorsque le temps aura passé sa patine sur cet admirable portrait, il sera aussi beau de couleur qu’un Titien. Dès à présent, il a une vigueur et un éclat de ton que n’atteindraient que difficilement les coloristes les plus vivaces de notre école.
Jamais M. Ingres n’a fait rien de plus simplement hardi, de plus vivant, de plus moderne ; dégager le beau au milieu où l’on plonge est un des plus grands efforts de l’art.
Un autre portrait, encore à l’état d’ébauche, surprend par la fierté de l’ébauche et la suprême majesté de l’attitude. Cette femme impériale et junonienne a été sculptée en quelques coups de pinceau dans cette toile blanche qui ressemble à du marbre de Carrare.
Mais quand M. Ingres le terminera-t-il, lui qui attend, hôte respectueux, que l’inspiration vienne le visiter sans l’aller chercher si elle tarde à venir, de peur de la contraindre, cette belle vierge hautaine à qui les artistes convulsifs de notre époque précipitée ont si souvent fait violence ?
Non loin de ce portrait, une répétition de la Stratonice sur des dimensions plus grandes et avec quelques variantes attend la suprême touche. Rien n’est fini, et le tout le serait dans un jour. Il n’y a plus que l’épiderme et la fleur à poser.
La Presse, « Galerie du Luxembourg », 2 septembre 1850
Un homme, dont la volonté, l’ardent amour du beau, le goût pur, équivalent au génie, s’ils ne sont pas le génie lui-même, est l’auteur du Saint Symphorien et du Plafond d’Homère. Tout le monde a nommé M. Ingres. Disciple fervent, fanatique exclusif de Raphaël et de l’antiquité, Ingres a conquis dans l’art contemporain une importance que nul ne saurait lui contester. Son Saint Pierre, que nous retrouvons au Luxembourg, a longtemps figuré dans l’église de Saint-Louis-des-Français, à Rome. C’est un tableau de goût sévère, d’un grand style et d’une rare noblesse. Les figures des apôtres sont exécutées avec beaucoup de fermeté. Les fonds sont d’une grande beauté et d’une couleur admirable, qualité un peu trop rare chez ce maître. La critique ne saurait guère s’attaquer qu’au type un peu lourd de la tête du Christ, à un peu trop de complication dans les plis de son manteau bleu, dont le jet d’une si belle tournure ne saurait que gagner à être plus simple. Il y a bien encore un lambeau de personnage, un profil coupé par le cadre, à droite, d’une façon puérile. Mais ces légers défauts ne nuisent que bien peu à l’effet produit par cette belle composition.
L’Angélique délivrée par Roger est une délicieuse étude de femme comme le maître seul pouvait la faire. Le chevalier revêtu de son armure d’or est copié de l’Arioste trait pour trait : les monstres seuls, l’Hippogriffe et surtout l’Orque, nous paraissent admirablement rendus, d’une composition un peu grotesque.
Dans le portrait de Cherubini, la tête du vieux compositeur florentin, morose, concentrée et savante, est un admirable chef-d’œuvre, et la muse qui l’inspire a tout le charme étrange d’un portrait fait textuellement d’après une belle personne dont les traits s’écartent parfois des types préconçus et des poncifs académiques.
La Presse, « Salon de 1850-51 – Réflexions préliminaires », 5 février 1851
Arrivant d’Italie, où nous avons passé trois mois dans la familiarité des chefs-d’œuvre, ivre encore de beauté et sous le vertige de l’admiration, au sortir de la tribune de Florence et de la chapelle Sixtine, ce n’était pas sans quelque appréhension que nous avons mis le pied dans ces salles peuplées des œuvres de nos peintres vivans.
Certes, nous ne sommes pas de ceux qui chantent le perpétuel hosannah des morts et qui n’admettent pas le génie qu’à trois cents ans en arrière. Personne cependant n’admire plus que nous les gloires du passé ; mais, tout en mettant des couronnes sur les tombeaux, nous en réservons pour les fronts qu’illuminent encore les rayons de la vie. Néanmoins, nous redoutions d’éprouver un effet défavorable en comparant l’Italie de la Renaissance à la France moderne, et de tirer de ce parallèle une conclusion désespérante, celle de la décadence des arts.
Rien ne nous aurait attristé davantage, car nous sommes fier du siècle auquel nous appartenons. Parvenu d’hier à sa moitié, il offre, dans la guerre, la politique, l’industrie, la science, la poésie, la littérature, des noms que ne peut éclipser aucun éclat et qui seront l’honneur éternel du genre humain. Il a fait des découvertes merveilleuses qui rendent mesquins les prodiges de la féerie : la lumière, l’électricité, la vapeur, servent l’homme comme d’humble esclaves ; le temps et l’espace sont supprimés. À toutes ces supériorités, il eût été désastreux que l’art eût tant de défauts. Nous avons été bien vite rassuré par une promenade rapide dans ces nombreuses salles trop étroites encore pour la foule des talens. L’art du dix-neuvième siècle est digne de lui.
Nous ne voulons pas dire par là que ce tumulte de tableaux admis presque sans choix soit égal à ce lent amoncellement de chefs-d’œuvre de peintres d’écoles et d’époques différentes dont sont formées les grandes galeries italiennes, — assurément non ; mais si le génie éteint de la peinture revit quelque part sans aucune contestation, c’est en France.
La physionomie générale de l’exposition est très intéressante ; les diverses tendances de l’art s’y lisent visiblement, et ces tendances sont bonnes. Il y a quelque vingt ans, la nécessité d’en finir avec les traditions académiques et pseudo-grecques qui ont produit les belles choses que vous savez, et dont on peut voir les échantillons à la galerie du Luxembourg, amena un 93 pittoresque ; une révolution éclata : la Barque du Dante, le Massacre de Scio, d’Eugène Delacroix, le Mazeppa, de Boulanger, la Naissance d’Henri IV, d’Eugène Devéria, les Femmes Souliotes, d’Ary Scheffer firent entrer la peinture dans une voie nouvelle.
Bientôt à côté de cette Montagne se forma une Gironde.
Ingres, peu connu jusqu’à alors, quoiqu’il eut atteint depuis longtemps la maturité de son génie, devint le chef d’un école nombreuse, qui prit pour mot d’ordre l’Œdipe ; l’Odalisque, le Portrait de M. Bertin de Vaux, le Martyre de saint Symphorien, œuvres toutes différentes en apparence de celles de l’école rivale, mais qui cependant s’y rattachaient par un lien secret, le retour au grand art du seizième siècle et à l’étude plus exacte de la nature. Il y eu donc deux camps parfaitement distincts : le camp des coloristes et celui des dessinateurs ; mais la critique ne s’y méprit pas, et, à l’étonnement de la foule déroutée par des sujets grecs et une grande sévérité de lignes, ce furent les romantiques qui exaltèrent principalement M. Ingres, trop étrusque, trop austère et trop primitif pour les classiques d’alors.
La division se maintint très sensible encore jusqu’à la révolution de Février. Autour de Delacroix, sans compromettre pour cela leur originalité propre, se groupaient Decamps, L. Boulanger, E. Devéria, disparu trop tôt de la lutte, les Leleux et leur bande, Isabey, et d’autres, dont ceux-ci suffisent pour indiquer la nuance. Quant à Scheffer, à son grand détriment, depuis Eberhard le larmoyeur, il avait passé à l’ennemi. Autour d’Ingres s’étageaient Amaury Duval, Ziegler, Flandrin, Chassériau, Lehmann, Papety, Mottez ; chaque école avait ses paysagistes : Flers, Cabat, Jules Dupré, Rousseau, d’une part ; de l’autre, Aligny, Édouard Bertin, Corot ; ses sculpteurs : David (d’Angers), Antonin Moine, Auguste Préault, Barye et plus tard Clésinger pour les coloristes ; pour les dessinateurs, Pradier, Simart, Duret et beaucoup d’autres, la statuaire étant un art plus volontiers immobile.
Paul Delaroche n’exposait plus ; son talent éclectique ne convenait pas aux violens enthousiasmes de cette époque. Casimir Delavigne de la peinture, il avait le défaut d’être trop classique pour les romantiques et trop romantique pour les classiques. Il a eu peu d’influence sur la période qui vient de se fermer. Ingres et Delacroix, si absolus, si tranchés chacun dans sa manière, caractérisaient nettement une doctrine exclusive. Dans l’art agité et passionné de ce temps-là, ils ont eu tous deux leurs fanatiques qui conservent encore leur religion. Après l’apaisement des anciennes fureurs, l’école de Delaroche commença à se faire jour. La foi diminuait, l’art modéré devenait à la mode et les jeunes gens hésitaient à se déclarer flamboyans ou grisâtres, admettaient de moyens termes ; quelques œuvres sages assez dessinées, assez colorées parurent. Un tiers parti se formait peu nombreux encore, lorsque Février arriva avec son exposition effrénée et grotesque, une vraie saturnale de formes et de couleurs où le public, au moyen de dérisoires couronnes de paille, fit admirablement l’office du jury renvoyé.
L’exposition de 1849, faite dans les conditions les plus désastreuses, fut un noble et touchant effort de l’art qui voulut prouver que les agitations n’altéraient en rien sa sérénité.
Celle de 1850-51 est une des plus considérables que l’on ait jamais vues et dément cette vieille idée : » L’art ne peut fleurir que sous les monarchies « , maxime déjà démontrée fausse par les Républiques de Grèce et d’Italie, qui toutes ont enfanté des myriades de chefs-d’œuvre.
Les divisions que nous avons indiquées tout à l’heure n’existent plus. Ingres et Delacroix ont licencié leurs troupes ; dessinateurs et coloristes se sont réconciliés, ou plutôt chacun cherche fortune sans ce soucier de ce que fait l’autre. L’individualisme domine ; il devient extrêmement difficile de classer les talens par écoles ou par genre ; les gloires anciennes ne se sont pas éteintes, mais elles brillent d’un éclat moins distinct, car le fond général est plus lumineux ; le talent se démocratise en ce sens qu’il est le partage d’un grand nombre, au lieu de se limiter comme autrefois dans une dizaine de noms. Jadis trois ou quatre tableaux, souvent moins, avaient les honneurs du Salon et se détachaient avec une incontestable supériorité. Aujourd’hui, il serait difficile de dire quelle est la perle de L’Exposition. Vingt toiles pourraient être citées à titres différens avec des mérites égaux.
La peinture historique proprement dite a disparu presque complètement, et de ce côté la tradition est rompue : à peine cinq ou six tableaux représentent-ils ce qu’on entendait par ce mot il y a quelques années. Les sujets de religion sont peu nombreux, médiocrement traités pour la plupart, et représentent sans doute des commandes. Un vague sentiment panthéiste semble inspirer ces œuvres si diverses et si contraires ; tout est traité avec la même importance, l’homme, l’animal, le paysage, les fleurs, la nature morte. Le sujet dont on s’inquiétait beaucoup a perdu de sa valeur ; la représentation pure et simple de la nature paraît un thème suffisant. En même temps que panthéiste, l’art s’est fait vagabond : l’Orient, l’Inde, l’Amérique sont parcourus dans tous les sens ; l’Afrique est devenue le Fontainebleau des paysagistes ; le peau-rouge coudoie le Bédouin, l’éléphant balance sa tour à côté du dromadaire ; le palmier mêle ses feuilles en éventail aux feuilles dentelées des chênes du Bas-Bréau ; le marabout arrondit son dôme blanc à deux pas d’une chaumière au toit moussu : c’est la diversité la plus imprévue et la plus charmante.
Pour les personnages, il y en a de tous les temps et de toutes les classes ; rien n’est exclu : pas même les dieux et les déesses mythologiques qui s’étaient réfugiés dans leurs nuages, effrayés par les souliers à la poulaine, les surcots blasonnés et les dagues de Tolède, et il est impossible de constater une préférence pour une époque, pour un pays ou pour un ordre de sujets. Histoire, roman, poème, légende, on a puisé partout, selon le goût ou la fantaisie. Le Salon de 1850-51 n’est ni historique, ni religieux, ni mythologique, ni révolutionnaire, ni classique, ni romantique, il est individuel et panthéiste. Chaque artiste croit à la nature et à son talent. Les maîtres sont étudiés, non dans leur esprit, mais dans leurs procédés. L’on cherche chez eux les moyens d’écrire sa propre pensée et on les consulte comme des dictionnaires et des manuels de recettes pittoresques. On leur emprunte une manière de glacer ou d’empâter, sans les imiter pour cela. Aussi, jamais l’habileté d’exécution n’a-t-elle été poussée plus lion. On peint aussi bien à Paris qu’à Venise, dans le siècle d’or, en bornant ce mot à son sens rigoureux. Pour la pratique, l’art n’a plus rien à apprendre.
À travers cette diffusion générale, on voit poindre une école réaliste démocratique, pour qui les Paysans, de Leleux, sont des aristocrates ; cette école, ou plutôt ce système, prêche la représentation exacte de la nature dans toute sa trivialité, sans choix ni arrangement, avec la fidélité difforme du daguerréotype. Nous discuterons plus loin ce programme, qui a des chances de rallier bien des fantaisies errantes et des vocations incertaines, par cela même qu’il est absolu. C’est quelque chose dans une époque troublée et qui ne cherche qu’une théorie nette et carrée.
En face de ces talens si divers, si nombreux, de cette habilité prodigieuse, on s’étonne du peu de parti que l’on tire de tant de merveilleux artistes ; il semble que nos églises, nos palais, nos monumens, devraient être couverts de peintures de haut en bas. Il n’en est rien. Qu’il serait facile pourtant avec ces mains si alertes et si savantes, qui peignent tous les cinq ou six mille tableaux sans destination, de faire de Paris une Venise, une Florence et une Rome ! Il ne devrait pas y avoir, dans un édifice public ou dans une maison riche, un pouce de muraille qui ne fût peint ou sculpté ; le malheur de l’art en France, c’est qu’il n’est pas admis dans la vie universelle, et reste une superfluité au lieu d’être une nécessité. Il faudrait cependant arriver à le mêler à toute chose, et ce serait facile si les artistes étaient un peu moins dédaigneux. Giorgione et Titien ont décoré de fresques des façades de maisons sur le grand canal, et si un bourgeois de Paris allait proposer à un de nos artistes en renom de lui peindre les murs extérieurs de son hôtel, celui-ci trouverait peut-être la proposition incongrue.
N’est-il pas singulier qu’il n’existe pas à Paris, cette ville si riche et si splendide, une seule façade sculptée par Pradier, Simart, Clésinger, Lechesne ou Préault ; pas une chambre peinte par Ingres, Delacroix, Gérôme, Decamps ou Diaz, lorsque les possesseurs d’hôtels dépensent en tentures, dorures, tarabiscotages, chinoiseries et autres luxes bêtes des sommes ridiculement énormes ?
Sous une République, il faut que les particuliers s’inquiètent de l’art et le fassent vivre. Dans ces dernières années, on se reposait un peu de ce soin sur la liste civile et le ministère de l’Intérieur. Les artistes, eux-mêmes, y comptant trop, et sûrs de quelques commandes, ne cherchaient point d’autres applications de leur talent : les mœurs nouvelles et les développements des inventions modernes nécessiteront des travaux imprévus. — Il serait bon aussi que les gens riches, qui font des collections de vieux tableaux, se convainquissent de cette vérité, qu’il n’existe plus, hors des galeries royales ou princières, un seul tableau de maître authentique. Chaque original a trois ou quatre doubles nécessairement faux ; ce qu’ils achètent si cher, ce sont des copies anciennes ou des copies modernes, habilement enfumées. Avec la moitié de l’argent qu’ils dépensent ainsi, ils auraient un nombre de tableaux charmans, d’un authenticité incontestable, d’un mérite au moins égal, et feraient vivre une foule de jeunes artistes qui ne demandent qu’un peu d’aide pour devenir de grands maîtres, s’ils ne le sont déjà. — Ces réflexions faites et ces conseils donnés, entrons dans la salle qui représente ici le salon carré du Louvre, et commençons notre appréciation.
Le Moniteur Universel, « L’Apothéose de Napoléon – Plafond de M. Ingres », 4 février 1854
Le plafond d’Homère a son pendant, et l’Hôtel de ville ne pourra désormais rien envier au Louvre. Homère, Napoléon, le plus grand poète antique, le plus illustre guerrier moderne, transfigurés, divinisés, élevés au milieu des auréoles de l’apothéose, dans le ciel des immortalités ! M. Ingres seul, peut-être, aux deux bouts de sa carrière, était capable d’accomplir ce prodige de génie, d’art et de science. Toute l’inspiration de la jeunesse bouillonne encore sous les cheveux noirs du peintre que l’âge n’a pas osé blanchir et qui promet la séculaire et féconde vieillesse du Titien. Jamais sa composition n’a été plus hardie, son style plus grand, son pinceau plus ferme. L’Apothéose de Napoléon est le chef-d’œuvre de l’artiste et fera dans la postérité honneur à notre siècle.
Nul, à notre époque si troublée de systèmes divers, n’a conservé au même degré la religion du beau que M. Ingres ; sa foi est restée inaltérable ; le flambeau que la Grèce avait passé à l’Italie et Phidias à Raphaël a toujours brillé entre ses mains d’un éclat égal sans vaciller à aucun souffle : il le transmettra aux générations de l’avenir aussi lumineux qu’il l’a reçu. Le pur et noble idéal de l’antiquité nous est parvenu tout entier par ce glorieux intermédiaire.
M. Ingres a conçu et exécuté comme l’aurait fait un artiste du temps de Périclès ou d’Auguste ce radieux et difficile sujet. — Le plafond destiné à l’Hôtel de ville semble détaché de la pinacothèque des Propylées, où il eût pu figurer parmi les tableaux d’Apelle, de Polygnote, de Parrhasius et d’Euphranor.
Aussi est-ce un pèlerinage continuel à l’atelier du peintre, transformé en sanctuaire de l’art ; l’Empereur et l’Impératrice sont allés visiter cette Apothéose de Napoléon, et tout ce que Paris compte de grand, d’illustre, d’intelligent, s’est honoré comme d’une faveur d’être admis à contempler l’œuvre nouvelle.
Nous allons essayer, en regrettant l’impuissance de la parole, de donner à ceux qui ne l’ont pas vue, une idée de cette composition magnifique.
La toile est de forme ronde, comme pour enfermer dans un cercle d’éternité l’apothéose qu’elle représente. Au sommet du tableau, au-dessus d’un segment de Zodiaque où s’ébauchent vaporeusement les signes du Lion, du Taureau et des Gémeaux, scintille cette étoile qui est devenue un des soleils du ciel de la gloire. Dans le bleu vierge de l’éther roule un char triomphal traîné par un quadrige de chevaux dignes d’être attelés au char d’Apollon, aussi purs de forme, aussi ardents d’allure qu’Aéthon, Eoüs, Phlégon et Pyroïs, et qui semblent, tant ils ont l’air fier et intelligent, doués de la parole humaine comme les coursiers d’Achille. Si leur noble robe n’était dorée de cette historique teinte isabelle des chevaux du sacre, on croirait qu’ils se sont élancés des métopes du Parthénon, au milieu de l’azur tout frémissant encore du ciseau de Phidias ; leurs crinières, droites et comme taillées dans le marbre pentélique, leurs narines roses et fumantes, leurs yeux couleur de violette qu’illumine une lumière d’argent, leurs cols de cygne fins et nerveux où se tord un réseau de veines, leurs poitrails beaux comme des torses de jeunes dieux, leurs pieds aux sabots d’ivoire qui ne se sont jamais usés aux cailloux des sentiers terrestres et qui battent comme des ailes la fluide plaine de l’air, en font une race à part, destinée à transporter du tombeau à l’Olympe les héros divinisés. Le cheval que Neptune fit jaillir du sommet de l’Acropole avec un coup de trident, ne pouvait, assurément, offrir un type d’une beauté plus accomplie : des têtières, des chanfreins et des jugulaires constellés de saphirs, d’émeraudes et de rubis qui ne le cèdent pas en élégance aux plus riches bijoux de femme, composent leur harnais ou plutôt leur ornement, car aucun lien ne les rattache au char entraîné par sa propre impulsion dans leur lumineux sillage. Dédaignant les artifices connus, M. Ingres n’a pas pavé la route de son quadrige aérien de ces lourds nuages blanchâtres, grand chemin des apothéoses vulgaires ; il l’a hardiment lancé en plein éther, où le char étincelant et les blonds coursiers, soutenus par leur propre légèreté, planent aussi aisément que l’aigle qui précède leur vol l’envergure éployée, la foudre entre les serres.
L’Empereur, debout sur le char triomphal, comme un dieu sur un autel d’or, a, dans sa physionomie et dans sa pose, la majesté sereine et la joie tranquille du héros qui prend possession de son immortalité. Son torse nu semble fait de marbre et de lumière, et jamais le ciseau grec n’a sculpté de formes plus pures, plus nobles, plus éternellement jeunes, plus divinement belles. Les misères et les fatigues terrestres ont disparu dans cette radieuse transfiguration. Cette chair, pétrie de pensées et de rayons, ne porte plus aucun stigmate humain, pas même la trace des clous de diamant qui fixaient le Titan au rocher de Saint-Hélène ; quant à la tête, nous ne croyons pas que le pinceau en ait jamais tracé une semblable. C’est la beauté des médailles et des camées, jointes à une expression de génie suprême et de souveraineté irrésistible que l’antiquité ne connut pas. La ressemblance s’allie si intimement à l’idéal, dans cet incomparable morceau, que cette tête, ceinte d’un laurier d’or, qui pourrait être celle de Mars, d’Alexandre ou de César, est le plus frappant et le plus réel portrait de Napoléon.
Le héros tient d’une main le sceptre surmonté d’un aigle, et de l’autre le globe du monde représenté par un saphir transparent comme la boule de la Fortune. Un mouvement aussi hardi que naturel fait chercher à ce bras un point d’appui sur la hanche, et presse contre le flanc la garde d’une épée à poignée romaine qui semble prête à défendre le globe. Ce geste, que M. Ingres seul pouvait risquer avec sa naïve sublimité de style, produit les plus heureuses inflexions de lignes. Le manteau impérial se développe amplement et splendidement derrière le César, et l’un de ses plis voltigeant lui entoure la tête comme d’une auréole de pourpre, nimbe du souverain et du guerrier.
Debout près de lui, sur le char, une Renommée le couronne d’un cercle d’immortelles d’or, et tient abaissé un clairon dont la fanfare est inutile, car tous les échos de la terre renvoient, sans qu’on le leur jette, le nom qu’elle proclamerait. Cette Renommée n’a pas l’attitude protectrice et victorieuse que les peintres donnent ordinairement à ces sortes d’êtres allégoriques ; sa physionomie, sa pose expriment comme un respect filial ; à son air de joie douce et de soumission attendrie, on dirait que le héros est son père, et que c’est avec une certaine crainte pieuse, comme Thétis touchant la barbe de Jupiter, qu’elle place sur ce front majestueux qui d’un froncement de sourcil ébranlait l’univers, le signe et la consécration de l’immortalité. Une tunique d’un vert glauque comme les yeux de Minerve où les ondes de l’Océan caresse les formes virginales de son corps charmant, et laisse nus des bras aussi beaux que ceux de Galatée dans la fresque de la Farnésine ; un caprice délicieux a présidé à l’arrangement de sa coiffure : la rapidité de sa course en fait onduler quelques mèches comme des flammes sur le front d’un génie.
Devant le quadrige, dont les guides se réunissent entre ses mains à la palme et à la couronne, attributs du triomphe, vole une Victoire aux ailes d’azur, d’un jet superbe et d’une incomparable grandeur de style. À la plus pure beauté féminine se mélange l’héroïsme le plus mâle et le plus élevé sur ce visage éclatant comme la gloire, tranquille comme l’éternité. Un peplum d’un jaune pâle voile sa poitrine d’un ton lumineux. Une tunique aux mille petits plis fripée comme la draperie de la Victoire Aptère, flotte jusqu’à ses pieds blancs, où elle bouillonne en écume rose. Cette figure, d’une grâce si fière, d’une élégance si hardie, que ses bras, levés en l’air, feraient nager dans le vide comme deux ailes blanches, à défaut des ailes bleues qui palpitent à ses épaules, égale en beauté, si elle ne les surpasse, l’Iliade et l’Odyssée du plafond d’Homère ; c’est le même style, la même perfection, plus l’élan et la hardiesse aérienne.
Cette belle courrière conduit le char au temple de la Gloire, dont la rotonde à colonnes corinthiennes dessine son architecture splendide dans la vapeur d’or des apothéoses. À travers les entrecolonnements, apparaissent, sur les murs de la cella, des fresques représentant des combats homériques ; ce temple, qui occupe le segment droit du plafond, semble avoir été tracé par Ictinus ou Mnésiclès sur un marbre de l’Acropole.
Nous n’avons encore décrit que la zone supérieure de la composition ; les pages sont composées de phrases successives, tandis que la toile se lit instantanément et d’un seul coup d’œil, et nous ne pouvons présenter les objets qu’un à un.
Au-dessous du groupe triomphal se découpent des crêtes de montagnes bleuâtres ; et plus loin, dans le recul de la perspective, émerge du sein de l’Océan l’écueil volcanique de Sainte-Hélène. C’est de là que s’est élancé le cortège radieux qui aboutit au temple de l’Immortalité, comme s’il fallait partir du malheur pour arriver à la gloire.
Dans la portion inférieure s’élève sur des degrés un trône vide et voilé où s’adosse un aigle fidèle farouche et sévère, descendu là sans doute de la hampe d’un des drapeaux de la vieille garde ; devant le trône, un escabeau d’ivoire et d’or semble attendre le pied impérial. À gauche, la France, soulevant son manteau de deuil semé d’abeilles violettes, lève sa tête éplorée et ravie vers la vision étincelante à qui elle tend les bras. Une courte inscription, tracée sur le velours du tapis : — In nepote redivivus, — explique et complète la pensée de l’artiste. De derrière ce trône jaillit, avec un mouvement d’une violence fulgurante, une figure robuste et terrible, au masque tragiquement crispé, qui n’aurait pas besoin d’avoir écrit en caractères grecs le nom de Némésis sur la bordure rouge de sa tunique blanche pour être reconnue à l’instant par tout le monde. Le bras en raccourci est superbe et digne de Michel-Ange pour la science du dessin et la force de la musculature. Cette apparition subite foudroie du geste un groupe de figures révoltées et furieuses qui rentrent comme de hideuses larves dans un brouillard noir où siffle le serpent de l’anarchie.
La critique ne peut ici que décrire et tâcher de trouver des formules d’admiration dignes de l’œuvre. L’ordonnance merveilleuse de la composition, la sublimité du style, la sérénité éclatante du coloris, l’aspect monumental, enfin les plus hautes qualités de l’art se trouvent réunies dans le plafond de M. Ingres. Tout est choisi, rare, exquis : ornements, bijoux, accessoires. La perfection des détails ne nuit en rien à la grandeur de l’ensemble. Terminons par un vœu timide : pour lui assurer l’éternité relative dont l’homme dispose, nous voudrions voir cette magnifique composition gravée sur une grande agate comme l’apothéose d’Auguste du trésor de la Sainte-Chapelle. Le camée moderne ne craindrait pas la comparaison avec le camée antique.
Le Moniteur Universel, « Peintures murales de Saint-Roch », 4 mars 1854
La plupart de nos vieilles églises, soit que les décorations dont elles étaient ornées au moyen âge eussent disparu sous l’action du temps, soit qu’elles eussent été dévastées par les iconoclastes révolutionnaires, offraient aux yeux le spectacle d’une misère affligeante ; leurs voûtes avaient perdu leurs ciels d’azur étoilés d’or ; le badigeon recouvrait dans les chapelles les ombres à demi effacées des fresques anciennes ; partout la muraille apparaissait froide et pâle ; les temples modernes et les édifices neufs, avec leur blanche crudité, attendaient également un vêtement de peinture. Les artistes sont à l’œuvre, c’est la cause pour laquelle le salon n’est plus tapissé que de tableaux de genre, de paysages et de portraits, sauf quelques rares exceptions. Loin que la grande peinture soit abandonnée, elle est, au contraire, plus cultivée que jamais et dans les meilleures conditions de l’art. Les tableaux d’histoire et de sainteté ne se font plus sur toile, mais sur les murs des monuments et des églises. Si Delacroix n’envoie au salon que de petites toiles, que de rapides ébauches, rayées pourtant de sa griffe léonine, c’est que la chambre des députés, la chambre des pairs, la galerie d’Apollon, le salon de la Paix s’enrichissent de splendides peintures. Flandrin n’a pas exposé, il est vrai, mais allez voir à Saint Vincent-de-Paul l’immense panathénée de saintes et de saints qui se déroule sur une double frise depuis le portail jusqu’à l’hémicycle peint par Picot, sans parler des chapelles de Saint-Severin, du chœur de Saint-Germain-des-Prés et de la basilique néo-byzantine de Nîmes. Si Couture n’a pas fini son tableau des enrôlements volontaires, demandez-en la raison à Saint-Eustache ; vous vous êtes plaint sans doute de ne plus voir de ces fins portraits si ressemblants et si précieux d’Amaury-Duval, il revêt d’une tunique de fresques la nudité de l’église de Saint-Germain-en-Laye ; Lehmann a été absorbé par les peintures de la salle de bal à l’Hotêl-de-Ville, où Riesener, Muller, Landelle, Benouville, Cabanel ont déployé sur une plus grande échelle leurs aptitudes diverses. — Perrin finit à Notre-Dame-de-Lorette une admirable chapelle du plus haut style religieux. — M. Ingres, s’il ne fait plus l’Œdipe, ni l’Odalisque, ni le portrait de M. Bertin de Vaux, peint l’apothéose de Napoléon.
Le Moniteur Universel, « Exposition universelle de 1855″, 12 & 14 juillet 1855
Le premier nom qui se présente à la pensée lorsqu’on aborde l’école française est celui de M. Ingres. Toutes les revues du Salon, quelle que soit l’opinion du critique, commencent invariablement par lui : en effet, il est impossible de ne pas l’asseoir au sommet de l’art, sur ce trône d’or à marchepied d’ivoire où siègent couronnées de lauriers les gloires accomplies et mûres pour l’immortalité. L’épithète de souverain, que Dante donne à Homère, sied également à M. Ingres, et les jeunes générations que traverse sa vieillesse radieuse la lui ont décernée. D’abord nié, longtemps obscur, mais persistant dans sa voie avec une constance admirable, M. Ingres est aujourd’hui arrivé à la place où la postérité le mettra, à côté des grands maîtres du seizième siècle, dont il semble, après trois cents ans, avoir recueilli l’âme : noble vie à prendre pour exemple, et que l’art remplit tout entière, sans une distraction, sans une défaillance, sans un doute ! Enfermé volontairement au fond du sanctuaire dont il avait muré sur lui la porte, l’auteur de l’Apothéose d’Homère, du Saint Symphorien, du Vœu de Louis XIII, a vécu dans l’extatique contemplation du beau, à genoux devant Phidias et Raphaël, ses dieux ; pur, austère, fervent, méditant, et produisant à loisir les œuvres témoignages de sa foi. Seul, il représente maintenant les hautes traditions de l’histoire, de l’idéal et du style ; à cause de cela, on lui a reproché de ne pas s’inspirer de l’esprit moderne, de ne pas voir ce qui se passait autour de lui, de n’être pas de son temps, enfin. Jamais accusation ne fut plus juste. Non, il n’est pas de son temps, mais il est éternel. — Sa sphère est celle où se meuvent les personnifications de la beauté suprême, l’éther transparent et bleu que respirent les sibylles de la Sixtine, les muses du Vatican et les Victoires du Parthénon.
Loin de nous l’intention de blâmer les artistes qui se pénètrent des passions contemporaines et s’enfièvrent des idées qu’agite leur époque. Il y a, dans la vie générale où chacun trempe plus ou moins, un côté ému et palpitant que l’art a le droit de formuler et dont il peut tirer des œuvres magnifiques ; mais nous préférons la beauté absolue et pure, qui est de tous les temps, de tous les pays, de tous les cultes, et réunit dans une communion admirative le passé, le présent et l’avenir.
Cet art, qui n’emprunte rien à l’accident, insoucieux des modes du jour et des préoccupations passagères, paraît froid, nous le savons, aux esprits inquiets, et n’intéresse pas la foule, incapable de comprendre les synthèses et les généralisations. C’est cependant le grand art, l’art immortel et le plus noble effort de l’âme humaine : ainsi l’entendirent les Grecs, ces maîtres divins dont il faut adorer la trace à genoux. — L’honneur de M. Ingres sera d’avoir repris ce flambeau que l’antiquité tendit à la Renaissance, et de ne pas l’avoir laissé éteindre lorsque tant de bouches soufflaient dessus, dans les meilleures intentions du monde, il faut le dire.
Notre admiration pour M. Ingres date de loin ; nous avons déjà loué comme ils méritent la plupart des tableaux de cette exposition, où, abjurant toute bouderie d’amour-propre, l’illustre peintre a répondu généreusement à l’appel de la France, et laissé voir à tous les chefs-d’œuvre qu’il ne montrait qu’à un petit nombre d’amis ; nous sommes heureux de les trouver réunis, et d’exprimer encore une fois l’impression qu’ils nous ont produite, et que le temps n’a fait que confirmer.
Commençons par l’Apothéose d’Homère, — ab Jove principium. — L’apothéose d’Homère, comme chacun le sait, servait de plafond à une des salles du musée Charles X, et dieu sait combien de torticolis nous avons gagnés en la contemplant : nous pouvons l’admirer maintenant à notre aise redressée contre un mur, ce qui est sa vraie position, car la composition entendue avec la placidité sereine d’un bas-relief antique ne plafonne pas du tout.
Nous ne croyons pas, après avoir visité toutes les galeries du monde, que l’Apothéose d’Homère redoute la comparaison avec un tableau quel qu’il soit. Si quelque chose peut donner l’idée de la peinture des Appelle, des Euphranor, des Zeuxis, des Parrhasius, telle que les témoignages des anciens nous la retracent, c’est assurément l’Apothéose d’Homère. En retranchant les personnages modernes qui garnissent le bas du tableau, elle eût pu, ce nous semble, figurer dans la pinacothèque des Propylées, parmi les chefs-d’œuvre antiques.
Devant le péristyle d’un temple dont l’ordre ionique rappelle symboliquement la patrie du Mélésigène, Homère déifié est assis avec le calme et la majesté d’un Jupiter aveugle ; sa pose immobile indique la cécité, quand même ses yeux blancs comme ceux d’une statue ne diraient pas que le divin poëte ne voit plus qu’avec le regard de l’âme les merveilles de la création qu’il a retracées si splendidement. Un cercle d’or ceint ses larges tempes, pleines de pensées ; son corps, modelé par robustes méplats, n’a rien des misères de la caducité ; il est antique et non vieux : l’âge n’a plus de prise sur lui, et sa chair s’est durcie pour l’éternité dans le marbre éthéré de l’apothéose. D’un ciel d’azur que découpe le fronton du temple, et que dorent comme des rayons de gloire quelques zones de lumière orangée, descend dans le nuage d’une draperie rose une belle vierge tenant la palme et la couronne. Aux pieds d’Homère, sur les marches du temple, sont campées dans des attitudes héroïques et superbes ses deux immortelles filles, l’Iliade et l’Odyssée : l’Iliade, altière, regardant de face, vêtue de rouge et tenant l’épée de bronze d’Achille ; l’Odyssée, rêveuse, drapée d’un manteau vert de mer, ne se montrant que de profil, sondant de son regard l’infini des horizons et s’appuyant sur la rame d’Ulysse : — l’action et le voyage !
Ces deux figures, d’une incomparable beauté, sont dignes des poëmes qu’elles symbolisent; quel éloge en faire après celui-là !
Autour du poëte suprême se presse respectueusement une foule illustre : Hérodote, le père de l’histoire, jette l’encens sur les charbons du trépied, rendant hommage au chantre des temps héroïques ; Eschyle montre la liste de ses tragédies ; Apelles conduit Raphaël par la main ; Virgile amène Dante, puis viennent Tasse, Corneille, Poussin, coupés à mi-corps par la toile ; de l’autre côté, Pindare s’avance, touchant sa grande lyre d’ivoire ; Platon cause avec Socrate ; Phidias offre le maillet et le ciseau qui ont tant de fois taillé les dieux d’Homère ; Alexandre présente la cassette d’or où il renfermait les œuvres du poëte. Plus bas s’étagent, en descendant vers l’âge moderne, Camoëns, Racine, Molière, Fénelon, rattaché au chantre de l’Odyssée par son Télémaque.
Il règne dans la portion supérieure du tableau une sérénité lumineuse, une atmosphère élyséenne argentée et bleue, d’un douceur infinie ; les tons réels s’y éteignent comme trop grossiers, et s’y fondent en nuances tendres, idéales. Ce n’est pas le soleil des vivants qui éclaire les objets dans cette régions sublime, mais l’aurore de l’immortalité ; les premiers plans, plus rapprochés de notre époque, sont d’une couleur plus robuste et plus chaude. Si Alexandre, avec son casque, sa cuirasse et ses cnémides d’or, semble l’ombre d’une statue de Lysippe, Molière est vrai comme un portrait d’Hyacinthe Rigaud.
Quel style noble et pur ! quelle ordonnance majestueuse ! quel goût véritablement antique ! Dans ce tableau sans rival, l’art de Phidias et d’Apelles est retrouvé.
Si l’Apothéose d’Homère est exclusivement grecque, le Martyre de saint Symphorien, comme l’Incendie du bourg de Raphaël, semble indiquer une certaine préoccupation de Michel-Ange. M. Ingres s’est dit sans doute : Ce n’est pas assez d’avoir la composition simple, la forme correcte, le contour précis ; il faut montrer que l’on est capable de ces outrances anatomiques tant admirées, qui amènent les muscles à la peau et font de l’homme vivant un écorché d’amphithéâtre ; et il a rassemblé dans son tableau tous les tours de force de dessin imaginables ; depuis le Jugement dernier de la Sixtine, on n’a rien vu de si vivant, de si fort, de si robuste : — C’est le nec plus ultra du style et de l’art. Pour le vulgaire, il trouvera sans doute ces musculatures exagérées, et comparant son bras chétif aux bras de ces licteurs athlétiques, il s’étonnera de la différence, ne sachant pas que l’art n’a pas pour but de rendre la nature, et s’en sert seulement comme moyen d’expression d’un idéal intime. Si forts que soient les géants de Michel-Ange, ils ne traduisent pas encore toute l’énergie secrète de sa pensée.
Mais il n’y a pas dans le Saint Symphorien que des contractions de muscles et des difficultés de dessin vaincues ; la figure du martyr est une des plus sublimes que la peinture ait fixées sur la toile, et au milieu de ce déploiement de force physique, parmi ces torses montueux, ces membres pleins de nodosités, la force morale resplendit svelte et pure en son éclat immatériel ; le jeune saint aux bras de femme, à la figure imberbe et pâle, l’emporte de tout l’ascendant de l’âme sur ce préteur, sur ces licteurs, sur ces victimaires, sur ces bourreaux à physionomies bestiales, à tournures d’Hercule, basanés par le grand air et l’action. — Voilà pourquoi ils tendent leurs nerfs, crispent leur grand trocanter et font renfler leurs biceps ; ils se sentent vaincus, et aussi le préteur risque un effroyable raccourci, impossible à tout autre qu’à M. Ingres, pour ordonner du doigt qu’on emmène ce faible adolescent qui les écrase tous.
Quel admirable geste dans sa sainte violence, que celui de la mère se penchant hors des créneaux et, du haut des remparts, poussant au martyre le fils de ses entrailles ! La chrétienne, chez elle, a tué la mère ; on voit qu’elle a hâte de jeter son fils au Christ, qui est mort pour nous, et qu’elle trouve les bourreaux trop lents ; chaque minute de retard est une éternité de bonheur en moins.
La couleur de ce tableau a été critiquée à sa première apparition, bien à tort selon nous ; elle est mate, sobre, magistrale, avec ces tons neutres de la fresque laissant prévaloir la pensée et le style : et même dans l’acception vulgaire qu’on donne au mot couleur, connaissez-vous quelque chose de plus fin, de plus suave, de plus tendre que les pieds, les mains, les bras et la tête du saint Symphorien, et que cette draperie d’un jet si noble, d’une blancheur si pure, qu’il pourra la garder au ciel, devant le trône de Dieu, parmi les élus ? — Et le jeune garçon qui se penche pour ramasser une pierre, et la femme qui presse son enfant contre son cœur et l’enveloppe de ses bras, comme si on voulait le lui arracher, ne sont-ils pas merveilleusement modelés et peints ?
Le Vœu de Louis XIII a été popularisé par la belle gravure de Calamatta ; il est donc inutile de le décrire ici en détail. — Avec quelle céleste smorfia et quelle dignité protectrice la sainte Vierge accueille l’offre que le roi de France lui fait de son royaume, comme s’il n’était pas déjà à elle ! — Depuis Raphaël aucun peintre n’avait peint une madone si belle, si fière, si chaste et pourtant si douce. La Madone de Saint-Sixte, la Vierge à la Chaise, la Vierge au Poisson, l’admettraient pour leur sœur, et leurs enfants Jésus joueraient avec celui qu’elle tient debout sur ses genoux divins.
Le Louis XIII vu de dos, inondant du velours fleurdelisé de son manteau royal le premier plan du tableau et ne montrant qu’en profil perdu cette tête pâle et caractéristique, à la moustache et à la mouche noires ; les grands anges relevant les courtines pour mieux laisser voir l’apparition céleste ; les petits séraphins supportant le cartouche où est inscrit le vœu, sont dessinées et peints de main de maître. — Si le style se perdait, c’est là qu’il faudrait l’aller chercher.
L’Œdipe devinant l’énigme du sphinx semble avoir été peint par un artiste grec de l’école de Sicyone, tellement un pur sentiment d’antiquité y respire ; ce n’est pas de l’archaïsme, c’est de la résurrection. Certes, c’est bien ainsi qu’il s’est posé, le beau et fier jeune homme, ses deux lances de cuivre à la main et son chapeau de voyage rejeté sur les épaules, devant le monstre sournois à tête et à gorge de vierge, à ailes d’épervier et à croupe de lionne, qui le regarde d’un œil oblique et, l’énigme proposée, lève déjà sa patte griffue ! Il a trouvé le mot ; il va répondre ; ses lèvres s’ouvrent, et le sphinx, vaincu, n’a plus qu’à se précipiter de son rocher ; des pieds pâles, des ossements et des crânes apparaissent vaguement dans la gueule noire de la caverne et montrent le danger couru par les voyageurs à qui leur mauvaise fortune faisait prendre ce chemin funeste. L’Œdipe est devenu avec le temps d’une couleur superbe ; on dirait un Giorgione à voir ses chairs blondes se détacher d’un fond d’outremer sous cette chaude patine que les années donnent souvent aux œuvres des dessinateurs, tandis qu’elles carbonisent celles des coloristes.
Nous ne connaissions pas le portrait en pied de Napoléon premier consul, qui appartient à la ville de Liège ; c’est une œuvre d’un singulier intérêt historique. Le premier consul est en costume officiel : habit à collet carré, culotte courte en velours nacarat, bas de soie blancs, souliers à boucles ; la tête fine, maigre, jaune, consumée de génie, presque maladive, diffère beaucoup du masque impérial, tel qu’il est moulé dans toutes les mémoires, et se rapproche de ce portrait célèbre du premier consul se promenant dans les jardins de la Malmaison, par Isabey, dont on rencontrait encore quelquefois, il y a dix ans, la gravure, devenue rare. Ce costume de velours cerise, brodé d’or, rendu avec l’exactitude austère que M. Ingres met à tout ce qu’il fait, est d’une audace de ton à effrayer les plus hardis, et, par son intensité, fait ressortir les tons d’ivoire de la tête et des mains, admirablement belles.
Nous avons ici même rendu compte de l’Apothéose de Napoléon. Ce serait de l’amour-propre de croire que les lecteurs du Moniteur universel s’en souviennent, et cependant nous éprouvons quelque embarras à répéter ce que nous avons dit. — Nous nous bornerons à faire une rapide esquisse du tableau détaché du plafond de l’Hôtel de ville, dont il orne une des salles.
M. Ingres a conçu son sujet avec une simplicité antique, comme si à Rome un artiste grec eût été chargé de faire en camée l’apothéose d’un César ; il a mis Napoléon déifié sur un quadrige, qu’une Victoire ailée conduit au temple de la Gloire ; près de lui une jeune Renommée le couronne ; au-dessus de sa tête plane l’aigle sacrée ; au fond, sur un horizon de mer bleue, se dessine la sombre silhouette d’une île ; à l’autre bout de la carrière rayonne le temple étincelant d’or et de lumière ; au bas de la composition figure un trône vide, et la France éplorée tend les mains vers l’apparition radieuse ; Némésis s’élance et terrasse l’Anarchie.
Cet Empereur nu dans sa pourpre comme un Olympien, ce char d’or aux roues tourbillonnantes, ces quatre chevaux divins habitués à fouler le bleu pavé du ciel, et fiers comme s’ils étaient détachés des frises du Parthénon, cette Victoire aussi noble que celle qui délie sa sandale sur le bas-relief du temple de la Victoire Aptère, quel maître de Grèce, de Rome ou de Florence n’eût été orgueilleux de les avoir conçus et réalisés avec ce style si pur et cette beauté suprême ?
La Vénus Anadyomène est peut-être la figure que le peintre a caressée le plus amoureusement ; commencé dans sa jeunesse, il l’a quittée, reprise, comme on fait d’une maîtresse adorée, et voilà quelques années à peine qu’il s’en est séparé en faveur de M. Reiset. Jamais, ni dans l’ivoire de l’Inde, ni dans le marbre de Paros, ni sur le bois, ni sur la toile, l’art n’a représenté un corps plus virginalement nu, plus idéalement jeune, plus divinement beau ; des blonds cheveux tordus roulent quelques perles amères sur le sein déjà rosé par l’émotion de la vie, tandis que les pieds blancs comme l’écume argentée de la vague gardent encore la pâleur froide de la chair humide ; de petits Amours, dansant sur le bout des flots, présentent à la déesse nouvelle un miroir de métal poli ; après s’y être regardée, elle sera femme tout à fait ; elle aura conscience de sa beauté.
Quelle charmante fantaisie que le Roger délivrant Angélique ! Nous doutons que l’Arioste ait jamais été mieux traduit : est-il beau et chevaleresque le Roger dans son armure d’or, ajustant sa lance, le coude en saillie, comme un saint Michel gothique terrassant le dragon sous un porche de cathédrale ! Rarement le sens intime du moyen âge a été mieux compris ; l’Hippogriffe au bec de griffon, aux ailes d’aigle, à la croupe de cheval, ouvre ses serres comme un chimérique animal du blason grimpant après un écu, avec une impossibilité vraisemblable, une bizarrerie romantique qu’on n’attendrait pas d’un talent aussi sérieux que celui de M. Ingres ; quant à l’Angélique, c’est la figure la plus suave, la plus délicieuse dans sa chaste pâleur nacrée, que puisse rêver une imagination amoureuse du beau. Le caractère est tout différent de celui de la Vénus Anadyomène, quoique toutes deux soient des femmes nues baignant leurs pieds d’argent dans la mousse du flot ; Angélique n’est pas une statue qui vit, c’est une femme, et une femme moderne ; on le sent à nous ne savons quoi de plus fin, de plus élancé, et pourquoi ne pas le dire, quoique le mot arrive singulièrement ici, de plus chrétien. Comme elle renverse son cou de cygne, un peu trop long peut-être, comme elle répand la cascade blonde de ses cheveux, comme elle lève au ciel ses yeux d’un azur tendre !
Nous pouvons compter au nombre des tableaux d’histoire un petit tableau traité en esquisse et représentant Jupiter et Antiope, chaud et coloré comme un Titien, dont il a tout l’aspect. — Le corps de l’Antiope est charmant ; — on y devine la tiédeur et le souffle de la vie. M. Ingres possède presque seul, parmi les peintres modernes, le don de peindre les femmes et de les faire belles, en évitant le joli, écueil des artistes qui cherchent la grâce.
Notre-Seigneur remettant à saint Pierre les clefs du paradis en présence des apôtres ornait autrefois l’église de la Trinité-du-Mont, à Rome, où une copie le remplace. C’est un tableau d’un style sévère, qui rappelle les cartons d’Hampton-Court ; les draperies sont largement agencées, les têtes ont un caractère énergique et robuste, comme il convient à des pêcheurs d’hommes qui vont jeter le filet sur l’univers pour ramener des âmes. Le saint Pierre est superbe, et le Christ ne pouvait mieux choisir la pierre sur laquelle devait s’élever un jour l’édifice immense du catholicisme ; les clefs qui plus tard se croiseront sur l’écusson papal sont bien à leur place, dans ces mains musculeuses et basanées. La tête du Christ mêle au type traditionnel le sentiment particulier de l’artiste ; c’est ainsi que les maîtres savent être neufs en traitant des sujets en apparence usés. — Cinq ou six thèmes de ce genre ont suffi pendant des siècles aux grandes écoles d’Italie. La couleur de ce tableau, que chaque jour améliore, prend une intensité toute vénitienne et nous remet en mémoire une toile analogue de Marco Roccone qu’on voit à la galerie des beaux-arts, sur le Grand-Canal. Les gris, tant reprochés à M. Ingres il y a quelques années, ont disparu sous une belle teinte chaude et dorée. Les draperies, d’abord un peu entières de ton, se sont harmonieusement rompues. Nous insistons là-dessus parce que les peintres actuels devancent sur leurs tableaux l’action du temps, et simulent la fumée des ans par des vernis jaunes et des glacis de bitume qui en compromettent l’avenir. L’éclat neuf d’une peinture fraîche est sans doute moins agréable, mais ces sacrifices à une harmonie temporaire peuvent devenir funestes.
L’original de la Vierge à l’hostie est en Russie maintenant ; — celle qui figure à l’Exposition universelle n’est cependant pas une copie, mais la répétition, avec changement, d’un sujet favori, telle que se la permettaient souvent les grands maîtres anciens. Le saint Nicolas et le saint Georges ont disparu pour faire place à deux anges thuriféraires : la sainte Vierge, joignant par les pointes les longs doigts de ses belles mains, adore, les yeux baissés — avec une expression de modestie tempérée d’orgueil, car elle est la mère de ce Dieu qu’elle prie, — l’hostie, blanc soleil rayonnant au-dessus du calice où, mystère insondable, s’est incarné le fils qu’elle tenait tout à l’heure dans ses bras : la tête de la Madone est d’une suavité divine. Ses traits purs, d’un type grec christianisé, ont cette incomparable noblesse qui est le secret bien gardé de M. Ingres ; jamais chaste ovale ne circonscrivit yeux plus pudiques, nez plus fin, bouche mieux arquée par un charmant demi-sourire. Nous ne reprocherons à ce visage vraiment céleste que quelques teintes d’un rose trop humain sur le haut des joues. — Le sang n’a plus sa pourpre violente dans les veines des êtres immatériels ou spiritualisés par l’assomption, et ne colore que faiblement ces corps aromaux, pour emprunter une expression au vocabulaire phalanstérien de Fourier. Peut-être l’artiste a-t-il voulu exprimer par cette rougeur la Rose mystique des Litanies. Une véritable difficulté pour la peinture, c’est de faire sentir la souplesse et le mouvement du corps humain sous une armure de fer. — Ce problème, M. Ingres l’a complètement résolu dans sa Jeanne d’Arc. Sous la cuirasse bombée s’arrondit et palpite le sein de la jeune vierge ; ses hanches féminines se devinent à travers le tonnelet de mailles, et quand même elle aurait sur la tête son casque, la visière fermée, son sexe ne serait un mystère pour personne ; la luisante carapace d’acier qui la recouvre ne lui ôte rien de sa sveltesse vigoureuse : sa tête, aux traits purs et réguliers, qu’accompagnent des cheveux partagés sur le front et coupés à la hauteur des oreilles, respire le calme contentement du rêve réalisé, le tranquille enthousiasme de la mission accomplie. Son épée et sa masse d’armes pendent encore à son côté, mais son heaume, désormais inutile, repose, avec ses gantelets, sur un coussin placé à ses pieds ; sa main étendue sur l’autel semble prendre Dieu à témoin qu’elle a tenu la promesse faite à son roi. Elle porte haut l’oriflamme victorieuse sous les voûtes de la cathédrale de Reims, où Charles VII reçoit l’huile de la sainte ampoule ; mais cette grande scène, qui aurait ôté à Jeanne d’Arc de son importance, se passe hors de la vue du spectateur. — Autour de l’héroïne de Vaucouleurs se pressent, dans un espace peut-être trop étroit, Doloy, son écuyer ; Jean Paquerel, religieux augustin, son confesseur, deux ou trois pages qu’on croirait découpés dans quelque miniature de manuscrit gothique, tant ils ont le caractère de l’époque, et s’arrangent avec un sentiment moyen âge dans les coins irréguliers que leur laisse la composition pivotant sur un seule figure. Ceux qui refusent la couleur à M. Ingres n’ont qu’à regarder attentivement les ornements de l’autel, tabernacle, ciboire, flambeaux, et ils changeront à coup sûr d’idée : il y a là des ors du ton le plus riche et d’une vérité à faire illusion. Le trompe-l’œil ne signifie pas grand’chose en art, et M. Ingres le méprise plus que personne ; mais, poussé à ce point, il prouve une véritable puissance de coloriste. — Grâce à M. Ingres, Jeanne d’Arc possède enfin une image digne d’elle.
L’Odalisque couchée, peinte à Rome en 1814 et exposée quelques années plus tard au Salon, fit pousser les hauts cris aux prétendus connaisseurs du temps. — Chose singulière ! M. Ingres fut poursuivi des mêmes injures qu’on prodigua ensuite aux chefs de l’école romantique : — on l’accusa de vouloir faire rétrograder l’art jusqu’à la barbarie du seizième et du quinzième siècle, — la barbarie de Léonard de Vinci, de Raphaël, d’André del Sarto, de Corrége et d’André Mantegna, apparemment ! — À peine lui accordait-on quelques qualités de dessin ; — c’était, disaient les critiques, froid, sec, plat, dur, gothique enfin ! pour lâcher le grand mot.
Et pourtant, si jamais créature divinement belle s’étala dans sa chaste nudité aux regards des hommes indignes de la contempler, c’est à coup sûr l’Odalisque couchée ; rien de plus parfait n’est sorti du pinceau.
Soulevée à demi sur son coude noyé dans les coussins, l’odalisque, tournant la tête vers le spectateur par une flexion pleine de grâce, montre des épaules d’une blancheur dorée, un dos où court dans la chair souple une délicieuse ligne serpentine, des reins et des jambes d’une suavité de forme idéale, des pieds dont la plante n’a jamais foulé que les tapis de Smyrne et les marches d’albâtre oriental des piscines du harem ; des pieds dont les doigts, vus, par-dessous, se recourbent mollement, frais et blancs comme des boutons de camellia, et semblent modelés sur quelque ivoire de Phidias retrouvé par miracle ; l’autre bras languissamment abandonné, flotte le long du contour des hanches, retenant de la main un éventail de plumes qui s’échappe, en s’écartant assez du corps pour laisser voir un sein vierge d’une coupe exquise, sein de Vénus grecque, sculptée par Cléomène pour le temple de Chypre et transportée dans le sérail du padischa.
Une espèce de turban de cachemire, arrangé avec un goût extrême, et dont les franges retombent derrière la nuque, enveloppe le sommet de la tête, découvrant des cheveux en bandeaux sur lesquels s’enroule une natte de cheveux en forme de couronne ; des fils et des grappes de perles complètent cette coiffure orientale. Les yeux, dont la prunelle glauque regarde de côté ; le nez, aux narines roses comme l’intérieur d’un coquillage ; la bouche, épanouie par un sourire nonchalant ; les joues pleines, un peu larges ; le menton, d’une courbe ronde et voluptueuse, forment un type où l’individualité de l’Orient se mêle à l’idéal de la Grèce. — C’est bien là, et telle a dû être l’intention du peintre, la beauté esclave dans sa sérénité morne, étalent avec indifférence des trésors qui ne lui appartiennent plus, et se reposant nue au sortir de son bain, dont les dernières perles sont à peine séchées, à côté de la cassolette qui fume, entre le chibouck et la collation de fruits et de conserves, ne prenant pas même la peine de renouer sa ceinture à la massive agrafe de diamants. Quelle élégance abandonnée dans ses longs membres qui filent comme des tiges de fleurs au courant de l’eau ! quelle souplesse dans ces reins moelleux, dont la chair semble avoir des micas de marbre de Paros sous la vapeur rose de la vie qui les colore légèrement ! et quel soin précieux dans tous les accessoires, les bracelets, le chasse-mouches en plumes de paon, les bijoux, la pipe, les draperies, les coussins, les linges fripés et jetés çà et là ! — La tribune de Florence, le salon carré de Paris, la galerie de Madrid, le musée de Dresde admettraient ce chef-d’œuvre parmi les plus belles toiles.
M. Ingres aime ce sujet si favorable à la peinture, ce prétexte si commode de nu dans notre époque habillée des pieds à la tête. — Il a fait plusieurs odalisques ou baigneuses.
La seconde odalisque est une jeune femme blonde, accablée des langueurs énervantes de sérail et penchant sa tête sur ses bras entre-croisés parmi les flots de sa chevelure ruisselante ; son corps demi-nu se tord dans une pose contractée par un spasme d’ennui. — Peut-être quelque secret désir inassouvi, quelque folle aspiration vers la liberté agite cette belle créature enfermée vivante dans le tombeau du harem, et la fait se rouler sur les nattes et les mosaïques. Une jeune esclave abyssinienne, dont la veste entr’ouverte laisse voir la gorge fauve comme du bronze, est agenouillée près de la favorite blanche et lui joue sur le tchéhégour quelques-unes de ces mélodies sauvages et bizarres qui endorment la douleur comme un chant de nourrice, à moins toutefois qu’elles n’inspirent d’étranges nostalgies de patries inconnues. — Au fond se promène d’un air maussade et soupçonneux un eunuque noir, attendant la fin de la crise ou la redoutant. — Tous les détails de costume et d’ameublement ont cette scrupuleuse fidélité locale qui est un des mérites de M. Ingres. Il est impossible de mieux peindre le mystère, le silence et l’étouffement du sérail : pas un rayon de soleil, pas un coin de ciel bleu, pas un souffle d’air dans cette chambre ouatée, capitonnée, imprégnée des parfums vertigineux du tomback, de l’ambre et du benjoin, où s’étiole, loin de tous les regards, la plus belle fleur humaine.
La Baigneuse, assise et vue de dos, se modèle dans un clair-obscur argenté, réchauffé de reflets blonds ; un gazillon blanc et rouge se tortille avec coquetterie autour de sa tête, et son beau corps, peint grassement, développe ses riches formes féminines revêtues d’une couleur qui semble prise sur la palette de Titien. Des linges d’un blanc chaud et doré, à franges effilées et pendantes, comparables aux draps sur lesquels s’allongent les Vénus et les maîtresses de prince du grand peintre de Venise, font valoir par leurs beaux tons mats les chairs fermes et superbes de la baigneuse ; un bout de rideau tombant sur le coin du tableau est le seul repoussoir que ce soit permis l’artiste ; tout le reste se maintient dans une gamme claire, puissante et tranquille, sur un jour qui tombe de haut, probablement par une de ces verrues de cristal qui bossuent les coupoles des bains turcs à Constantinople. — Ici, tout est réuni, beauté et vérité, dessin et couleur.
Quel regard inquiet d’oiseau surpris jette par-dessus son épaule cette petite Baigneuse farouche, à la prunelle de charbon dans un teint de citron vert ! Qu’elle est furtive, effarée et charmante ! on dirait un fragment de statue grecque bruni avec les tons fauves du Giorgione.
Nous allons aborder maintenant la série des tableaux de genre exposés par M. Ingres, si une telle dénomination, comprise comme on l’entend aujourd’hui, peut s’accorder avec des œuvres toujours sérieuses quelles que soient leurs dimensions : — la grandeur du cadre ne fait rien à l’affaire. — N’est-ce pas en effet un tableau d’histoire du plus haut style, que le Pape Pie VII tenant chapelle ? Bien que les figures n’aient que quelques pouces de hauteur, quelle grandeur historique, quel calme auguste, quelle sérénité sacerdotale ! Le pape, les pieds perdus dans ses longs vêtements blancs, comme un Hermès dans sa gaine, trône sous le dais rouge écussonné des armes du saint-siège, appliqué à la muraille que décorent les fresques de Ghirlandajo et de Luca Signorelli. À côté de lui, un cameriere vêtu de noir, lit un livre — un bréviaire sans doute ; — les cardinaux étalent leurs camails d’hermine sur la pourpre romaine, rangés en files symétriques, ayant au-dessous d’eux les prélats violets. Sur le devant, en dehors de la balustrade, se groupent quelques personnages : hallebardiers, prêtres, curieux ; au fond, dans la demi-teinte la plus savante, montent et descendent les formidables figures du Jugement dernier. Ce fond est, à notre avis, la seule copie vraie qu’on ait jamais faite de l’œuvre colossale de Michel-Ange ; l’impression est la même que si l’on était réellement dans la chapelle Sixtine.
M. Ingres est revenu deux fois à ce sujet, en le modifiant. Dans le second tableau, le pape, les prélats occupent à peu près la même place ; seulement un religieux de Saint-François, en sandales et en froc, vient se prosterner aux pieds de Sa Sainteté avant de prêcher et lui demander sa bénédiction.
On ne saurait imaginer à quelle puissance d’illusion l’illustre artiste est arrivé dans ces deux toiles ; — c’est la nature même, forme et couleur, plus le style et ce je ne sais quoi qu’un grand maître ajoute comme signature indélébile aux choses qu’il copie.
Le succès de la Ristori dans la tragédie de Silvio Pellico donne un intérêt d’actualité au délicieux petit tableau de Paolo et Francesca, qu’une lithographie fort bien faite a d’ailleurs déjà popularisé. Le volume de Dante, qui portait en marge les dessins à la plume de Michel-Ange, a été perdu malheureusement ; on aurait pu y inscrire au trait la composition de M. Ingres : Paolo allonge son cou avec un mouvement d’oiseau amoureux pour atteindre la bouche de Francesca, qui laisse tomber le livre » où l’on ne lut pas davantage. » Au fond apparaît le Malatesta difforme et boiteux, Sganarelle féroce, tirant du fourreau sa grande épée, pour trancher sur leur tige ces deux beaux lis du jardin d’amour. — Jamais le gracieux épisode du cinquième cercle de l’Enfer d’Alighieri n’a été traduit plus intelligemment.
M. Ingres, qui était si grec dans l’Apothéose d’Homère, si romain dans le Martyre de saint Symphorien, si oriental dans ses diverses Odalisques, est ici un vrai imagier du moyen âge, plus la science du dessin et le style, qu’il n’oublie jamais. Cette facilité à s’empreindre de la couleur locale d’un sujet est une des nombreuses qualités du grand artiste qu’on a le moins remarquées, et sur laquelle nous insistons, car nul n’a poussé plus loin cette puissance de transformation. — Jean Pastorel présentant à Charles V le prévôt et les échevins de Paris semble copié d’après une tapisserie du temps. — Don Pèdre de Tolède rendant hommage à l’épée d’Henri IV, — Henri IV jouant avec ses enfants devant l’ambassadeur d’Espagne, ont l’exactitude historique et la couleur locale des portraits de l’époque, faits par Porbus ou par Clouet ; — il y a même un certain air de Lebrun dans le Philippe V décorant du cordon de la Toison d’or le maréchal de Berwick après la bataille d’Almanza ; on croirait le Tintoret et l’Arétin, l’Arétin dédaignant (comme trop légère) la chaîne d’or que lui envoie l’empereur Charles-Quint, peints à Venise par un contemporain.
Le portrait élevé jusqu’à l’art est une des tâches les plus difficiles qu’un peintre puisse se proposer ; — les grands maîtres seuls, Léonard de Vinci, Titien, Raphaël, Velasquez, Holbein, Van Dyck, y ont réussi. — M. Ingres a le droit de se mêler à cette illustre phalange ; personne n’a fait le portrait mieux que lui. À la ressemblance extérieure du modèle il joint la ressemblance interne ; il fait sous le portrait physique le portrait moral. — N’est-ce pas la révélation de toute une époque que cette magnifique pose de M. Bertin de Vaux appuyant, comme un César bourgeois, ses belles et fortes mains sur ses genoux puissants, avec l’autorité de l’intelligence, de la richesse et de la juste confiance en soi ? Quelle tête bien organisée ! quel regard lucide et mâle ! quelle aménité sereine autour de cette bouche fine sans astuce ! — Remplacez la redingote par un pli de pourpre, ce sera un empereur romain ou un cardinal. — Tel qu’il est, c’est l’honnête homme sous Louis-Philippe, et les six tomes du docteur Véron n’en racontent pas davantage sur cette époque disparue.
Mêler l’allégorie à la reproduction minutieusement réelle d’un personnage de nos jours est une tentative hardie, on pourrait même dire téméraire, que M. Ingres seul était en état de risquer avec des chances de succès : nous voulons parler du portrait de Chérubini couronné par la Muse de la musique. Pour rendre le contraste moins brusque entre un vieillard vêtu d’une sorte de manteau à collet ressemblant fort à un carrick et une figure allégorique couronnée de lauriers, drapée d’une tunique et tenant une lyre d’ivoire, l’artiste a déplacé Chérubini et l’a transporté dans un milieu idéal, un intérieur de style pompeïen ; il l’a fait s’appuyer contre une colonne cannelée, peinte en rouge jusqu’à la moitié du fût, et se détacher d’un fond antique où des arabesques courent sur le stuc des murailles. L’illustre compositeur, sorti de la vie ordinaire, s’est rendu au sanctuaire de la muse ; il rêve, il médite ; les mélodies bourdonnent autour de ses tempes comme des abeilles d’or, et la jeune immortelle aux cheveux noirs, aux sourcils d’ébène, à la bouche de pourpre, étend sa belle main sur la tête de chauve du vieillard, qu’elle sacre pour la postérité. — Ce bras, en plein raccourci, est une merveille de l’art.
Nous n’avons jamais pu regarder sans être troublé profondément le portrait de Mme D., peint à Rome en 1807 : là, M. Ingres est arrivé à une intensité de vie effrayante : ces yeux noirs et tranquilles sous l’arc mince de leurs sourcils vous entrent dans l’âme comme deux jets de feu. Ils vous suivent, ils vous obsèdent, ils vous charment, en prenant le mot au sens magique. L’imperceptible sourire qui voltige sur les lèvres fines semble vous railler de votre amour impossible, tandis que les mains affectent de jouer distraitement avec les feuilles d’écaille d’un petit éventail, en signe de parfaite insouciance. — Ce n’est pas une femme qu’a peinte M. Ingres, mais le portrait ressemblant de la Chimère antique, en costume de l’Empire. — Une seule tête nous a produit un effet semblable, celle de la fille du Greco peinte par son père, qui en était amoureux, et devint fou, son œuvre terminée.
Citons sans les détailler, car cela nous mènerait trop loin, et tout le monde les connaît, les portraits de madame d’H., de madame L.-B., celui de madame la princesse de B., si fin, si aristocratique, et reproduisant avec tant de charme la grande dame moderne ; quelle harmonie délicieuse que ces bras et ces mains d’une pâleur nacrée, se détachant du satin bleu de la robe. Arrêtons-nous au portrait si fier, si hardi, si coloré, que M. Ingres fit de lui-même dans sa première jeunesse ; celui de son père est aussi une bien belle chose. Les portraits de M. Molé et de M. de Pastoret sont gravés, et nous n’avons pas besoin d’en parler ici.
Après ces éloges que nous aurions voulu rendre dignes de l’illustre maître, et que la rapidité du journal nous force à improviser au courant de la plume, terminons par un regret ; la Stratonice, le joyau, la perle de l’écrin, manque à cette Exposition. La gloire du grand artiste n’en sera pas diminuée : un chef-d’œuvre de plus ou de moins, que lui importe ! Mais nous aurions été fier de voir les étrangers s’arrêter, rêveurs, devant cette merveille sans pareille au monde.
L’Artiste, « La Source – Nouveau tableau de M. Ingres.« , 1er février 1857
En écrivant ces lignes, nous abusons peut-être de la faveur qui nous a été accordée de contempler dans son sanctuaire un des chefs-d’œuvre de la peinture moderne ; c’était à l’ami et non au critique que l’illustre maître montrait sa toile ; il nous a exprimé le désir qu’il n’en fût point parlé et nous lui désobéissons, au risque de lui déplaire. Nous concevons chez l’auteur de l’Odalisque, du Vœu de Louis XIII, de l’Apothéose d’Homère, de la Vénus Anadyomène, cet ennui de la gloire, cette satiété de l’éloge, ce dédain de la publicité. Lorsque tant d’autres poursuivent la lumière qui les fuit, lui cherche l’ombre qui ne peut couvrir son rayonnement. Il ne veut plus peindre que pour lui et quelques intimes, de loin en loin, à ses heures. L’atelier, dont il entrebâille la porte aux privilégiés, est son salon d’exposition.
M. Ingres aura beau faire, il ne trouvera jamais l’ombre ni le silence. Toutes les fois que sa main touchera le pinceau, ce sera un événement ; on usera de ruses pour se glisser dans la chapelle mystérieuse et l’on en divulguera les secrets. Quoiqu’il semble d’abord que chacun soit libre de faire voir ou de cacher ce qu’il fait, en y réfléchissant l’on comprend que les natures touchées par le génie ne s’appartiennent pas. Non, ils n’ont pas le droit de la couvrir du boisseau, ceux qui ont reçu la flamme céleste ; il est de leur devoir de la faire briller aux yeux de tous, sur un socle de marbre blanc, dans un trépied d’or ! Ce n’est pas pour eux seuls que Dieu leur a fait ce présent si rare, et quand il met à la main d’un homme le flambeau du génie, c’est pour le tenir élevé et visible au-dessus de l’humanité.
Le sacrilège même est pieux en de telles occasions, et César a bien mérité du monde en déchirant le testament de Virgile qui condamnait l’Énéïde au feu comme imparfaite. Supposons un instant que Michel-Ange, comparant son œuvre à son idéal, eût ordonné d’effacer les peintures de la chapelle Sixtine et de briser les figures du tombeau des Médicis, qui ne couvrirait de malédictions éternelles l’exécuteur trop fidèle d’un pareil ordre ?
Le grand jour de la rue pénétrant dans le foyer, la curiosité toujours en éveil, regardant aux fentes de la porte, la pensée publique épiant l’inspiration solitaire, le commentaire incessant du rêve caressé par l’âme, l’œuvre secrète livrée aux disputes, la critique avec ses restrictions, l’éloge avec ses hyperboles, ce sont là les croix du génie, et il faut qu’il les porte, quelque amour qu’il ait du repos, de la solitude et du silence. La lumière ne quitte jamais plus les fronts qu’elle a dorés : on ne met pas son chapeau sur son auréole.
Ainsi, nous voilà nous-même violentant la modestie du grand maître qui nous honore de son amitié ; mais, en vérité, l’Artiste manquerait à sa mission s’il ne rendait pas compte du chef-d’œuvre dont on a soulevé le voile pour nous ; M. Ingres nous pardonnera, nous l’espérons du moins, de n’avoir pas respecté ses intentions.
La Source, tel est le titre du nouveau tableau de M. Ingres, ou du moins celui qui se présente le plus naturellement à l’esprit en face de cette charmante composition, où l’idéal et la nature se fondent en des proportions parfaites.
La toile a cette dimension étroite et haute qui est déjà une élégance lorsque le peintre sait la remplir sans gêne.
Sur un fond de roche grise, rayé de quelques stries, égayé de quelques filaments de plantes pariétaires d’un vert discret, se dessine, dans la chaste nudité de ses quinze ans, une figure à la fois mythologique et réelle, une nymphe ou une jeune fille, si vous l’aimez mieux. Un païen y verrait la naïade du lieu ; un chrétien du moyen âge, l’ondine des légendes ; un sceptique de nos jours, une belle enfant qui s’est baignée dans la source, et, avant de reprendre ses habits, confie quelques instants sa beauté à la solitude :
Lorsque la jeune fille à la source voisine
A sous les nénuphars lavé ses bras poudreux,
Elle reste au soleil, les mains sur sa poitrine,
A regarder longtemps pleurer ses longs cheveux.
Elle sort, mais pareille aux rochers de Borghèse,
Couverte de rubis comme un poignard persan,
Et sur son front luisant sa mère qui la baise
Sent du fond de son cœur la fraîcheur de son sang.
Ces vers d’Alfred de Musset voltigeaient sur nos lèvres tandis que nous regardions, immobile et ravi, cette admirable peinture. Ce n’est pas une ressemblance que nous voulons signaler, mais une impression analogue. Dans la poésie et dans le tableau, il y a quelque chose de frais comme l’eau de source, et l’on sent le froid baiser du bain sur ce charmant corps de vierge.
Elle est là, debout, pure et blanche comme un marbre grec rosé par la vie ; ses prunelles couleur de myosotis nagent sur le fluide bleu de la jeunesse ; ses joues ressemblent à des pétales d’églantine effeuillées sur du lait ; un éclair de nacre brille dans son vague sourire entr’ouvert comme une fleur ; son nez délicat laisse la lumière pénétrer ses fines arêtes et ses narines transparentes ; tous ces traits charmants sont enveloppés par le contour le plus suave, le plus virginal dans sa rondeur enfantine, qu’ait jamais tracé la main d’un peintre. L’enfant est blonde comme Vénus, comme les Grâces, comme Ève ; un or soyeux et frissonnant couronne son petit front antique.
Son bras droit, arrondi au-dessus de sa tête avec un mouvement d’une grâce athénienne, soulève une urne d’argile appuyée sur son épaule et dont le goulot pose sur sa main gauche ; du vase à demi renversé tombe l’eau en fusées brillantes, dont la rencontre du rocher fait des perles.
Le bras relevé entraîne la ligne extérieure du corps et lui donne une ondulation serpentine d’une suavité extrême ; on suit amoureusement ce contour modulé comme une belle phrase musicale, qui chante et se rythme à l’œil avec une harmonie enchanteresse.
M. Ingres connaît aussi bien que les Grecs les mélodies de la forme, l’eurythmie des poses et la métrique de cet admirable poëme du corps humain, — le plus beau vêtement que puisse emprunter l’idéal. — Une jeune fille nue qui a les bras levés, qui hanche, et dont une des jambes fait un peu retraite, tandis que l’autre porte en plein, cela ne semble pas bien difficile à trouver ; eh bien ! le génie de tous les statuaires et de tous les peintres cherchant le beau depuis des siècles n’a rien pu inventer qui dépassât cette conception si simple en apparence.
La nymphe de M. Ingres a quinze ans tout au plus ; hier c’était un enfant, aujourd’hui c’est une jeune fille, mais rien de la femme n’apparaît encore dans ces formes pures, virginales, insexuelles même, — si l’on peut risquer un tel mot ; — le sein petit, à peine éclos, teinté à sa pointe d’une faible lueur rose, n’éveille pas plus de désir qu’un bouton de fleur ; le reste du torse, chastement nu, est vêtu de sa blancheur marmoréenne comme d’une tunique de pudeur ; on sent qu’on n’a pas devant les yeux des organes, mais des expressions d’idéal ! innocence, jeunesse, fraîcheur, beauté ! la vie vierge, la perfection immaculée ! une palpitation et une rougeur dans un marbre de Paros !
Des pieds divins qui n’ont jamais marché que sur les tapis de fleurs de l’idylle Syracusaine servent de socle à cette charmante figure ; l’eau qui sourd de la roche en bouillons argentés et qui les a pâlis en les refroidissant, et leurs doigts nobles, comme si Phidias les avait modelés, se sculptent dans des tons d’ivoire.
À peine sortie du rocher, la source s’endort en un petit bassin sur des cressons et des plantes d’eau, et sa surface brunie comme le métal d’un miroir antique répète, en les renversant et en les azurant un peu, les belles jambes blanches de l’enfant. On dirait que le peintre ne se séparait qu’avec chagrin de sa figure, et qu’il la prolonge sous l’eau avant de la quitter à tout jamais.
Louer chez M. Ingres la pureté de son dessin, la finesse de son modelé, l’élévation de son style, c’est un lieu commun qu’il n’est plus guère permis de répéter ; aussi n’en dirons-nous rien. Ce qui nous a surtout frappé dans cette nouvelle toile, c’est la beauté suprême de la couleur. On exposerait la Source au milieu d’une galerie de chefs-d’œuvre flamands et vénitiens, elle supporterait sans désavantage la lutte avec les plus fiers coloristes. Jamais chairs plus souples, plus fraîches, plus pénétrées de vie, plus imprégnées de lumière ne s’offrirent aux regards dans leur pudique nudité. L’idéal, cette fois, s’est fait trompe-l’œil ; —c’est à croire que la figure va sortir du cadre et reprendre ses vêtements suspendus à un arbre.
Quelque admiration que nous professions pour les autres tableaux de M. Ingres, la Source nous paraît être la perle de son œuvre. — Au delà, l’art se perd dans l’impossible ou retourne à Dieu.
Les siècles jaloux ont fait disparaître les peintures d’Apelles, — le Raphaël athénien ; — mais nous croyons volontiers que sa Campaspe nue devait être dessinée et peinte comme la Source de M. Ingres.
Puisque nous sommes en veine d’indiscrétion, parlons aussi d’un magnifique portrait de femme qui joint au mérite de la beauté la plus ressemblante une fierté de style tout antique. Nous ne connaissons rien de plus noble que ce bras qui s’accoude avec une majestueuse nonchalance, que cette main appuyée à la joue, et surtout que ce doigt rebroussé sur la tempe, avec un maniérisme grandiose et junonien, — justifié d’ailleurs par une fresque de Pompéï. La robe de satin blanc broché de fleurs, ou plutôt de bouquets multicolores, présentait une de ces difficultés que M. Ingres seul sait vaincre.
Le Jésus parmi les Docteurs, composition d’une grâce et d’une science à faire croire que Raphaël est revenu au monde, s’avance et marche vers cette perfection absolue que cherche et trouve le maître ; pour tout autre, le tableau serait fini depuis longtemps ; M. Ingres n’en parle que comme d’une ébauche : nous devons donc ne pas juger ce que l’artiste ne regarde pas comme achevé.
Et la Naissance des Muses ? cette peinture si grecque, si antique qu’on prendrait pour la réduction miraculeusement conservée d’un tableau perdu d’Euphranor, de Xeuxis ou de Timanthe, n’en dirons-nous rien ? Contentons-nous de l’indiquer ; nous savons où la retrouver plus tard, et nous la décrirons sans craindre alors de commettre un abus de confiance.
C’est à M. Duchâtel qu’appartient la Source. — Nous n’avons jamais désiré la richesse qu’en de pareilles occasions. Avec quelques poignées d’or, quelques liasses de billets, on achète un chef-d’œuvre, comme si de telles merveilles pouvaient se payer ! Il faudrait du moins qu’une loi forçât l’heureux possesseur à exposer son trésor une fois ou deux par semaine !
L’Artiste, « Ingres », 5 avril 1857
La vie d’un artiste est dans son œuvre, aujourd’hui surtout que la civilisation par son développement a diminué les hasards des existences et réduit presque à rien l’aventure personnelle. La biographie de la plupart des grands maîtres des siècles passés contient une légende, un roman, ou tout au moins une histoire ; celle des peintres et des sculpteurs célèbres de notre temps peut se résumer en quelques lignes : luttes obscures, travaux dans l’ombre, souffrances courageusement dévorées, renommée discutée d’abord, reconnue enfin, plus ou moins récompensée, de grandes commandes, la croix, l’Institut ; à part quelques victimes tombées avant l’heure du triomphe, et à jamais regrettables, tel est, sauf un petit nombre de détails particuliers, le fond obligé de ces notices. Mais si les faits y tiennent peu de place, les idées et les caractères en occupent une grande : les œuvres suppléent les incidents qui manquent.
Ingres ( Jean-Auguste-Dominique ) est né à Montauban, en 1781. Il a donc, à l’heure qu’il est, soixante-seize ans. Jamais vieillesse plus verte ne fut plus robustement portée, et l’on peut hardiment promettre à l’illustre maître d’atteindre et de dépasser la vie séculaire du Titien. Quoique l’excellent portrait, si consciencieusement étudié et rendu par M. Masson, que l’Artiste publie avec ce numéro nous dispense en quelque sorte de toute description physique, nous essayerons cependant d’esquisser à la plume cette physionomie remarquable, et de compléter l’œuvre du burin.
Il existe d’Ingres un portrait peint par lui-même en 1804. L’artiste s’est représenté debout devant son chevalet un coin de manteau jeté sur l’épaule : la main droite tient un crayon blanc, la gauche se replie contre la poitrine ; la tête, de trois quarts, regarde le spectateur. On dirait que le peintre se recueille dans sa foi et sa volonté avant d’attaquer la toile.
Les traits, malgré leur jeunesse, — l’auteur avait alors vingt-quatre ans, — sont très fermement accentués ; les cheveux, d’un noir énergique, se séparent sur le front en boucles mouvementées et rebelles. Les yeux bruns ont un éclat presque sauvage ; un sang riche colore les lèvres, et le teint, comme hâlé par un feu intérieur, rappelle cette nuance ambrée et fauve qu’affectionnait Giorgione : un col de chemise rabattu fait valoir par une large touche blanche la chaude localité des chairs. La teinte neutre dont on peint les murs des ateliers remplit le fond.
Il y a dans ce portrait une force de vie singulière : la sève puissante de la jeunesse y déborde, quoique déjà contenue par la volonté. Le maître apparaît derrière l’élève. Ceux qui accusent Ingres de froideur n’ont certes pas vu cette figure si vivace, si âpre, si robuste, qui semble vous suivre de son regard noir, obstiné et profond. C’est un de ces portraits inquiétants avec lesquels on n’est pas seul dans une chambre ; car une âme vous épie par le trou de leurs prunelles sombres.
Nous aimons beaucoup les images des artistes illustres tracées au début de leur vie, quand la gloire n’avait pas encore couronné leur front plein de rêves ; elles sont rares d’ailleurs : on ne s’occupe guère de fixer et de multiplier leur ressemblance que lorsque les années sont venues, apportant la célébrité avec elles.
Ce portrait promet tout ce que l’artiste a tenu. Foi ardente, courage inébranlable, persistance que rien ne rebute. On découvre dans ces lignes nettes, dans ces méplats accusés, dans cette forte charpente, un génie opiniâtre, têtu même, — n’a-t-on pas dit que le génie est fait de patience ? — dont la devise semble être : etiamsi omnes, ego non. En effet, rien n’a pu détourner du culte de la beauté pure cet enthousiaste, solitaire si longtemps, ni le pédantisme classique, ni l’émeute romantique : il a mieux aimé attendre la réputation que de l’acquérir hâtivement, en se conformant aux doctrines à la mode. À une époque de doute, de mollesse, d’incertitude, il a cru, sans un moment de défaillance : la Nature, Phidias, Raphaël, ont été pour lui une sorte de trinité de l’art, d’où résultait pour unité l’idéal.
Mettez un froc à la place du manteau, et vous aurez un jeune moine italien du moyen âge, un de ces moines qui deviennent cardinaux ou papes ; car ils ont la puissance de suivre toute leur vie une idée unique.
Maintenant regardons le portrait du maître souverain, comblé d’ans et d’honneurs, qui a régné despotiquement sur une école fanatisée, adoré et craint comme un dieu. Les cheveux, qui ne comptent encore qu’un petit nombre de fils blancs, gardent toujours la raie au milieu de la tête, en l’honneur du divin Sanzio, comme une espèce de marque mystérieuse par laquelle le dévot se consacre à son idole. Quelques plis transversaux ont rayé le front, légèrement ; quelques veines dessinent leurs rameaux sur les tempes moins couvertes ; une chair compacte et solide élargit les plans primitifs et modèle puissamment les formes indiquées par le premier portrait : la bouche s’est attristée à ses angles de deux ou trois rides moroses, mais l’œil conserve une immortelle jeunesse ; il regarde toujours le même but : — le beau !
Remplacez par un camail d’hermine le paletot moderne, et cette tête aux lignes sévères, à la coloration énergique, sculptée, mais non détruite par l’âge, pourra figurer parmi les prélats romains à un conclave, à une cérémonie de la chapelle Sixtine. Si nous insistons sur cette idée, c’est que la religion de l’art, dont il fut le prêtre le plus fervent, a donné à Ingres un aspect vraiment pontifical : il a toute sa vie gardé l’arche sainte, et porté les tables de la loi.
Ordinairement les biographies d’artistes commencent par le récit des obstacles qu’élève la famille contre la vocation. Le père qui désire un notaire, un médecin, ou un avocat, brûle les vers, déchire les dessins et cache les pinceaux. Ici, point d’empêchements de ce genre : chose rare ! le projet du fils se trouva d’accord avec le vœu paternel. L’enfant eut du papier, des crayons rouges et un portefeuille d’estampes à copier ; il apprit aussi la musique et à jouer du violon. Peintre ou musicien ! cet avenir n’effrayait nullement ce brave M. Ingres père. Il faut dire, pour expliquer ce phénomène, qu’il était lui-même musicien et peintre. Le jeune Ingres fut mis à l’atelier chez un M. Roques, de Toulouse, élève de Vien ; mais ce fut, plutôt encore que l’enseignement de ce maître, la vue d’une copie de la Vierge à la chaise, rapportée d’Italie, qui décida de son avenir. L’impression reçue fut ineffaçable, et l’enfant devenu homme ne l’oublia jamais : elle domine encore sa vie après plus de soixante ans écoulés.
Quelques années plus tard, il vint à Paris, entra chez David, obtint au concours un second prix qui l’exempta de la conscription : puis, en 1801, un premier prix : » Achille recevant dans sa tente les députés d’Agamemnon » qu’on peut voir à l’Académie des beaux arts, et qui le contient déjà tout entier. Bien que lauréat, il ne partit pas tout de suite pour cette ville éternelle, qui devait lui être comme une seconde patrie : les finances de l’État étaient épuisées, et les fonds manquaient pour la pension des élèves. Il attendit donc l’instant propice, travaillant, dessinant d’après l’antique et le modèle, au musée et chez Susse, copiant les estampes des maîtres, se préparant à la gloire lointaine par de fortes et sérieuses études.
Enfin, le voilà dans cette Rome où, avant lui, un autre maître austère, Poussin, s’était si bien acclimaté, oubliant presque la France au milieu des chefs-d’œuvre de l’antiquité. Cette atmosphère imprégnée d’art, si favorable au travail recueilli et solitaire, lui convenait admirablement. Il s’y fortifia dans le silence, loin des coteries et des systèmes, et se fit de son atelier une sorte de cloître où n’arrivaient pas les bruits du monde. — Il vivait seul, fier et triste ; mais chaque jour il pouvait admirer les loges et les stances de Raphaël, et cela le consolait de beaucoup de choses. Bientôt après il épousa la femme qu’on lui avait envoyée de France, et qui, par un hasard providentiel, se trouve être précisément la femme qu’il eût choisie. On sait avec quel infatigable dévouement madame Ingres écarta de son mari toutes ces petites misères qui taquinent le génie et le distrayent ; elle lui cacha le côté douloureux de la vie, et lui créa un milieu de calme et de sérénité, même dans les situations les plus difficiles. Sûr d’atteindre son but tôt ou tard, Ingres, quoiqu’il vît sa peinture peu goûtée ou méconnue tout à fait, s’obstinait à suivre la voie où il était entré, et souvent la gêne rôda autour du ménage et s’assit sur le seuil ; — une telle misère est glorieuse, et l’on peut en parler. À Florence, le peintre dont maintenant les toiles se couvrent d’or fut obligé pour vivre de faire des portraits à des prix dérisoires, et il n’en trouvait pas toujours.
Jamais artiste ne poussa plus loin le dédain de l’argent et de la gloire facile ; il élaborait longuement ses tableaux, et savait attendre l’heure de l’inspiration pour des œuvres qui devaient durer toujours. Dans le public l’on est porté à croire que le peintre du Vœu de Louis XIII, du Plafond d’Homère, de la Stratonice, n’a pas le travail rapide ; c’est une erreur. Ce pinceau, si savant et si sûr de lui-même, ne donne pas un coup qui ne porte, et souvent en une journée Ingres peint de la tête aux pieds une grande figure, où nul autre que lui ne saurait reprendre un défaut. Mais un artiste de cette conscience et de cette force ne se contente pas de peu. Le bien ne lui suffit pas ; il cherche le mieux, et ne s’arrête qu’à cette limite où l’imperfection des moyens humains arrête les génies les plus absolus dans la poursuite de l’idéal. Ainsi, des tableaux commencés au début de sa carrière, n’ont reçu que tout récemment la dernière main ; mais ceux qui ont eu le bonheur de les voir, ne trouvent pas que l’artiste ait mis trop de temps à les faire, quoiqu’ils soient restés quarante ans peut-être sur le chevalet.
L’Odalisque, commandée en 1813 par la reine Caroline de Naples, acquise en 1816 par M. Pourtalès, dont elle a longtemps illustré la galerie, et appartenant aujourd’hui à M. Goupil, qui n’a pas voulu que ce chef-d’œuvre sortît de France, fut la première toile qui attira l’attention sur le maître ignoré dans sa patrie. L’effet produit aurait pu décourager une conviction moins robuste : on n’appréciera pas cette exquise perfection de dessin, ce modelé si vivant et si fin, ce grand goût qui mariait la nature choisie aux plus pures traditions de l’antiquité. — L’Odalisque fut trouvée gothique, et l’on accusa le peintre de vouloir remonter à l’enfance de l’art. Nous n’inventons pas, croyez-le bien, ce jugement étrange. — Les barbares qu’imitait Ingres, au dire des critiques de 1817, c’étaient tout bonnement André Mantegna, Léonard de Vinci, Pérugin et Raphaël, gens, comme on sait, laissés intimement en arrière par le progrès. — Plus tard, on reprochera aussi aux romantiques de faire rebrousser la langue jusqu’à Ronsard.
Le Vœu de Louis XIII, auquel Ingres travailla trois ans, força enfin l’admiration rebelle. En effet, depuis le peintre d’Urbin, jamais plus noble et plus fière madone n’avait présenté enfant Jésus plus divin à l’adoration des anges et des hommes. L’artiste français avait pris place, par ce chef-d’œuvre, parmi les grands Italiens du XVIe siècle. Les anges soulevant les rideaux, les enfants portant les tablettes, la figure du roi, vu de dos et ne montrant qu’un profil perdu au-dessus d’un grand manteau fleurdelysé, dont les plis traînaient sur les dalles, étaient exécutés avec un style et une maëstria dont la tradition s’était perdue pendant plus de deux siècles.
En 1824, Ingres fut décoré de la légion d’Honneur, et en 1825, admis à L’Institut. L’Apothéose d’Homère, au salon de 1827, où figuraient la Naissance de Henri IV d’Eugène Devéria, et le Sardanapale d’E. Delacroix, consacra la gloire de l’artiste si longtemps méconnu. Il conquit dès lors dans une région sereine, au-dessus des disputes d’école, une place à part qu’il a gardée depuis et que personne n’est tenté de lui disputer. Il s’y maintient avec une tranquillité majestueuse — pacem summa tenent — n’entendant du monde lointain qu’un vague murmure, cultivant le beau sans distraction ; étranger à son temps et vivant avec Phidias et Raphaël cette vie éternelle de l’art, qui est la vraie, puisque de toute civilisation disparue il ne reste souvent, qu’un poëme, une statue ou un tableau.
Chose qui paraîtra singulière d’abord, mais que nous allons expliquer tout de suite. Le maître sévère fut ardemment soutenu par les romantiques, et il compta plus de partisans enthousiastes parmi la nouvelle école que dans l’Académie. Ingres, quoiqu’il puisse sembler classique à l’observateur superficiel, ne l’est nullement ; il remonte directement aux sources primitives, à la nature, à l’antiquité grecque, à l’art du seizième siècle ; nul n’est plus fidèle que lui à la couleur locale. Son Entrée de Charles V à Paris ressemble à une tapisserie gothique, sa Francesca da Rimini a l’air d’être détachée d’un de ces précieux manuscrits à miniature où s’épuisait la patience des imagiers, son Roger et Angélique a la grâce chevaleresque du poëme de l’Arioste, sa Chapelle Sixtine pourrait être signée Titien ; quant aux sujets antiques, tels que l’Œdipe, l’Apothéose d’Homère, la Stratonice, la Vénus Anadyomène, on ne les concevrait pas peints d’une autre manière par Apelle, Euphranor ou Xeuxis. Ses Odaliques rendraient jaloux le sultan des Turcs, tant les secrets du harem semblent familiers à l’artiste. Nul non plus n’a mieux exprimé la vie moderne, témoin cet immortel portrait de M. Bertin de Vaux qui est la physiologie d’un caractère et l’histoire d’un règne. S’il sait plisser admirablement une draperie grecque, Ingres n’arrange pas moins heureusement un cachemire et il tire un merveilleux parti de la toilette actuelle : ses portraits de femme l’attestent.
Ainsi, quel que soit le sujet qu’il traite, Ingres y apporte une exactitude rigoureuse ; une fidélité extrême de couleur et de forme, et n’accorde rien au poncif académique ; et si, dans le portrait histoire de Chérubini, il introduit Polymnie étendant la main sur un front inspiré, il laisse néanmoins sa perruque et son garrick au vieux maëstro.
Ingres, lorsqu’il peint un sujet antique, fait comme un poëte qui, voulant faire une tragédie grecque, remonterait à Eschyle, à Euripide, à Sophocle, au lieu d’imiter Racine et ses copistes.
En ce sens il est romantique — bien que pour la foule tout homme qui représente des scènes de l’histoire ancienne ou de la mythologie soit classique — et il ne faut pas s’étonner qu’il ait compté de nombreux adeptes parmi la nouvelle école.
Le Martyre de saint Symphorien que Michel-Ange et Jules Romain eussent admiré, n’eut pas le bonheur de plaire au public français à l’Exposition de 1834. La tête sublime du saint, le geste magnifique de la mère, les tournures superbes des licteurs n’obtinrent pas grâce pour le coloris qui avait la teinte mate, sobre et forte des fresques des grands maîtres. — L’artiste, justement irrité, se retira dans la direction de l’École française à Rome comme sous une tente d’Achille, et il se livra à l’enseignement de son art avec cette autorité que nul professeur ne posséda comme lui. Ses élèves l’adoraient et le craignaient, et tous les jours il y avait dans l’école des scènes passionnées et pathétiques, des brouilles et des raccommodements. Ingres parle de son art avec une singulière éloquence ; il a, devant Phidias et devant Raphaël, des effusions, des élans lyriques qu’on aurait dû sténographier ; d’autres fois, plus calme, il émet des maximes et des conseils qu’il est toujours bon de suivre, et qui, sous une forme abrupte, concise et bizarre, contiennent toute l’esthétique de la peinture.
Son influence a été profonde et se continue. Hippolyte Flandrin, Amaury-Duval, Lehmann, Ziegler, Chassériau, furent ses élèves les plus remarquables ; et, on peut dire, que chacun, dans la sphère de son talent, a fait honneur au maître.
À l’Exposition universelle de 1855, les tableaux d’Ingres furent exposés dans une salle à part, chapelle privilégiée de ce grand Jubilé de la peinture, et les adorateurs du beau y vinrent de tous pays.
Les bornes de cet article ne nous permettent pas de passer en revue tout l’œuvre du maître, dont nous donnons plus loin un catalogue sommaire ; nous avons voulu plutôt considérer l’artiste en général. Malgré quelques bizarreries de détail, nous aimons cette personnalité entière, cette vie une et consacrée sans réserve à l’art, cette recherche du beau que rien ne peut troubler. — Les esprits à systèmes religieux, politiques ou philosophiques diront sans doute qu’Ingres ne sert aucune idée ; c’est en quoi sa supériorité éclate : l’art est le but et non le moyen, et jamais il n’en exista de plus élevé. Tout poëte, statuaire ou peintre qui met sa plume, son ciseau ou sa brosse au service d’un système quelconque, peut être un homme d’État, un moraliste, un philosophe, mais nous nous défierons beaucoup de ses vers, de ses statues et de ses tableaux ; il n’a pas compris que le beau est supérieur à tout autre concept. Platon n’a-t-il pas dit : le beau est la splendeur du vrai ?
À toutes les qualités d’Ingres, on pourrait en joindre encore une. Il a conservé le secret, perdu aujourd’hui, de rendre, dans toute sa pureté, la beauté féminine. — Voyez l’Iliade et l’Odyssée, l’Angélique, l’Odalisque, le portrait de madame de Vauçay que le grand Léonard eût signé, la Muse de Chérubini, la Vénus Anadyomène, la Stratonice, les Victoires de l’apothéose de Napoléon, et enfin la Source, pur marbre de Paros rosé de vie, chef-d’œuvre inimitable, merveille de grâce et de fraîcheur, fleur d’un printemps de Grèce éclose sous le pinceau de l’artiste à un âge où la palette tombe des mains les plus vaillantes.
L’Artiste, « La rue Laffitte » , 3 janvier 1858
En tournant le coin du boulevard et en remontant vers Notre-Dame-de-Lorette, dont le campanile se détache sur l’escarpement de Montmartre, à la première montre qui se rencontrera vous pourrez admirer, soit la Femme couchée, de M. Ingres, endormie sous ses courtines rouges, soit l’Orphée, de M. Delacroix, au milieu d’une ménagerie dentue et griffue qu’apprivoisent ses accords — Doctus tenire tigres — deux rares morceaux de ces grands maîtres […]
L’Artiste, « Louis XIV et Molière – tableau de M. Ingres » , 10 janvier 1858
Les artistes sont généreux comme des rois asiatiques — au temps où les satrapes, les califes et les sultans payaient le moindre service d’une poignée de perles, de cent chameaux blancs et de mille bourses remplies de dinars. Ils montrent aux grands seigneurs, qui l’ont trop oubliée, la vraie magnificence.
M. Ingres, qui depuis longtemps a ses entrées à la Comédie-Française, a voulu reconnaître cette faveur toute naturelle et bien due à son nom illustre, à sa haute position dans l’art. MM. les sociétaires, qui sont gens du monde autant que comédiens, font, avec une grâce parfaite, les honneurs de leur théâtre et de leur foyer aux esprits d’élite qui peuvent prendre plaisir à fréquenter familièrement Corneille, Racine et Molière, et à causer d’eux avec leurs interprètes. — La présentation faite, le contrôle vous salue, les habitués vous sourient, et les portes s’ouvrent devant vous de la salle à la scène ; vous pouvez, l’hiver, vous chauffer à la vaste cheminée où les comédiennes viennent présenter, en attendant qu’on les avertisse que c’est leur tour, l’étroite semelle de leurs petits souliers de satin ; l’été, vous accouder au balcon pour aspirer la fraîcheur ; en tout temps, vous mêler aux fines discussions littéraires, — un madrigal bien tourné aux jeunes femmes ne vous est même pas défendu ; vous êtes chez vous, c’est-à-dire dans un salon de bonne compagnie, dont les maîtres quittent par intervalle la conversation pour aller lancer au public quelque tirade majestueuse, quelque répartie étincelante, et reviennent, chargés d’applaudissements, reprendre l’entretien interrompu. — C’est une douce habitude qu’on quitte difficilement quand on l’a prise, un vif souvenir si l’on est forcé de s’éloigner ; mais enfin, chacun y met du sien : l’amitié paye l’amitié, et l’on peut se croire quitte. M. Ingres ne l’a pas pensé ainsi ; — pour le jour de l’an, il a envoyé à la Comédie-Française un tableau de lui, non pas ( ce qui serait déjà splendide ) un tableau gardé longtemps dans son atelier par amour et par caprice, — mais un tableau fait tout exprès et dont la dernière touche est à peine séchée.
On sait que M.Ingres n’a fait que huit ou dix tableaux de chevalet tout au plus : les deux Chapelles Sixtines, l’Arétin, l’Entrée de Charles V à Paris, le Philippe V, Francesca et Paolo, Henri IV jouant avec ses enfants, Raphaël et la Fornarina, l’Antiope, et qu’au mérite de la perfection il joint celui de la rareté. — Une toile de sa main est donc un présent plus que royal, car on la couvre d’or et à plusieurs couches quand elle petite.
Le sujet choisi par l’illustre maître montre autant d’esprit que de convenance. Il était difficile, avec la voix muette de la peinture, d’adresser une flatterie plus délicate dans sa vérité historique.
Travaillant pour la maison de Molière, comme on dit, il a pris un trait de la vie de Molière et il a fait voir Louis XIV servant une aile de poulet à l’homme de génie que les valets de la chambre ne trouvaient pas d’assez bonne compagnie pour manger avec eux. Le grand roi partageant son encas de nuit avec le grand poëte ou plutôt le comédien honnête homme, car c’était la qualité d’acteur qui, chez Molière, révoltait principalement ces messieurs, est une belle leçon donnée au préjugé vulgaire ; elle a sans doute porté son fruit, mais il n’est pas mauvais de la remettre sous les yeux. M. Ingres a donné la conséquence de son talent à l’anecdote racontée dans les Mémoires de madame Campan, qui a d’ailleurs tous les caractères de l’authenticité. Louis XIV et Molière, sans avoir eu peut-être de conversation précise à ce sujet, s’entendaient politiquement tous deux ; ils poursuivaient une idée que le 17ème siècle ne comprit pas. Le roi soutint le poëte dont il était le collaborateur secret ; il lui demandait les marquis et il lui accorda Tartuffe.
Nul tableau ne devait donc être plus à sa place que celui-là au foyer de la Comédie-Française, ce salon d’honnêtes acteurs ainsi honorés dans la personne de leur aïeul et de leur maître à tous. Pour cette occasion, rencontrer ce sujet est un de ces bonheurs qui n’arrivent qu’aux grands artistes.
Le tableau offert par M. Ingres est sur papier soutenu de toile. Cette manière de peindre a beaucoup de solidité ; la couleur pénètre les pores du papier et fait pour ainsi dire corps avec lui, de même qu’elle pénètre l’enduit encore humide de la fresque. Ce souci de l’avenir sied bien à ceux dont le nom sera immortel et qui comptent sur la postérité. Le temps d’ailleurs achève admirablement ce qu’il ne détruit pas, et il fait bon lui confier des peintures ; il est de moitié dans la couleur du Titien.
La composition disposée avec cet ordre, ce rythme et cette clarté qui sont le cachet des maîtres, est compréhensible au premier coup d’œil, même pour quelqu’un qui ne connaîtrait pas l’anecdote.
C’est dans la chambre à coucher du roi que la scène a lieu. Une tenture de damas rouge d’un ton amorti, merveilleusement propre à faire ressortir les figures, tapisse la muraille du fond. Au milieu s’élève une cheminée monumentale à pilastres, portant les armes de France dans son couronnement. Un lit à courtines bleues, à lambrequins ornés de galons et de glands d’or dans le plus pur style de l’époque, occupe l’angle du tableau à la droite du spectateur ; l’espace réservé que ne peuvent franchir les courtisans est circonscrit par une sorte de galerie basse à balustres ventrus semblable à celle qui, dans les églises, sépare le chœur de la nef et les officiants des fidèles. En effet, la chambre du roi n’était-elle pas alors une sorte de sanctuaire où les grands venaient adorer leur idole, qui, du reste, plus difficile que le vrai Dieu, n’ouvrait la porte de son temple qu’aux gens les plus titrés ou par faveur sollicitée longtemps ?
Cette action si simple aujourd’hui de découper une volaille et d’en servir une aile au poëte, plus grand pour nous que Louis XIV, évanoui déjà dans l’ombre du passé, était alors quelque chose d’énorme, d’inouï, de stupéfiant, que ne réussiraient pas à peindre tous les adjectifs et tous les superlatifs de madame de Sévigné.
Le roi, coiffé de son chapeau à plumes, en justaucorps et en chausses du matin, est assis en face de son convive, près du guéridon sur lequel messieurs de la bouche ont placé l’encas de nuit, car l’appétit du roi ne doit pas pouvoir dire, plus que sa personne : » J’ai failli attendre. » Peut-être, cette fois, Louis XIV n’avait-il pas faim ; mais il voulait marquer son estime pour Molière tout en faisant sentir à ses courtisans, si polis cependant, leur manque d’intelligence et de savoir-vivre.
On lit sur la figure du roi, vue de pleine face, la bienveillance pour le poëte en même temps qu’une nuance de sévérité hautaine à l’endroit des courtisans. Cette double expression, très difficile à peindre, est parfaitement rendue ; le geste cordial et franc par lequel le monarque montre son convive a une légère affectation de familiarité. On voit que la leçon a besoin d’être soulignée pour être comprise. Le grand roi se fait le compagnon du grand poëte quelques instants, afin de le poser nettement l’égal des plus nés et des plus fiers. Qui a mangé à la table du roi peut manger à la table de tout le monde. L’honneur ne sera plus désormais au convive, mais à l’hôte. Tout cela est indiqué avec une grande finesse par l’artiste suprême que son commerce habituel avec les dieux et les déesses, types abstraits du beau, n’a pas empêché, comme on voit, d’étudier profondément le cœur humain et de s’approprier toutes les ressources de la mimique.
Molière se présente de profil ; l’abondante perruque du temps descend en boucles nombreuses le long de la joue brune du poëte, que les portraits et les mémoires de l’époque peignent comme très basané ; on reconnaît ce nez fort, cette lèvre large et rouge, ce sourcil noir et fourni, cette moustache en virgule, traits caractéristiques de la physionomie traditionnellement connue de Poquelin. C’était là une difficulté assez grande, car il n’existe pas, que nous sachions du moins, un portrait de Molière en profil, et il faut une rare certitude de dessin et une profonde intuition pour reconstituer, de façon à le faire reconnaître, cet aspect si différent de la face. Molière est assis timidement sur le bord de son siège, les jambes rapprochées, tandis que le roi s’étale largement dans son fauteuil ; il sent sa valeur personnelle, sans doute, et en lui-même il se trouve digne de l’honneur que lui fait le monarque ; mais si le philosophe, élève de Gassendi, sait que tous les mortels sont égaux, l’homme pratique, l’observateur des travers sociaux, n’ignore pas non plus ce que c’est qu’un comédien, eût-il tout le génie d’Aristophane, de Plaute et de Térence, vis-à-vis du plus grand roi du monde, comme on disait alors. Son âme est pénétrée de la haute faveur qu’il reçoit ; toutes les humiliations subies, toutes les hontes bues, tous les affronts essuyés sont effacés dans cette minute glorieuse, qui dut être le point radieux de son existence, le clou d’or scintillant sur la paroi sombre.
Sans croire que Molière eût tous les instincts modernes que l’ingéniosité de la critique lui prête généreusement après coup, comme s’il eût connu par anticipation le décalogue révolutionnaire des droits de l’homme, il possédait à un plus haut degré que les gens de sa sorte le sentiment de sa dignité. Il était si fier, disent ses contemporains, non sans quelques surprise et avec une nuance de blâme, il était si fier qu’il n’acceptait de dîners et de présents qu’à la condition de les rendre, ce qui semblait de sa part une prétention excessive, et encore Molière était-il valet de chambre du roi, ce qui le relevait et le justifiait un peu.
Il fallait toute la hardiesse et toute la sécurité de talent de M. Ingres pour risquer cette pose, qui suit exactement le dessin de la chaise, et se brise aux mêmes angles, comme celle d’un dieu égyptien ; mais le génie sait retrouver les mouvements primitifs, si modifiés par la civilisation. Molière, ici, ne compose pas son attitude ; il est trop surpris, trop troublé, trop ému, trop ravi ; son corps, que ne régit plus la volonté, se place tout seul et s’arrange d’après l’impulsion de la nature. À peine s’il touche aux mets placés devant lui, et la main que n’occupe pas la fourchette semble chercher son cœur. Son vêtement de couleur sombre laisse toute la valeur à sa physionomie, où l’expression de la reconnaissance domine l’orgueil bien légitime du triomphe.
M. Ingres a compris que pour cette scène eût toute sa portée, il lui fallait beaucoup de spectateurs, et quoique son cadre fût petit, il a trouvé moyen d’y mettre de la foule. L’huissier vient d’ouvrir la porte de la balustrade, près de laquelle il se tient appuyé sur sa hallebarde.
Les ducs et pairs, les ducs à brevet, les favorisés du justaucorps bleu, les comtes, les marquis et tous les habitués de l’Œil-de-Bœuf, qui grattaient du peigne la porte trop lente à s’ouvrir, devant laquelle ils faisaient souvent pied de grue, s’amoncellent autour de la balustrade en groupes pressés.
Ils arrivent faisant la révérence, la jambe tendue comme pour un départ de menuet, avec cette allure de pigeon pattu que donnait aux courtisans le soulier à talon rouge et à rosette formant cravate, dans toute la gloire de leurs rhingraves, de leurs canons et de leurs perruques in-folio poudrées de poudre blonde. M. Ingres, malgré la gravité ordinaire de son style, ne s’est pas refusé une légère pointe de caricature, tout en restant dans les conditions les plus rigoureuses de l’histoire ; en dépit de son respect pour ce grand siècle, il a immolé quelques marquis ridicules à Molière. Le jeune blondin effaré de voir un histrion à la table du roi serait bien capable de faire des ronds dans le puits, comme le marquis raillé par Célimène, et le vieux seigneur qui s’assure, en enfourchant des besicles sur son nez, de ce phénomène incroyable à l’œil nu, déploie une sottise sérieuse et solennelle des plus risibles ; en revanche, l’homme de qualité campé dans le coin de la toile, son manteau de commandeur sur l’épaule, a la tournure la plus fière et la plus magistrale ; peut-être qu’au fond il n’a pas grande estime pour ce bouffon à qui Despréaux lui-même disait :
Dans le sac ridicule où Scapin l’enveloppe,
Je ne reconnais plus l’auteur du Misanthrope.
Mais le roi a parlé ; le roi ne peut faillir, et l’on respectera désormais le sieur J.-B. Poquelin, dit Molière. Un peu en arrière, un prélat semble mécontent de la protection accordée par le monarque à ce faiseur de comédies, à ce farceur qui, selon l’opinion de Chapelain, commune d’ailleurs à beaucoup d’esprits élégants de l’époque, » ne se gardait pas assez de la scurrilité. «
Si nous rapportons cette phrase assez irrévérencieuse, ce n’est certes pas pour rabaisser Molière, mais bien pour rehausser Louis XIV, dont l’action était en réalité plus noble, plus audacieuse et plus choquante pour les préjugés du temps qu’on ne saurait se l’imaginer aujourd’hui. Molière n’avait pas alors l’auréole qui depuis a rayonné autour de sa tête, et l’on en faisait un cas fort médiocre.
Des officiers de bouche portant des flacons sur un plateau meublent le coin opposé de la composition, pleine d’équilibre et balancée avec cette science profonde des groupes qui disparaît de jour en jour ; car maintenant on ne sait plus faire un tableau.
Cette scène anecdotique, traitée en esquisse terminée, a une vivacité et une finesse de touche qui pourraient surprendre, lorsqu’on songe que M. Ingres atteint, s’il ne dépasse soixante-dix-huit ans ; mais ce qui est immortel n’a pas d’âge. La couleur est franche, brillante, abordant sans crainte les tons vierges, le bleu, le rouge, le jaune, le vert, tels qu’ils sont dans la nature. M. Ingres, que l’on accuse d’avoir une palette monochrome, parce qu’il n’enfume pas ses toiles de glacis et de sauces, survivra à tous les prétendus coloristes de ce temps. Voyez son Œdipe devant le Sphinx, son Portrait de Bartolini, sa Chapelle Sixtine : le travail du temps en a fait des Giorgione et des Titien. M. Ingres peint des tableaux neufs, voilà tout, lorsque tant d’autres ne peignent que de vieux tableaux qui, dans moins d’un siècle, seront invisibles.
L’Artiste, « La néo-critique. À propos de M. Ingres », 14 février 1858
Jusqu’à présent, de naïfs écrivains, mettant en relief les beautés, excusant les fautes inhérentes à la pauvre nature humaine, s’étaient imaginé rendre compte des livres, des pièces de théâtre et des tableaux. Ils se trompaient : tout homme convaincu d’avoir produit quelque chose doit être poursuivi comme un chien enragé, et des injures contre lesquelles un galérien serait en droit de réclamer sont encore trop douces pour lui. La critique n’est pas, ainsi qu’on l’avait cru, une dixième Muse donnant son avis sur les œuvres de ses neufs sœurs, et soulignant, après éloge, l’endroit faible d’un léger coup d’ongle ; la vraie critique est née d’hier, à ce qu’elle prétend du moins, et s’est conféré à elle-même le sacerdoce de l’engueulement, l’apostolat de l’invective ; — le carnaval est bien choisi pour cette apparition. Quelques curieux se sont ameutés autour du tombereau du haut duquel, la joue enflammée, l’œil furibond, elle débite les litanies de son catéchisme d’une voix rauque et ramant des bras dans l’air. Elle sait bien que si elle parlait on ne l’écouterait pas ; elle crie.
Qu’elle s’amuse à insulter aux renommées les plus pures, c’est un moyen d’attirer sur soi l’attention qu’on peut employer quand on n’en a pas d’autre à son service, mais elle ne tolère l’admiration chez personne : ceci nous paraît abusif. Ereintez si vous voulez, mais laissez admirer.
Certes, s’il y a dans l’art contemporain une figure haute, sévère et digne, c’est celle de M. Ingres. Cette longue vie a été consacrée, dès l’âge le plus tendre, au culte du beau, à la recherche du style, à l’adoration des maîtres, à l’étude de la nature vue par son grand côté. Ni l’obscurité, ni la misère, ni les dégoûts de toute sorte n’ont fait vaciller un instant cette conviction inébranlable, cette flamme toujours allumée, ce génie opiniâtre et sans défaillances. Les années mêmes ne semblent pas avoir de prise sur ce grand artiste ; presque octogénaire, il vient de faire la Source, une merveille de jeunesse, de grâce et de fraîcheur ; à l’Exposition universelle, qui a été pour lui une sorte d’apothéose anticipée, il a fait gagner à la France la suprême couronne du grand concours de l’art. Seul, peut-être, entre les maîtres modernes il pourrait s’asseoir à côté des demi-dieux de l’antiquité et de la renaissance ; malheureusement, la nouvelle critique ne compte pour rien le plafond d’Homère, le Vœu de Louis XIII, Virgile lisant son Énéide, la Chapelle Sixtine, le Martyre de saint Symphorien, Stratonice, le portrait de madame de Vauçay, l’Odalisque, le portrait de Bertin de Vaux, le Vénus Anadyomène et tant d’autres œuvres magnifiques ; elle traite comme un rapin, comme un peintre d’enseignes à bière, elle appelle Chinois cet illustre vieillard honoré de tout le monde, même de ceux qui professent une doctrine opposée à la sienne ; elle lui reproche de tourner des magots à la façon d’un ivoirier. Selon elle, il ne fait que des saints de brique, des odalisques de savon, des apôtres de fer blanc, des dieux de pain d’épice. À son gré, l’Œdipe interrogeant le Sphinx n’est qu’un bonhomme colorié en suc de nicotine ; le divin torse d’Homère ne lui semble qu’un bloc de plâtre saupoudré de cendre ; la Victoire qui couronne le poëte, une figure qu’avouerait l’art grec du plus beau temps, n’est qu’un lourd modèle orné d’ailes de pigeon pattu ; ceux qui vantent M. Ingres sont des niais risibles, des adorateurs crétins d’un fétiche imbécile.
Toujours selon cette critique d’invention récente, le peintre de notre époque qui a le plus approché du beau idéal, dans son œuvre morne et glacé, n’a pas exprimé un sentiment, une croyance, un souffle de vie. Elle ne lui accorde rien ; son trône est de carton, son auréole de plomb doré ; il n’existe pas.
Tel est l’avis de la critique sérieuse, de celle qui ne se balance pas, comme Sarah la baigneuse, aux colonnes des journaux, dans le hamac de ses phrases entrelacées, mais qui, en revanche, écrit mal, et tâche de déguiser son absence d’idées sous la brutalité du langage.
Pour parler avec cette outrecuidance, sans doute cette critique, qui proclame toute critique antérieure non avenue, a longtemps étudié l’art, exploré la Grèce, l’Italie, l’Espagne et les Flandres, visité les musées et les cabinets, comparé les écoles de tous les temps et de tous les pays, appris l’histoire de chaque maître en ses diverses manières, observé ou pratiqué, pour s’en rendre compte, les procédés matériels ; elle apporte une doctrine inédite, un idéal supérieur : elle a en réserve, pour mettre sur le socle des idoles qu’elle a la prétention de renverser, un dieu nouveau en vrai marbre et non en carton-pâte, avec une auréole faite de rayons contrôlés. La critique frivole, qui ne trouve pas que les Vénus, les madones, les Renommées, les anges de M. Ingres ressemblent à des fagots de coton noyés dans la cuve du teinturier, ne demande pas mieux que de sacrifier au dieu inconnu, des ignolo, car toute admiration est un honneur de plus ; mais elle voudrait seulement qu’on le lui montrât. En attendant, elle célèbre Phidias, Raphaël, M. Ingres et même M. Delacroix dans les meilleurs termes qu’elle peut. Tâchant de garder les formes de l’art en parlant de l’art, elle serait heureuse si ses phrases n’étaient pas trop indignes des marbres du Parthénon, des fresques du Vatican, des tableaux remarquables de nos expositions ; n’ayant pas l’amour-propre d’être crue sur affirmation ou négation, elle prend la peine de reproduire, en la transposant d’un art à l’autre, l’œuvre dont elle s’occupe, avec sa composition, son dessin, son style, sa couleur, ce qui n’est pas si aisé que la néo-critique s’imagine. Ne danse pas qui veut sans balancier sur le fil tendu de la phrase. Beaucoup qui l’on essayé sont tombés lourdement et se sont cassé le nez au milieu des rires de la foule, et il vaut encore mieux se bercer dans un filet de périodes que d’être étendu à terre tout à plat ; Rabelais dirait plat comme pore ; mais la critique ancienne est trop polie pour se servir d’une locution si gauloise.
Un peu de dilettantisme ne messied pas non plus en pareille matière. Pour écrire sur l’art, il faut le comprendre, c’est-à-dire l’aimer, en faire son travail et sa joie, en pénétrer toutes les délicatesses, en sentir tous les raffinements, ce qui exige une nature fine, cultivée et choisie. Le dilettante s’inquiète de l’idée de l’artiste, de ses principes, de la portée de son œuvre, mais il cherche d’abord la beauté, le style, le caractère, moyens de traduction sans lesquels les pensées les plus hautes restent à l’état abstrait ; il préfère, par exemple, le torse de Niobide qu’on voit dans la glyptothèque de Munich à un carton mal dessiné, contînt-il toute l’histoire de l’avenir, et aux séries d’Hogarth démontrant les inconvénients de l’ivrognerie ou du jeu, un Zebec de Decamps appuyé contre un mur blanchi à la chaux ; il croit à l’autonomie de l’art ; que l’art s’exprime lui-même, c’est assez. Quiconque pense autrement peut être un philosophe, un moraliste, un homme d’état, un mathématicien, mais à coup sûr il ne sera ni poëte, ni musicien, ni statuaire, ni peintre. L’art n’est fait ni pour dogmatiser, ni pour enseigner, ni pour prouver ; son but est de faire naître l’idée du beau ; il élève la nature humaine par son essence même : lire des vers, écouter une mélodie, regarder un tableau ou une statue est un plaisir intellectuel déjà supérieur, et qui détache de la grossière réalité des choses. Il n’est pas besoin, d’ailleurs, que l’œuvre contienne précisément un système, une règle, une maxime, sans cela les images d’Hogarth, que nous citions tout à l’heure, et les quatrains de Pibrac seraient le nec plus ultra de la peinture et de la poésie.
Quant à la morale absolue, ce n’est ni au musée, ni à la bibliothèque, ni au théâtre qu’on l’apprendra, mais bien à l’église, où les prêtres l’expliquent à qui veut l’entendre d’après l’Évangile de la révélation.
La critique nouvellement éclose prétend que nos artistes d’aujourd’hui manquent de foi et de moralité. Ils en ont bien autant que Pérugin, que Léonard de Vinci, qui passèrent tous deux pour athées, et que les autres grands maîtres de la Renaissance, libres penseurs, néo-païens pour la plupart, et dont la vie ne saurait être citée comme fort exemplaire. Ils dessinent plus mal et peignent moins bien, voilà tout. Les forces vives du siècle parvenu déjà à sa maturité se portent ailleurs ; le travail le plus urgent est à cette heure d’aménager la planète où nous vivons d’après les nouvelles découvertes de la science, découvertes qui changent les rapports des existences modernes ; des esprits enfiévrés pressent cette installation de tous leurs vœux, de tous leurs efforts, de tous leurs capitaux. La littérature et les arts, quoi qu’on die, ne font pas grand bruit maintenant dans leur petit coin. Le sifflet des locomotives passant à toute vapeur avec un grondement de tonnerre.
Pourtant, nos peintres tels qu’ils sont, ont fait de l’école française moderne la première école du monde ; elle sera comptée par la postérité avec les grandes écoles d’Italie, d’Espagne et de Flandre, auxquelles nul n’eût songé à les comparer au commencement de ce siècle. La métropole de l’art n’est plus maintenant Rome, c’est Paris. Il fallait toute la perspicacité de la critique actuelle pour voir dans cette floraison touffue et magnifique des symptômes d’énervement et de décadence ; jamais tant d’individualités remarquables ne se sont produites, et la liste serait longue des peintres dont les tableaux figureront aux galeries de l’avenir. En littérature, la pléiade ne compte pas moins d’étoiles. Toutes les formes ont été essayées, toutes les routes tentées, car notre temps a pour caractère d’être cosmopolite et synchronique ; il loge sa fantaisie dans tous les pays et tous les temps, mais sous ces travestissements divers, son originalité ne ressort que mieux. Que ce Panthéon de gloires semble une étable à quelques esprits mal faits, cela ne nous étonne guère ; toutefois, si nous admettons pour une minute ce point de vue, la critique qui se propose de nettoyer ces étables d’Augias nous paraît manquer de modestie. Hercule était un demi-dieu, et pour cette besogne il détourna un fleuve : elle pourrait tout au plus dire comme Odry dans la Canaille : » Je balaye ma patrie, il n’y a pas d’affront, » seulement la patrie n’est pas si crottée qu’on veut bien le dire, et la Muse laisse traîner sa tunique étoilée d’or sur une splendide mosaïque que rayent seuls les souliers à gros clous du balayeur.
La Gazette des Beaux-Arts, 1er mars 1860
Quoique les coloristes prédominent à cette exposition, il ne faudrait pas croire que les dessinateurs n’y fussent pas représentés. La variante de Paolo et Francesca, par Ingres, est une délicieuse et délicate peinture qu’on dirait arrachée à un manuscrit du moyen âge. Jamais la petite moue charmante du baiser ne fut plus gracieusement plissée contre une joue pudiquement rose. Le cou de Paolo s’enfle de désir, comme une gorge de pigeon, et le roman de Lancelot du Lac s’échappe de la main distraite de la jeune femme. Ce couple amoureux, si durement puni de sa faute dans ce monde et dans l’autre, nu lut pas davantage ce jour-là. — Outre ce tableau, Ingres a quatre dessins merveilleux sur lesquels nous écrirons un article explicite, le Martyre de saint Symphorien, l’Apothéose d’Homère, l’Apothéose de Napoléon 1er,et l’Odalisque et son esclave, où brille la pensée pure du grand maître par un crayon aussi noble et aussi ferme que le ciseau de Phidias.
La Gazette des Beaux-Arts, 15 mars 1860
L’exposition du boulevard italien est riche en dessins de M. Ingres ; elle en possède quatre, et des plus importants. Nous ne sommes pas de ceux qui restreignent l’illustre maître du dessin en lui déniant la couleur ; au contraire, nous lui trouvons, et, croyez-le, ce n’est nullement un paradoxe de notre part, une couleur superbe ; il ne faut, pour s’en convaincre, que regarder avec des yeux non prévenus la Chapelle Sixtine, le Portrait de Bartolini, l’Œdipe devinant l’énigme du Sphinx, le Jésus remettant les clefs à saint Pierre, le Portrait de madame de Vauçay, l’Odalisque couchée, la Baigneuse assise, la Vénus Anadyomène et la Source, son dernier ouvrage, dont les gris tant blâmés ont pris des tons d’ambre et cette harmonie intense qui charme dans les tableaux des vieux maîtres.
Le Martyre de saint Symphorien excita, lors de son apparition, les polémiques les plus acharnées, et, chose bizarre, ce fut parmi les adeptes de l’école romantique que M. Ingres trouva les plus chaud défenseurs — les purs classiques, — les académiciens ne l’aimaient pas. Il leur semblait un peu barbare ! Cela paraît singulier aujourd’hui, tant il est difficile de recomposer l’atmosphère d’une époque et de replacer les œuvres dans le milieu où elles ont été faites ; mais cette opinion étrange avait ses motifs. M. Ingres, comme les romantiques, remontait franchement aux vraies sources de l’art, c’est-à-dire aux maîtres du 15ème et du 16ème siècle, passant par-dessus toutes les décadences intermédiaires, maniéristes ou pseudoclassiques. — Et il choquait l’Institut presque autant que l’eût pu faire Delacroix. Tout ce bruit s’est apaisé, et maintenant il est banal de louer le Saint Symphorien, le plus beau tableau que l’école française puisse opposer aux écoles d’Italie. La tête du saint rayonne de sublimité, et ses bras ouverts semblent, dans l’avidité des supplices, vouloir présenter une poitrine plus large aux instruments de torture des bourreaux. Les musculatures athlétiques des licteurs ont la violence superbe des anatomies de Michel-Ange, et le proconsul à cheval dans son masque sévère, résume tout la caractère romain. Que dire de la femme qui se penche hors du rempart avec un mouvement si vif qu’il supprime l’espace ?
Dans le dessin quadrillé des lignes de la mise au carreau, l’on voit nettement écrites, de ce crayon si ferme, toutes les intentions et toutes les beautés de la composition peinte. C’est une curieuse étude que de saisir la pensée du maître dans sa forme la plus pure, la plus nécessaire, la plus directe.
Nous admirons beaucoup l’Apothéose de Napoléon 1er, dessin figurant un camée, et l’idée première du plafond exécuté à l’Hôtel de Ville. Cette composition, si antique d’idée, d’arrangement et de style, semble en effet, quelque mérite qu’ait la peinture, appeler l’agate ou la sardoine aux couches blondes et bleuâtres : on la dirait copiée d’un camée inconnu, pendant de l’Apothéose d’Auguste, le chef-d’œuvre de la gravure en pierre fine.
L’Apothéose d’Homère, composition réduite du plafond du Louvre, résume dans un espace étroit la glorieuse théorie de poëtes, d’artistes et de grands hommes qui se groupent au-dessous de l’Iliade et de l’Odyssée, aux pieds du Divin aveugle couronné par la Muse. Le dessin a toute la grandeur du plafond, et l’on peut l’admirer sans se tordre le cou.
L’Odalisque et son esclave rappelle, avec quelques variantes, le tableau qui porte ce nom ; c’est la même grâce nonchalante et voluptueuse, la même beauté antique amollie par les langueurs du sérail ; des rehauts de blanc ajoutent à l’effet de ce dessin très arrêté et très fini.
Le Moniteur universel, « Exposition – Au profit de la caisse de secours des artistes peintres, sculpteurs, architectes et dessinateurs », 21 mars 1860
Nous avons parlé bien longuement de cette exposition, mais le moyen d’être court lorsque chaque œuvre a son mérite, son histoire et sa signification ! Dans ces deux ou trois salles, aucune toile médiocre qu’on puisse passer sous silence ou désigner d’un mot dédaigneusement bref. Parfois un Salon tout entier ne contient pas le même nombre de morceaux remarquables. Outre les tableaux, il y a les dessins qui, certes, valent aussi qu’on les regarde et qu’on s’y arrête avec détail.
M. Ingres a là quatre compositions importantes, burinées de ce crayon si pur et si magistral qu’il vaut le pinceau le plus fier : l’Apothéose d’Homère, l’Apothéose de Napoléon 1er, le Martyre de saint Symphorien, l’Odalisque et son esclave. Quelle science consommée ! quelle grandeur ! quelle beauté ! quel style ! Pour qui sait voir avec l’œil de l’idée, la peinture n’ajoute rien à ce simple trait soutenu de quelques ombres. Tout y est : l’intention y éclate dans toute sa force, les formes s’y modèlent, les lignes s’y accusent avec une incomparable noblesse. L’antiquité a-t-elle rien produit de plus pur, de plus héroïque et de plus idéal que cette Apothéose de Napoléon qui semble cherchée dans les veines de la sardoine ou de l’agathe par un des merveilleux graveurs en pierre fine de la Grèce ou de la Rome des Césars ? Ce dessin-camée, qui, réduit, pourrait retenir à l’épaule d’un empereur son manteau de pourpre, s’est dilaté en vaste plafond à l’Hôtel de Ville. Le fond roux doré sur lequel se détachaient ses figures laiteuses s’est changé en ciel d’azur, et le quadrige aérien, monté par le triomphateur, roule majestueusement dans le vide, précédé des Victoires ailées. Étrange puissance de l’art : le dessin est aussi grand quel le plafond !
Voilà l’Apothéose d’Homère, assis au seuil du temple de Mémoire, ayant à ses pieds ses deux mortelles filles, l’Odyssée et l’Iliade, couronné par la Muse et entouré du cortège d’esprits souverains qui, dans tous les siècles, ont reconnu sa puissance. Jamais roi eut-il une cour plus radieuse que cette élite sacrée entourant le divin aveugle ? — Le croquis d’un bas-relief de Phidias, tracé à la pointe du ciseau sur un bloc de pentélique, serait-il plus beau, plus noble et plus élevé que ce dessin ?
Puisque le Martyre de saint Symphorien orne la cathédrale d’Autun, n’est-ce pas une vive jouissance que de revoir la composition du maître, où l’on retrouve cet agencement serré de groupes, cette puissance de musculature, cette énergie superbe de style, cette fierté de types et cette violence calme qui font du tableau une des toiles modernes les plus étonnantes ? La tête du saint est d’une beauté sublime, et on la devine dans le simple trait qui l’indique. M. Ingres abandonne ici Raphaël pour Michel-Ange, tout en conservant son individualité propre.
Une qualité qu’on n’a pas assez remarquée chez l’auteur du Vœu de Louis XIII, de la Chapelle Sixtine, de l’Œdipe devinant l’énigme du Sphinx, de la Stratonice, de l’Odalisque, c’est la fidélité de couleur locale qu’il impose suivant les sujets. Il est grec, il est romain, il est moyen âge, il est asiatique avec un sentiment exquis des types et des détails caractéristiques. Il prend le style du siècle et du pays à s’y tromper. Ainsi dans l’Odalisque et son esclave, dessin rehaussé de blanc, il rend l’intérieur d’un harem avec une exactitude à laquelle on ne saurait rien reprendre. Les tapis, les tabourets incrustés de nacre, les narghiléhs, tous les accessoires sont d’une réalité irrécusable, et ce corps souple qui s’allonge sous les énervements de l’ennui, faisant ressortir une hanche opulente, pendant que l’esclave agace les nerfs de la guzla, c’est bien celui d’une Géorgienne ou d’une Circassienne, et non pas d’une nymphe antique. De même, Paolo donnant à Francesca ce baiser qui les perdit, semble être une miniature arrachée au roman de Lancelot du Lac.
Le Moniteur universel, « Exposition du boulevard italien – La Source, tableau de M. Ingres », 18 février 1861
Ce chef-d’œuvre livré maintenant à l’admiration publique, nous avions été admis, il y a déjà trois ou quatre ans, à le contempler dans le sanctuaire même dont le grand maître avait bien voulu nous entr’ouvrir la porte, comptant sur notre discrétion. Mais le critique est comme Candaule, le roi de Lydie ; il ne sait pas garder un secret de beauté, et à défaut de Gygès, il prend tout le monde pour confident ; aussi, malgré la défense de M. Ingres, dans la ferveur de notre émerveillement, nous étions-nous hâté d’écrire ces quelques lignes qu’on nous permettra de reproduire, car elles contiennent notre impression tout émue et toute fraîche, et après avoir revu le tableau nous ne trouvons rien à y changer.
» La Source ! tel est le titre de la nouvelle œuvre de M. Ingres, ou du moins celui qui se présente le premier à l’esprit en face de cette charmante composition où l’idéal et la nature se fondent en proportions parfaites. La toile a cette dimension étroite et haute qui est déjà une élégance lorsque le peintre sait la remplir sans gêne.
Sur un fond de roche grise rayé de quelques stries, égayé de quelques filaments de plantes, pariétaires d’un vert discret, se dessine, dans la chaste nudité de ses quinze ans, une figure à la fois mythologique et réelle, une nymphe ou une jeune fille, si vous l’aimez mieux. Un païen y verrait la naïade du lieu ; un chrétien du moyen âge, l’ondine des légendes ; un sceptique de nos jours, une belle enfant qui s’est baignée dans la source, et avant de reprendre ses habits confie quelques instants sa beauté à la solitude …
Elle est là debout, pure et blanche comme un marbre grec rosé par la vie ; ses prunelles couleur de myosotis nagent sur le fluide bleu de la jeunesse ; ses joues ressemblent à des pétales d’églantine effeuillées sur du lait. Un éclair de nacre brille dans son vague sourire entr’ouvert comme une fleur. Son nez délicat laisse la lumière pénétrer ses fines arêtes et ses narines transparentes. Tous ses traits charmants sont enveloppés par le contour le plus suave, le plus virginal dans sa rondeur enfantine, qu’ait jamais tracé la main du peintre. L’enfant est blonde comme Vénus, comme les Grâces, comme Ève ; un or soyeux et frissonnant couronne son petit front antique.
Son bras droit, arrondi au-dessus de sa tête avec un mouvement d’une grâce athénienne, soulève une urne d’argile appuyée à son épaule et dont le goulot pose sur sa main gauche. Du vase à demi renversé tombe l’eau en fusées brillantes, dont la rencontre du rocher fait des perles.
Le bras relevé entraîne la ligne extérieure du corps et lui donne une ondulation serpentine d’une suavité extrême. On suit amoureusement ce contour modulé comme une belle phrase musicale. Il chante et se rythme à l’œil avec une harmonie admirable.
M. Ingres connaît aussi bien que les Grecs les mélodies de la forme, l’eurythmie des poses et la métrique de ce merveilleux poëme du corps humain, — le plus beau vêtement que puisse emprunter l’idéal. — Une jeune fille nue qui a les bras levés, qui hanche, et dont une des jambes fait un peu retraite, tandis que l’autre porte en plein, cela ne semble pas bien difficile à trouver ; eh bien ! le génie de tous les statuaires et de tous les peintres cherchant le beau depuis des siècles n’a rien pu inventer qui dépassât cette conception si simple en apparence.
La nymphe de M. Ingres a quinze ans tout au plus ; hier, c’était un enfant ; aujourd’hui, c’est une jeune fille, et rien de la femme n’apparaît encore dans ses formes pures, virginales, insexuelles même, — si l’on peut risquer un tel mot ; — le sein petit, à peine éclos, teinté à sa pointe d’une faible lueur rose, n’éveille pas plus de désir qu’un bouton de fleur. Le reste du torse, chastement nu, est vêtu de sa blancheur marmoréenne comme d’une tunique de pudeur. On sent qu’on n’a pas devant les yeux des organes, mais des expressions d’idéal : innocence, jeunesse, fraîcheur, beauté ! la vie vierge, la perfection immaculée, une palpitation et une rougeur dans un marbre de Paros !
Des pieds divins, qui n’ont jamais marché que sur les tapis de fleurs de l’idylle syracusaine, servent de socle à cette charmante figure. L’eau qui sourd de la roche en bouillons argentés et qui les baigne de ses caresses transparentes les a pâlis en les refroidissant. Leurs doigts, nobles comme si Phidias les avait modelés, se sculptent dans des tons d’ivoire.
À peine sortie du rocher, la source s’endort en un petit bassin sur des cressons et des plantes d’eau, et sa surface, brunie comme le métal d’un miroir antique, répète, en les renversant et en les azurant un peu, les belles jambes blanches de l’enfant. On dirait que le peintre ne se séparait qu’avec chagrin de sa figure, et qu’il l’a prolongé sous l’eau avant de la quitter à tout jamais.
Louer chez M. Ingres la pureté de son dessin, la finesse de son modelé, l’élévation de son style, c’est un lieu commun qu’il n’est plus guère permis de répéter. Aussi n’en dirons-nous rien. Ce qui nous a surtout frappé dans cette nouvelle toile, c’est la beauté suprême de la couleur. On exposerait la Source au milieu d’une galerie de chefs-d’œuvre flamands et vénitiens, elle supporterait sans désavantage la lutte avec les plus fins coloristes. Jamais chairs plus souples, plus fraîches, plus pénétrées de vie, plus imprégnées de lumière ne s’offrirent au regard dans leur pudique nudité. L’idéal, cette fois, s’est fait trompe-l’œil. C’est à croire que la figure va sortir du cadre et reprendre ses vêtements suspendus à un arbre.
Quelque admiration que nous professions pour les autres tableaux de M. Ingres, la Source nous paraît être la perfection de son œuvre. Au-delà, l’art se perd dans l’impossible ou retourne à Dieu.
Les siècles jaloux ont fait disparaître les peintures d’Apelles, le Raphaël athénien mais nous croyons volontiers que sa Campaspe nue devait être dessinée et peinte comme la Source de M. Ingres. «
La Source appartient à M. Duchatel, et il faut lui savoir gré d’avoir bien voulu se dessaisir pour quelques jours de son trésor, dans un but charitable. — Après tout, a-t-on le droit de posséder tout seul un chef-d’œuvre, concentration lumineuse, quintessence idéalisée du génie humain, et n’en doit-on pas quelquefois la vue au monde ? Pourrait-on, sans crime de lèse-humanité, tenir secret un poëme retrouvé d’Homère, un drame inédit de Shakespeare, l’eût-on payé de tonnes d’or et de liasses de billets de banque ? Une loi d’expropriation pour cause de beauté suprême ne nous paraîtrait pas injuste, en faisant, bien entendu, l’indemnité aussi large, aussi généreuse que possible.
Arrivons maintenant aux autres tableaux de l’exposition, dont le choix intelligent offre beaucoup d’intérêt. Aucun artiste, nous en sommes sûr, ne nous en voudra pas d’avoir commencé par la Source de M. Ingres. À cette hauteur le talent n’a plus de rivaux.
Le Moniteur universel, « Jésus enfant parmi les docteurs, tableau de M. Ingres », 10 avril 1862
Nous venons d’éprouver une de ces vives émotions qui font époque dans la vie d’un critique. Il nous a été donné de voir à l’atelier de M. Ingres la nouvelle toile récemment terminée par l’illustre maître. C’est une chose touchante et sublime que ce persévérant amour de l’art, que cette infatigable recherche du beau à un âge où la main la plus laborieuse a depuis longtemps quitté brosses et palette. En face de cette verte, robuste et féconde vieillesse, si un tel mot peut s’appliquer à la plénitude et à la maturité de la perfection, la honte vous prend d’être si fatigué, si débile, si éteint, sous prétexte de quelques milliers de lignes frivoles jetées aux quatre vents de la publicité ; on rougit de ses lâches aspirations au repos, à la somnolence indifférente, au bien-être abrutissant. On se dit que peut-être il n’est pas trop tard encore pour faire un chef-d’œuvre. La vie est longue à qui la sait bien employer et ne renonce pas à soi-même. Il ne s’aperçoit pas de la fuite des années, celui dont les yeux sont incessamment levés vers l’idéal, et qui chaque jour s’en approche davantage : il est toujours jeune comme l’immortalité. La neige ne s’amasse pas sur le front où brûle le feu sacré du génie !
Ce n’est qu’avec un profond sentiment de respect que nous pénétrons dans ce sanctuaire dont la porte s’entr’ouvre, lorsque sur le chevalet — nous dirions volontiers l’autel — quelque œuvre longtemps caressée attend les regards de l’admiration. Là nous avons vu la Vénus Anadyomène, la Source, ces merveilleuses peintures qui donnent l’idée de ce que pouvait être un tableau d’Apelles, et nous venons de contempler de Jésus enfant parmi les docteurs, une toile à faire croire que Raphaël vit toujours. Là, travaille, solitaire et recueilli, le maître souverain qui n’eut jamais d’autre pensée que l’art et à qui le ciel généreux accorde trois ou quatre jeunesses pour qu’il puisse complètement exprimer l’idée du beau.
Le Jésus parmi les docteurs est un morceau capital dans l’œuvre de M. Ingres. Bien que les dimensions du cadre ne soient pas très-vastes, il ne contient pas moins de trente ou quarante figures de grandeur naturelle, arrangées, contrastées et rythmées avec cette profonde science de composition qui caractérise l’artiste. Aucun vide, aucun trou, comme on dit vulgairement, dans cette ordonnance si sage, si claire, si magistrale, qui rappelle sans y ressembler celle de l’École d’Athènes.
En songeant aux quatre-vingt-deux ans du maître, on pourrait imaginer une de ces œuvres d’une sévérité un peu farouche et morose où la volonté se roidit pour suppléer l’inspiration, où la suprême expérience s’efforce d’écrire âprement son dernier mot à travers les décolorations et les obscurcissements de l’âge. Il n’en est rien. L’aspect du tableau est frais, tendre, lumineux ; une fleur de jeunesse le veloute ; nulle aridité, nulle pesanteur ; il y a même des naïvetés charmantes, d’adorables puérilités, comme si le génie du peintre avait ce don d’enfance, signe et récompense des âmes prédestinées.
On sait avec quel soin M. Ingres traite l’architecture. L’appartement où se passe la scène si dramatiquement pittoresque de la Stratonice reconstruit l’intérieur antique dans ses moindres détails. Il a restitué de la façon la plus probable le style judaïque, en disposant la salle du temple qui sert de fond à son Jésus parmi les docteurs. Un hémicycle avec voûte en cul-de-four, éclairé par cinq lampes suspendues, forme un saint des saints où sont exposées les tables de la loi. D’autres hémicycles, de dimension moindre, se font symétrie de chaque côté du grand. Ils sont percés de portes communiquant avec l’extérieur et à demi voilés de rideaux. Deux colonnes d’ordre salomonique, cannelées de stries en spirale et festonnées de ces ceps de vigne où des enfants jouent parmi les pampres et les grappes, si fréquemment employés par l’ornementation juive, appuient leurs bases sur un stylobate servant d’estrade ou de chaire. Une double marche y accède. À droite et à gauche règne un large banc de pierre, siège des docteurs ; cette disposition laisse libre le milieu du tableau et laisse voir un pavement alterné de losanges et de disques en marbre rouge et vert. Toute cette architecture est d’un ton neuf, lumineux et tranquille, d’une fermeté et d’une assiette de lignes admirables, d’une perspective si parfaite qu’il semble qu’on pourrait enjamber le cadre et entrer dans la toile comme dans un milieu réel.
L’enfant Jésus est assis sur l’estrade, vêtu d’une robe rose et d’un manteau bleu de ciel d’une exquise douceur de ton ; il ne discute plus. Quelques mots lui ont suffi pour faire taire les sophismes et les arguties de la scolastique pharisienne. Il prêche, il enseigne, il proclame l’idée nouvelle. Ses yeux regardent le ciel d’où lui vient sa science et d’où descend le Dieu qui, chez lui, se mêle à l’enfant. La sublimité n’efface pas sur sa figure rayonnante les grâces de son âge. C’est bien le fils de Dieu, mais c’est aussi le fils de l’homme ou plutôt de la femme. Ce grand orateur qui confond le savoir des prêtres aurait besoin d’une chaise d’enfant. Ses jambes trop petites n’atteignent pas le sol, et ses beaux pieds sans appui flottent dans le vide, recourbant, avec une adorable naïveté puérile, leurs doigts frais, délicats et tendres comme des boutons de fleur.
Près de lui sur l’estrade, un vieillard décrépit à longe barbe blanche, affaissé sous sa draperie, s’appuie contre la colonne dans un accablement de surprise, dans une prostration d’épouvante. Il vient de se faire une grande ruine en lui. Sa doctrine s’est écroulée. Sa sagesse, si péniblement acquise par l’étude, la méditation et le commentaire des textes, lui paraît vaine à côté de la sagesse de cet enfant. Le docteur imberbe a vaincu le docteur barbu. La lumière vient d’autre part. Elle ne luit plus derrière le voile du sanctuaire, dans la pénombre des arcanes et des symbolismes, gardée par les prêtres, les lévites et les savants.
Un autre docteur moins âgé, placé également près de Jésus, n’a pas l’air d’accepter encore sa défaite ; il relève la tête et se tourne à demi vers un interlocuteur debout derrière lui, comme pour lui communiquer un argument spécieux, une difficulté impossible à résoudre, qu’il vient de trouver dans un vieil arsenal de sophiste ; mais l’autre, tout à la divine parole, ne paraît pas disposé à écouter l’objection.
Sur les deux bancs sont assis en file les docteurs, divers d’âge, de physionomie, de caractère et d’attitude, qui semblent, si l’on peut risquer cette expression, faire la haie au regard pour le conduire au centre du tableau où l’enfant divin rayonne comme une étoile.
Quel art profond et quelle hardiesse savante dans cet arrangement en apparence si simple ! M. Ingres seul pouvait trouver cet ingénieux moyen de faire prédominer une figure enfantine, — le Jésus a douze ans à peine, — sur tout un sanhédrin de personnages vénérables étoffés de manteaux et d’amples vêtements.
Le premier, assis sur le banc de gauche, est un type maigre, ardent, plutôt vieilli que vieux, à profil caractéristiquement juif, un mystique à coup sûr, qui porte sur sa peau bronzée les hâles du désert où plus d’une fois il a dû s’enfoncer, vivant de sauterelles, pour deviner les grands problèmes obscurs que l’enfant de Marie vient d’éclairer d’une lueur si vive ; drapé dans son grand manteau bleu d’un jet superbe, il a cette fixité de pose que donne l’absorption de l’esprit cherchant des fins de non-recevoir et n’en trouvant pas.
Les autres docteurs de la file, esséniens, pharisiens, kabbalistes, sont agités diversement. Ceux-ci sont convaincus, ceux-là doutent, d’autres nient encore ; mais tous sont étonnés et subissent, selon leur nature, l’ascendant irrésistible. Malgré eux, malgré les révoltes de l’amour-propre, leur sagesse s’humilie et reconnaît son néant. Elle vient de la terre, et l’autre arrive du ciel.
Sur le banc de droite on voit d’abord un personnage d’une tournure si noble et si majestueuse qu’on le prendrait volontiers pour un mage ou un roi d’Orient. Ses cheveux sont attachés sur sa nuque ; un manteau rouge à plis fins et larges recouvre sa robe comme une pourpre, et, la tête demi-tournée, il parle à son voisin avec un calme aristocratique. Ce docteur-là doit descendre de quelque roi de Juda. Le voisin, homme à figure énergique et colorée, à forte barbe noire, asiatiquement coiffé d’une sorte de turban, semble discuter vivement la phrase que l’autre approuve. Plus loin des docteurs ont consulté les textes ; des rouleaux de parchemin et des livres gisent à leurs pieds. La vieille science écrite n’a pas trouvé de réponse à la science improvisée de l’enfant.
Pendant cette séance, inquiète de la disparition de Jésus, la sainte Vierge est entrée dans le temple. On l’aperçoit debout parmi quelques gens du peuple à droite, derrière le banc des docteurs, de profil et chastement drapée d’un vêtement bleu-céleste. Sur son visage, à l’anxiété calmée de la mère, se mêle un effarement respectueux. Eh quoi ! son fils, un enfant qui tout à l’heure jouait avec les rubans de copeaux sur l’établi de saint Joseph, haranguant les docteurs de la loi ; ce petit, connaissant à peine ses lettres, parmi ces vieux si savants, blanchis dans l’étude et s’en faisant écouter ! C’est donc vrai qu’il est un Dieu, ce doux Jésus, si tendre et si docile !
Tous ces sentiments sont rendus avec une simplicité croyante, une foi naïvement familière disparue de l’art depuis les peintures du moyen âge. M. Ingres a trouvé là ce que cherche si laborieusement Overbeck. Cette figure de vierge au manteau d’azur semble détachée d’un panneau peint par l’Ange de Fiesole. C’est la même fleur de pureté et de grâce séraphique.
Nous ne pouvons décrire un à un les personnages qui remplissent la toile au-delà des bancs où siègent les docteurs, ne montrant parfois qu’une tête, moins que cela, un trois quart ou un profil perdu. M. Ingres excelle à nouer des groupes, à les rattacher les uns aux autres, à peupler un coin vide, à former avec quelques figures une foule touffue où tout s’entrelace sans confusion, à faire sortie la richesse de la sobriété par le jet savant des draperies, la diversité des attitudes, l’enchevêtrement des corps, la hardiesse des raccourcis, le jeu libre et certain des musculatures. Notons, cependant, un pauvre presque difforme entré à la suite de la Vierge et dont la main retournée s’appuie en se rebroussant à la balustrade du banc. L’idéal, comme on voit, n’empêche pas le réalisme et Raphaël lui-même a introduit un mendiant hideux entre les colonnes torses d’une de ses grandes compositions.
La beauté des têtes, la perfection des extrémités, l’originalité des poses, la grandeur du style méritent des éloges sans restriction. Le Jésus parmi les docteurs n’a d’égal dans l’œuvre de M. Ingres que le plafond d’Homère ; mais nous insisterons sur les draperies. Jamais artiste, statuaire ou peintre, nous n’en exceptons ni Phidias, ni Raphaël, ni Léonard de Vinci, n’a creusé le pli d’un œil d’un ciseau ou d’un pinceau plus sûr, ne l’a fait filer d’un jet si noble, l’élargissant, le rétrécissant, le suspendant autour des formes, comme une caresse ou une glose du contour. Quelques-unes de ces draperies causent cette sorte d’enchantement qu’apporte l’absolu. Il est impossible qu’elles soient plus parfaites. À aucune époque de l’art la mélodie du corps humain n’eut un plus harmonieux accompagnement. On ne saurait trop admirer ici l’art profond de M. Ingres, qui, ayant des vieillards pour personnages et ne pouvant leur donner que du caractère, a mis la beauté dans les draperies. Les tons dont elles se colorent ont une franchise qu’éludent trop souvent nos peintres modernes par des grisailles frottées de glacis. Les rouges, les bleus, les verts, les jaunes, s’accusent en pleine lumière et ne s’évanouissent pas dans l’ombre, où ils gardent leurs valeurs. Quand le temps aura mis sa blonde patine sur ces tons vifs, le tableau aura l’éclat intense d’un Giorgione, et les années, qui éteignent les autres toiles, feront resplendir le Jésus parmi les docteurs.
Le Moniteur universel, « Tableaux et dessins offerts par divers artistes à un confrère paralysé », 14 décembre 1864
Parmi les maladies, fléaux de la pauvre humanité, il en est de malicieusement cruelles et qui semblent chercher avec une animosité intelligente le point vulnérable du patient. Ainsi la surdité interpose son mur entre le monde des sons et Beethoven ; la cécité clôt les yeux d’Homère, de Milton, d’Augustin Thierry, ces grands voyants, et ne leur laisse plus que la vision intérieure ; la claudication prend par le pied Walter Scott et lord Byron, ces esprits remuants et voyageurs. En train de peindre Jouvenet sent la paralysie s’abattre sur son poignet et lui faire lâcher ses pinceaux, qu’il ramasse de la main gauche en vaillant artiste, trouvant encore le moyen de faire des chefs-d’œuvre. Pourquoi n’est-ce pas le musicien qui est aveugle, le peintre sourd et le piéton manchot, se demande-t-on en présence d’une de ces infirmités qui font leur choix et s’attaquent à la faculté dominante en neutralisant son moyen de perception et d’expression ?
Une de ces fatalités est tombée sur un artiste plein de talent et de courage. La paralysie lui a rendu le travail impossible, et les artistes ses confrères sont accourus à son aide avec un cordial empressement. Tous ont contribué par un tableau, par une esquisse, par une étude, par une aquarelle, par un morceau marqué à la vraie griffe du génie, à former une riche et intéressante galerie qui sera exposée le mercredi 14 décembre, et vendue le jeudi 15, à l’hôtel Drouot.
On sait combien sont rares dans les ventes les peintures de M. Ingres. L’illustre auteur du plafond d’Homère, de la Source, de Jésus parmi les docteurs, a envoyé pour cette bonne œuvre une tête magnifique, un homme de profil, à barbe noire, le col nu, un bout de draperie sur l’épaule, dessinée avec une telle maestria et colorée d’un si beau ton qu’on la prendrait pour un morceau coupé dans une toile de Raphaël. C’est sans doute une étude pour un des docteurs qui écoutent l’Enfant divin en méditant quelque captieuse objection.
Le Moniteur universel, « Galerie Pourtalès – Peintures », 28 janvier 1865
[…] La France a un Claude Lorrain baigné dans les ors fluides du couchant et dont la composition se trouve sur le Livre de vérité où le grand paysagiste consignait ses croquis ; des Mignard, des Greuze, un Boucher représentant l’atelier d’un peintre, une merveille d’esprit, de couleur et de touche ; l’Amour et Psyché, de David, bonne et savante peinture mythologique ; une étude du pape VII et du cardinal Caprara peinte pour le tableau du Sacre, du même, morceau admirable ; Raphaël et la Fornarina, de M. Ingres, toile exquise, qui semble avoir été peinte par l’ange d’Urbin d’après son modèle favori.
Le Moniteur universel, « Ingres », 23 janvier 1867
L’art vient de se faire une perte irréparable. Ingres n’est plus, et quoique sa vie ait été prolongée au-delà des bornes ordinaires, il semble qu’il soit mort jeune. En effet, sa robuste vieillesse, qui paraissait devoir égaler et même dépasser celle du Titien, n’a connu ni la langueur morale ni l’affaiblissement physique. Le jour où il a subi la première atteinte du mal auquel il a succombé, il avait travaillé jusqu’à la tombée de la nuit, mettant encore en pratique le précepte d’Apelles, Nulla dies sine linea. Et quand on lui demandait pourquoi lui, le maître souverain, il étudiait à son âge comme un écolier, il répondait fièrement : » Pour apprendre. » Le soir même, il recevait des amis, on faisait de la musique dans son salon, et jamais il ne fut plus animé, plus brillant, plus enthousiaste, plus plein de verve et de lyrisme. Avant de s’éteindre, la lampe jetait un suprême éclat. Ménandre disait que les dieux aiment ceux qui meurent jeunes, mais ils aiment aussi ceux qui meurent vieux dans leur gloire, leur force et leur génie.
Avec Ingres, on peut le dire, disparaît le dernier maître, selon le sens élevé qu’on attachait jadis à ce mot. Le grand art a fermé son cycle, et la place que l’illustre vieillard laisse vide, personne, même dans les complaisances secrètes de son orgueil, n’ose se flatter de la remplir. En mourant, il a posé sur l’autel ce flambeau de l’idéal que Phidias, à travers les âges, avait passé à Raphaël, et que lui, leur adorateur fervent, tint élevé pendant plus de deux tiers de siècle. Qui désormais le reprendra pour en secouer la flamme et en faire jaillir ces étincelles semblables à des étoiles ?
Quel pur et noble exemple que cette longue existence consacrée au culte du beau sans une minute de découragement, de fatigue ou de doute ! En vain les écoles se dispersaient, les systèmes et les goûts changeaient, Ingres restait immuable, opiniâtre dans son effort, fidèle à ses dieux, insensible au dédain, à la raillerie, à la misère, toujours plus enivré de son rêve qui lui masquait la réalité, car cette vie terminée presque en apothéose, comblée de tous les honneurs qu’on puisse accumuler sur le génie, a eu les commencements les plus âpres, les plus durs, les plus laborieux. Que d’années de luttes obscures, de travaux ignorés, d’études persévérantes, de stoïques sacrifices avant qu’un rayon vînt chercher dans l’ombre cette tête qui plus tard devait être si lumineuse ! Combien même parmi les plus fermes se seraient rebutés et, voyant le succès tarder si longtemps, auraient fait des concessions aux goûts et aux modes éphémères de l’art ! Mais Ingres était incapable d’une telle faiblesse : la volonté chez lui égalait le talent ; il avait le génie et le caractère ; rien au monde n’eût pu le faire dévier de la route où il marchait solitaire, mais convaincu qu’il ne s’égarait pas et les yeux fixés sur un but invisible pour tous. Aucune brume ne pouvait lui voiler l’astre du beau.
L’art prit Ingres tout enfant. Son père, qui était à la fois sculpteur et peintre, lui fit d’abord apprendre la musique et le violon ; mais la vue d’une copie de Raphaël, au musée de Montauban, ravit pour l’ange d’Urbin sa jeune âme d’un amour et d’une admiration qu’une vie presque séculaire n’a fait qu’augmenter. Sa vocation était dès lors fixée ; il avait rencontré son idéal, et ne devait pas en chercher d’autre. Atteindre les pieds de Raphaël et les baiser, comme il le disait lui-même avec une respectueuse ferveur, il ne pouvait pas concevoir une ambition plus haute. Cette ambition, on peut dire qu’il l’a réalisée. Raphaël relèverait pour le faire asseoir près de lui ce disciple pieux. L’enfant de la Madone de Saint-Sixte pourrait embrasser le Jésus que tient sur ses genoux la Vierge du Vœu de Louis XIII, pendant que leurs mères échangeraient un sourire amical comme deux sœurs également belles.
On ne se rend pas bien compte aujourd’hui de la puissance d’abstraction qu’il fallut à Ingres pour s’isoler du milieu indifférent et même hostile où il vivait et remonter contre le courant aux véritables sources du beau. L’art grec était presque inconnu, la statuaire romaine de la décadence représentait l’antique, et le grand art du 16ème siècle, tombé dans l’oubli, n’exerçait plus d’influence. Quoiqu’il fût élève de David et qu’il eût un profond respect pour les sérieuses qualités de ce maître, Ingres avait son autel secret, son Dieu particulier pour lequel il réservait l’encens. Comme ces fakirs de l’Inde qui se dévouent par un tatouage sacré au culte d’une idole, il portait en l’honneur de Raphaël les cheveux séparés sur le milieu de la tête, et jusqu’au dernier jour, superstition fidèle et touchante, on a pu voir cette raie au front du vieillard. Si nous racontons ce détail en apparence puéril, c’est qu’il peint l’homme tout entier. Jamais existence ne fut plus une, plus constante à soi-même d’un bout à l’autre, dans la lutte comme dans le triomphe.
Après quatre ans d’études acharnées, Ingres, en 1800, — il y a soixante-sept ans de cela, — obtient un second prix, et l’année suivante le premier. Le sujet du concours était » l’arrivée dans la tente d’Achille des ambassadeurs envoyés par Agamemnon pour fléchir la colère du fils de Pélée. » Dans ce tableau, qui n’est déjà plus celui d’un écolier, on peut pressentir l’originalité du maître. Une élégance grecque, une pureté antique de lignes, un style sobre et ferme, une volonté absolue dans l’exécution du moindre détail, distinguent cette toile des prix de Rome ordinaires. À partir de cette composition, toutes les œuvres de l’artiste se tiennent comme les anneaux d’une chaîne à or toujours du même titre et travaillés avec un soin exquis, un amour fervent et une conscience irréprochable. La vieillesse du grand maître n’a rien à répudier de sa jeunesse.
Cependant ce ne fut qu’en 1806 qu’Ingres put se rendre à Rome. Alors les événements faisaient quelquefois attendre les lauréats. La ville éternelle lui apparut comme une seconde patrie ; il en aima la grave tristesse, la solitude à peine troublée par le passage des étrangers, les ruines austères, les galeries silencieuses, les ruelles désertes laissant voir à leur extrémité quelque noble horizon digne du Poussin, et surtout cette absence d’agitation moderne, ce repos de ville morte où l’âme sans distraction peut suivre son rêve, où le travail que rien n’interrompt reprend chaque matin sa lutte contre l’idéal.
Que d’heures il passa dans les stanze et les chambres du Vatican en tête-à-tête avec son cher Raphaël, heureux comme un dévot qui verrait tous les jours son Dieu, étudiant, copiant, admirant, restant en extase pendant de longues journées bien courtes pour lui devant ces fresques divines, qui semblent en pâlissant remonter au ciel d’où elles sont venues, s’enivrant de leur beauté comme d’une coupe d’or pleine de nectar, et ne quittant le sanctuaire que lorsque les indécisions du crépuscule faisaient flotter sur les murailles comme des fantômes les figures sublimes de l’Urbinate !
C’est une rare faculté que celle d’admirer, elle élève l’âme presque jusqu’à la hauteur du génie adoré. Admirer, c’est aimer, c’est comprendre, et celui qui dès sa jeunesse ne s’est pas donné » un maître et un auteur « , comme dit Dante de Virgile, il est à craindre que la postérité ne l’admire pas à son tour. En suivant Raphaël, Ingres est devenu un maître illustre.
Il ne faudrait pas cependant croire qu’Ingres n’a fait que décalquer Raphaël ; on se tromperait étrangement. Raphaël, pour lui, représentait l’antique et la nature fondus dans la plus pure harmonie, le type de la beauté suprême, l’idéal réalisé, l’art grec baptisé par l’art italien, l’âme la plus céleste animant le corps le plus parfait. Il s’en est inspiré. Il en est l’adorateur, le prêtre, le disciple, mais non le copiste.
Le jeune pensionnaire de la Villa-Medici envoya de Rome une Odalisque, Œdipe et le Sphinx, Thétis suppliant Jupiter, et ces chefs-d’œuvre, nous le disons avec une sorte de honte pour notre pays, furent accueillis très froidement. On resta insensible à cette perfection de forme, à cette hauteur de style et à cette profonde originalité cachée sous la correction la plus sévère. On railla Œdipe et le Sphinx, ce pur bas-relief grec ; l’Odalisque, si belle pourtant, ne séduisit personne ; le Jupiter, non moins majestueux que le Jupiter d’Olympie de Phidias, la Thétis lui touchant la barbe avec un geste aussi noblement antique qu’un vers d’Homère, ne trouvèrent pas grâce devant les critiques de l’époque. Ingres, qu’on regarde aujourd’hui comme la norme et l’archétype du goût, fut traité de » gothique « , une grosse injure alors, et accusé de vouloir ramener l’art à la barbarie du seizième siècle ; nous citons textuellement. Ce seizième siècle si barbare est le siècle de Léon X, de Raphaël, de Michel-Ange, de Léonard de Vinci, de Titien. Les classiques ne montrèrent aucune sympathie pour Ingres, et ce n’est que bien plus tard et comme à regret qu’ils reconnurent son talent. Blessé dans sa susceptibilité d’artiste qu’il avait très vive, Ingres prolongea son séjour à Rome, où il se maria, en 1813. Comme Poussin, dégoûté de sa patrie, il semble vouloir devenir tout à fait Italien. Dans cette ville remplie de tableaux et de fresques, le goût, corrigé sans cesse par l’éternel enseignement des maîtres, restait encore capable, sinon de pratiquer, du moins de comprendre la grande peinture, et les toiles du jeune maître français ne semblaient ni ridicules ni barbares à des yeux qui avaient l’habitude des fresques du Vatican et des marbres antiques.
Cette époque fut la plus féconde de sa vie ; il ne faisait d’autre sacrifice aux nécessités de l’existence matérielle que de tracer à la mine de plomb, pour des prix que n’accepterait pas de nos jours l’artiste le plus obscur, des portraits qui sont de purs chefs-d’œuvre à mettre à côté des plus beaux dessins des grands maîtres. Divine candeur du génie, il appelait cela » faire du commerce « . Son crayon créait des loisirs à son pinceau, et, dans une retraite simple, modeste et digne, d’où l’ordre extrême chassait la pauvreté, mauvaise conseillère qui pousse aux concessions et aux œuvres hâtives, il poursuivait la perfection avec une ardeur infatigable, un enthousiasme toujours renaissant et une patience que rien ne rebutait. Au temps qu’il a mis à parfaire quelques-unes de ses œuvres, on a cru parmi le public qu’Ingres avait le travail difficile : c’est là une erreur. Il peignait avec une rapidité et une certitude étonnantes. Une figure de grandeur naturelle ne lui coûtait qu’une journée. » La facilité, si vous en avez pour cent francs, achetez-en pour mille » disait, par manière d’aphorisme, ce maître si sévère pour lui-même ; mais c’était à la condition de ne s’en servir que pour améliorer sans cesse l’œuvre et s’approcher de plus en plus du but idéal. Dès qu’il entrevoyait le mieux, le bien ne lui suffisait plus, et il abattait courageusement tout un grand morceau, changeait un groupe de place, ou donnait une inflexion nouvelle à une figure. Que d’admirables choses sacrifiées, à tort peut-être, à cette anhélation du beau, à cet essor toujours tendu vers les hautes régions de l’art !
Il peignit dans cette période, outre les tableaux que nous avons déjà cités : Romulus vainqueur d’Acron, grande fresque exécutée au palais Quirinal, le Tu Marcellus eris, popularisé par la belle gravure de Pradier, Raphaël et la Fornarina, le Pape Pie VII à la chapelle Sixtine, d’une chaude et forte couleur que ne désavouerait pas Titien, Angélique et Roger, délicieuse Andromède de la Renaissance, Paolo et Francesca de Rimini, charmante miniature gothique qu’on croirait arrachée d’un roman de chevalerie, Jésus remettant les clefs à saint Pierre, le plus beau tableau de sainteté des temps modernes. Toutes ces œuvres magistrales si variées et d’une originalité si visible cependant ne tiraient pas ce persévérant artiste de l’ombre où il végétait. Il aurait dû depuis longtemps être célèbre, et il était plus qu’inconnu, méconnu. Ses toiles envoyées au Salon passaient inaperçues ou soulevaient la raillerie. Par l’école académique, Ingres était considéré comme un esprit bizarre, un novateur, un sectaire secrètement entaché d’hérésie. On se défiait de lui et véritablement on n’avait pas tort : Ingres était, sans le savoir peut-être, le romantique de la ligne, comme Delacroix fut le romantique de la couleur. Pour retrouver la ligne perdue, Ingres remonta à Raphaël et aux Grecs, comme Delacroix, voulant renouveler la palette éteinte de l’école française, remonta à Paul Véronèse, à Titien et à Rubens. Le mouvement romantique fut un retour à la Renaissance, et les jeunes poëtes demandaient à Ronsard le secret des rythmes oubliés. De là cette répugnance et cette hostilité. En outre, Ingres se rattachait à l’école nouvelle par sa fidélité à la couleur locale de chaque sujet. Il recherchait le caractère du temps jusque dans le moindre détail ; il prenait le style de l’époque traitée, tour à tour grec, romain, oriental, gothique, et l’archaïsme le plus minutieux n’aurait su où le reprendre. Les classiques n’aiment pas la mise en scène ; ils se contentent, dans la tragédie comme dans la peinture, d’un portique vague et de personnages de convention vêtus de draperies de théâtre. Ils ont aussi un peu horreur de la nature, et Ingres les choquait par son profond sentiment de la réalité. Chose bizarre, mais qui se conçoit, les plus chauds partisans du maître contesté furent d’abord des romantiques.
De Rome, Ingres alla à Florence, où il resta quatre ans ; c’est là que M. Delécluse, son ancien camarade d’atelier chez David, le trouva, non pas abattu, mais triste, et sur le point d’abandonner le Vœu de Louis XIII, dont il avait déjà peint la sublime madone.
Ce tableau, d’une beauté si sérieuse, si noble, si raphaélesque, avec son admirable Vierge, ses grands anges d’un style fier et charmant, son Louis XIII si royalement drapé, sa couleur d’une gravité magistrale, produisit un grand effet. L’artiste, jusque-là dédaigné, reçut la croix d’honneur et fut nommé membre de l’Institut, grâce peut-être un peu à l’épouvante qu’inspirait la jeune école. On sentait le besoin de ne pas laisser hors du camp un pareil athlète.
À partir de ce jour, la lumière se posa sur Ingres et ne le quitta plus. La mort, hélas ! a transformé le rayon en auréole, et l’illustre vieillard peut maintenant, parmi les dieux de la peinture, poser ses pieds sur l’escabeau d’ivoire des apothéoses. C’est ainsi que la gloire récompense ceux qui n’aiment qu’elle et se dévouent à sa poursuite corps et âme. Dans ces jours de fatigue et de mélancolie que connaissent tous les artistes, on trouve parfois que le siècle est injuste, que les épreuves sont longues, qu’on a déjà bien travaillé en vain ; pour se guérir de ces langueurs, il suffit de penser à ces nobles luttes supportées si courageusement par le plus grand maître de notre temps.
L’Apothéose d’Homère date de 1827. Le père de la poésie antique, le sublime aveugle, couronné par la muse, ayant à ses pieds ses filles immortelles, l’Iliade et l’Odyssée, trône, dieu plus durable que les Olympiens, au centre d’une foule illustre, composée de tous ceux qui par la lyre, la plume, le ciseau, le pinceau ont rendu témoignage à l’idéal. Apelles conduit Raphaël par la main et semble le présenter à Homère. De l’autre main il pourrait guider Ingres, car jamais hommage plus splendide ne fut rendu au génie de l’antiquité, jamais plus pur autel ne fut élevé au beau.
Le Martyre de saint Symphorien, un chef-d’œuvre tel que Raphaël eût pu le produire après que son oncle Bramante lui eut ouvert secrètement les portes de la Sixtine, souleva de violents orages. Ces énergiques musculatures à la Michel-Ange étonnaient une époque déshabituée du nu et des sévérités du grand art. Et cependant, quelle ardeur de foi, quel enivrement céleste, quelle volupté du martyre exprime la tête du jeune saint ! quelle puissance de geste, quelle projection de volonté dans la femme qui se penche hors des créneaux pour l’encourager ! Maintenant une admiration unanime s’agenouille devant l’œuvre sublime, et l’on ne comprend pas qu’elle ait pu être contestée.
Ingres dévoué à son idéal, entier dans sa conviction, s’irritait facilement de la critique, et ce tumulte autour de son œuvre, cette poussière soulevée de bataille l’importunaient. Après avoir exposé les portraits du comte Molé et de M. Bertin de Vaux, deux merveilles, il se retira des salons et retourna à Rome, mais cette fois comme directeur de la Villa-Medici. Il exerça une grande influence par son exemple, son autorité, sa parole éloquente, son enthousiasme toujours sur le trépied, sa puissance à réunir les groupes autour de lui, et aussi par sa bonté de cœur, sa cordialité paternelle et sa protection attentive. Ses élèves lui étaient comme une famille ; il s’en faisait adorer et craindre, et il a créé des fanatismes qui durent encore. Tous ne parlent de lui que les larmes aux yeux. L’art avait en lui un prêtre et un apôtre. Il le servait et l’enseignait, et son expérience se résumait en formules brèves, imagées et profondes que nous voudrions voir recueillies avant que la mémoire ne s’en perde. Hippolyte et Paul Flandrin, Amaury-Duval, Ziegler, Chassériau, les frères Balze, ont été ses plus chers disciples. Combien de ceux-là ont devancé leur maître dans la tombe !
Pendant son séjour à Rome, Ingres peignit la Vierge à l’hostie, l’Odalisque avec son esclave et cette inoubliable Stratonice, qui s’avance comme un rêve de beauté vers le lit du jeune malade d’amour dans ce merveilleux intérieur antique que sa présence illumine.
Son retour à Paris fut un triomphe auquel, de même qu’aux triomphes romains, ne manquaient même pas quelques voix isolées d’insulteurs, perdues dans l’acclamation générale.
L’exposition universelle de 1855 consacra sa gloire. On vit dans une salle réservée à lui seul, et transformée en sanctuaire du grand art, presque tout son œuvre réuni. Parmi les toiles déjà connues brillait un chef-d’œuvre nouveau, cette Vénus Anadyomène, la tête dans l’azur, les pieds dans l’écume, d’une nudité si chaste et si pure, d’une beauté si parfaite, qu’Apelles l’aurait signée. On y revit aussi ce portrait de Mme de Vauçay qui semblait une Monna Lisa en costume de l’Empire, et ce magnifique Bertin l’aîné, où le plus haut style s’unit à la plus exacte vérité et fait de ce patricien de la bourgeoisie quelque chose d’auguste comme une effigie de César.
Une des grandes médailles fut décernée à l’auteur de tant de chefs-d’œuvre, et de commandeur il devint grand officier de la Légion d’honneur. Pour le récompenser de si lentes années d’épreuves, la vie lui devait une vieillesse saine, robuste et féconde ; il fallait qu’il eût le temps de se reposer dans une sérénité lumineuse et de garder quelque temps au front la couronne d’or que la gloire tardive y plaçait. Ce bonheur lui a été donné. Il a pu faire encore, avec tout le talent de ses plus beaux jours, l’Apothéose de Napoléon à l’Hôtel de Ville, le Jésus enfant parmi les docteurs, et la Source, cette merveille sans rivale, cet incomparable chef-d’œuvre, cette fleur de beauté, d’innocence et de jeunesse, s’entr’ouvrant à la vie et laissant tomber de son urne l’eau transparente où se reflètent ses pieds de marbre. Cette fille de la vieillesse du grand maître est aussi la plus belle.
La France, qui l’avait d’abord méconnu, a fait longtemps attendre Ingres ; mais elle a magnifiquement payé sa dette, et dans son regret il ne se mêle aucun remords. Sur le cercueil que suivait une foule immense, avec les décorations et les couronnes, un habit de sénateur était jeté. Aucun honneur n’avait manqué au vieux maître, qui emporte le grand art avec lui.
Le Moniteur universel, » Une préface. « , 2 mai 1867
C’est une fortune bien rare pour un catalogue que d’être précédé de quelques pages d’introduction arrachées à l’admiration d’un maître. Cette fortune, elle échoit au catalogue de la collection des études et tableaux peints par Ingres et qu’il désigna lui-même pour être mis en vente par M. Haro. Si cette brochure ne se recommandait pas assez à la curiosité des artistes par le choix des tableaux de l’illustre chef d’école, la préface de M. Théophile Gautier la ferait rechercher, et la rendrait précieuse comme un volume rare.
Mais nous ne voulons pas laisser aux seuls collectionneurs de catalogues le privilège de connaître et de savourer un morceau littéraire dû à notre grand critique. Cette œuvre, comme ses autres appréciations artistiques, doit appartenir à tous nos lecteurs.
Quand la mort vient mettre sur un grand maître sa consécration suprême, on se dispute avec une avidité pieuse les moindres ébauches de son pinceau, les traits les plus légers de son crayon, tombés d’une main immobilisée à jamais. L’œuvre est close, la postérité commence. Pour M. Ingres, quoiqu’il ait travaillé jusqu’au dernier jour, il semble entré depuis longtemps dans la sphère sereine et lumineuse où trônent les dieux de l’art. Sa vie prolongée au-delà des bornes ordinaires lui a permis d’assister vivant à sa gloire, on pourrait même dire sans exagération à son apothéose. Mais cette renommée sans rivale ne l’enivrait pas. Dans son ardent amour de la perfection, il ne croyait jamais avoir assez fait, il étudiait sans cesse, était sévère pour lui-même et prenait un soin extrême de ne rien laisser arriver au public qui ne fût digne de lui. Sans que rien l’avertît d’une fin qu’on pouvait croire lointaine encore, tant il portait robustement sa verte vieillesse, il avait classé, daté et signé de son nom tout entier, parmi les études dessinées ou peintes, préparations et tâtonnements souvent sublimes de ses œuvres immortelles, celles qui par leur jet, leur puissance et leur beauté lui paraissaient mériter de suivre. Quatre-vingt-dix morceaux de choix ont été ainsi désignés par lui et comme marqués de son sceau pour une vente qu’il ne croyait pas devoir être posthume. Il lui eût déplu que ces griffonnages vagues ou insignifiants dans lesquels l’artiste cherche à débrouiller sa pensée obscure sortissent de l’ombre de l’atelier où ils doivent rester, car il poussait jusqu’au scrupule le respect de sa gloire ; mais d’un autre côté il désirait faire voir avec quel soin, quelle conscience et quel amour il avait poursuivi le beau et comme chez lui chaque grande œuvre avait été précédée d’une patiente et féconde incubation.
Dans cette vente on peut dire que les œuvres les plus célèbres du maître se trouvent tout entières : le Vœu de louis XIII, l’Apothéose d’Homère, le Saint Symphorien, y figurent par fragments qui, s’ils étaient réunis, formeraient des tableaux non moins admirables que les compositions définitives. En voyant ces têtes, ces bras, ces mains, ces pieds, ces torses, ces bouts de draperies épars sur des toiles, nous ne pouvons nous empêcher de penser à une impression reçue par nous à Athènes, dans cette pinacothèque qui s’élève à la gauche des Propylées et où se conservaient autrefois les chefs-d’œuvre d’Euphranor, d’Apelles, de Parrhasius et de Xeuxis. On y avait réuni les morceaux de statues brisées trouvés dans les fouilles, débris merveilleux de l’art grec, un bras, un pied, une tête sans son corps, un fragment de corps décapité, moins que cela, un sein se dégageant de quelques plis, une hanche, une portion de dos, et, rêveur, nous cherchions à deviner quel dieu ou quelle déesse aurait pu réclamer ces membres dispersés, ces formes superbes séparées de leur ensemble. Mais si la sensation de beauté n’est pas moindre devant les magnifiques morceaux de M. Ingres, elle n’est pas troublée par le regret d’ignorer à quelles divines statues appartiennent ces splendides fragments. Sur le plus léger bout d’étude en restitue aisément le chef-d’œuvre connu et présent à toutes les mémoires. Ces jambes d’ange, quoique dans le tableau elles soient à demi recouvertes par une draperie volante, rappellent tout de suite le Vœu de Louis XIII ; l’on y remplace sans peine ces petits anges d’un dessin si pur, d’une couleur splendide. Ces pieds appuyés sur un escabeau, c’est tout l’Homère de l’Apothéose, et ces deux autres pieds si beaux, si nobles, si héroïques, qui sortent blancs d’un pli de draperie de pourpre, font apparaître complète à la pensée la sublime figure de l’Iliade, cette fille divine de l’illustre aveugle. Ce dos de licteur tout montueux de muscles, cette tête pâle illuminée de foi, ce bras de femme jaillissant hors des créneaux, vous donnent tout l’effet du Saint Symphorien.
On reste stupéfait devant ces études qui sont des chefs-d’œuvre empreints de la perfection suprême. On est étonné de cette netteté, de cette puissance, de cette certitude et de cette aisance souveraines. En face de la nature, le maître n’hésite jamais. Chaque trait marque, tout coup porte, et s’il reprend vingt fois la même figure, dans son incessante aspiration à l’idéal, variant le geste, l’effet, l’attitude, le caractère, chaque étude en soi est parfaite et l’on se demande quel défaut pouvait y trouver le maître pour chercher encore.
Les études dessinées ne sont pas moins admirables que les études peintes. L’artiste armé du crayon écrit sa pensée avec une décision et un style qu’on pourra peut-être atteindre, mais non certes dépasser. On croit voir tantôt des dessins de Michel-Ange, tantôt des dessins de Raphaël, car Ingres avait la force et la grâce. S’il indique avec une rare énergie les muscles de l’homme, nul ne caresse plus chastement les suaves contours de la femme. Il est le dernier moderne qui ait eu le pur sentiment de la beauté ; il sait faire une vierge, une déesse et une grande dame.
Ces morceaux qui se groupent par familles autour d’une page immortelle, le peintre ne s’en est jamais séparé ; ils ont été les compagnons de sa longue vie, ils l’ont suivi à Rome, à Florence, ils ont habité avec lui à Paris. En les regardant, Ingres voyait lui apparaître toute sa noble vie de travail, d’inspiration et de volonté ; il ne se sentait pas abandonné par les figures aimées, réalisation de son idéal. Dans son atelier vivaient toujours la Vierge fière du Vœu de Louis XIII, l’Homère de l’Apothéose ayant à ses pieds l’Iliade et l’Odyssée, sa fille guerrière et sa fille voyageuse, et toute cette noble foule qui lui rend hommage, Eschyle, Sophocle, Euripide, Phidias, Apelles, Alexandre, Pindare, Périclès, Virgile, Dante, Raphaël, Michel-Ange, Racine, Poussin, La Fontaine, les illustres des grands siècles. Il les a gardés avec un soin jaloux jusqu’à sa dernière heure. En les livrant au public il fait en quelque sorte la confession et le testament du génie ; il dévoile sa pensée intime, il montre le secret de son talent, et fait voir par quels degrés il s’est élevé aux sommets de l’art. Le maître qui a formé tant de glorieux élèves et dirigé d’une main si ferme l’École de France à Rome, donne là son plus bel et son plus profitable enseignement.
Parmi ces études on remarque un tableau achevé, une Angélique, première pensée de la célèbre Angélique du Luxembourg, étude peinte d’après nature, d’une beauté merveilleuse ; sa Vénus couchée de la Tribune — Titien copié par Ingres — et un dessin d’après un portrait d’Holbein représentant Marie Tudor. C’est ce dessin qui provoqua chez l’artiste cette humble et fière répartie. On le voyait passer de grand matin, son portefeuille sous le bras, se rendant à l’endroit où se trouvait le tableau, et on lui demanda pourquoi il se donnait cette peine ; il répondit : » Pour apprendre. » Il parlait ainsi à quatre-vingt-cinq ans, lui que tous reconnaissent pour maître ; mais, comme dit Joubert, » adressez-vous aux jeunes gens, ils savent tout. »
Le Moniteur universel, « Collection Khalil-Bey », 14 décembre 1867
Cette galerie n’est pas nombreuse — cent tableaux tout au plus ! — mais elle est choisie, et, dans cet écrin de peintures, on ne rencontre, parmi les pierres précieuses, ni strass ni perles fausses. Chaque artiste y est représenté par un de ses plus purs diamants. Un goût sûr, un tact parfait, une passion sincère du beau, ont guidé le possesseur de cette rare collection, la première qu’ait formé un enfant de l’Islam. Le respect des chefs-d’œuvre anciens s’y allie à l’amour des chefs-d’œuvre modernes, et le culte du passé n’y fait aucun tort à l’admiration du présent. Les maîtres du jour y coudoient les maîtres de jadis, et l’on sent que dans l’équitable avenir ils seront égaux à leurs aïeux, de cette égalité diverse du génie qui admet tous les contrastes. À ce cabinet, un musée pourrait emprunter avec certitude des morceaux qui ne craindraient aucune rivalité.
Nous commençons par les modernes. Pas un des noms illustres de notre école ne manque à la liste. Ingres, le peintre des odalisques, celui qui de nos jours possédait le mieux, malgré la sévérité de son talent austère, le sentiment de l’élégance féminine, se présente avec son Bain turc, qui est là bien à sa place, — un merveilleux prétexte à grouper sans voile, dans un cadre circulaire, toutes les variétés de types que le harem envoie à ce rendez-vous de la coquetterie orientale. Le grand artiste a dessiné ces beaux corps dans toutes les attitudes favorables à leurs charmes, de dos, de face, de profil, en raccourci, debout, couchés, hanchant de façon à faire ressortir une ligne opulente, montrant leur nuque où s’enroule un léger turban et leurs épaules moites de la sueur du bain ; mêlant le marbre de la déesse antique à la chair de la sultane, sous une pâleur rosée qu’estompe la vapeur argentée de l’étuve. De quelques-unes de ces figures, détachées du cadre, il a fait des tableaux, et l’on reconnaît l’odalisque vue de dos dans cette femme du premier plan, d’une lumière si pure, d’un modelé si souple et d’une beauté si parfaite. Il semble que ce tableau soit l’album où le peintre ait fixé, à diverses époques, ses rêves de beauté, ses trouvailles de poses, ses prédilections de formes et jusqu’à ses caprices de types. Quelle admirable figure que celle de la femme grecque à cheveux blonds qui, adossée à la muraille, les bras croisés sous le sein, poursuit à travers la langueur d’une demi-somnolence quelque souvenir mélancolique du temps où elle était libre, mettant pour ainsi dire une âme parmi ces beautés purement corporelles ! C’est une page importante et singulière de l’œuvre d’Ingres, une toile amoureusement caressée de son plus suave pinceau, vingt fois quittée et reprise, comme une femme avec laquelle on ne peut se décider à rompre, une sorte de harem qu’il n’a congédié qu’à la fin de sa vie et dans lequel il venait de temps en temps prendre une odalisque ou une nymphe.
Un autre morceau d’un grand intérêt est une copie d’après la Vénus de la tribune de Florence, de la même dimension que l’original : Ingres copiant Titien, ce grand maître de la couleur avec cette révérence et cette piété qu’il a toujours professées à l’endroit des chefs-d’œuvre. Ingres, a-t-on dit, n’aimait pas la couleur ; la couleur de Rubens peut-être, mais celle de Titien superposée à une admirable forme et enveloppant la beauté comme d’une atmosphère d’or, il la goûtait sans doute et il en cherchait le secret à travers la patine du temps. Cette magnifique copie, qui pour nous vaut le modèle, le prouve sans réplique. Quel curieux sujet d’étude et de méditation pour les artistes que cette superbe Vénus, qu’Ingres, malgré la scrupuleuse fidélité d’imitation, n’a pu s’empêcher de faire plus fine de dessin et moins chaude de ton que celle du Titien, faisant prévaloir à son insu la déesse sur la femme et la beauté sur la vie, et restant original, tout en étant copiste !
Gazette de Paris, « Notice sur la collection C*** », 25 avril 1872
Si l’on ne considérait que le nombre des tableaux qui figurent à cette vente, on serait tenté de la regarder comme peu importante, il ne s’élève qu’à trente-trois, une salle en est à peine remplie à moitié, mais jamais exposition publique n’aura plus vivement ému la curiosité. Pour faire cette collection on a écrémé les chefs-d’œuvre des cabinets des plus dédaigneux, trié les perles du plus bel orient, et choisi dans l’écrin même du maître le joyau caractéristique de son génie. Personne ne pourra se vanter d’avoir un Ingres, un Delacroix, un Corot, un Th. Rousseau, un Millet, et même un Courbet supérieur à ceux-là, fût-il prince, fût-il millionnaire, fût-il critique, ami du Titien comme l’Arétin.
La collection C. se distingue de toutes les autres par la perfection absolue des morceaux qu’elle renferme. Beaucoup d’appelés et peu d’élus. On n’a reculé devant aucun sacrifice pour enlever le tableau souhaité, et la vente achevée on sera frappé de l’énorme somme produite : c’est que le caprice, ici, ne guidait pas le choix mais bien l’amour du beau, du rare, de l’exquis.
Ab Jove principium : commençons par Jupiter, c’est-à-dire par Ingres, non qu’il y ait des grades dans l’immortalité et que nous ne puissions commencer aussi bien par Delacroix, mais Ingres sa rattache aux anciens dieux et à l’art antique ; il est une sorte d’hiérophante qui a appris les mystères de Phidias et de Raphaël, et l’admiration qu’il inspire est toujours mélangée d’un peu de crainte. Delacroix, quoiqu’il soit allé à son tour retrouver les grands artistes qui se pressent aux pieds d’Homère, nous semble moins hautain, moins inaccessible, plus pénétrable aux courants de la vie, plus participant encore au drame humain ; nous sommes respectueusement familiers avec lui, et nous lui faisons attendre son tour, sûr qu’il ne se fâchera pas.
Ingres, comme les artistes de la Renaissance, a eu au plus haut degré le sentiment de la beauté féminine à laquelle les peintres modernes, préoccupés du caractère, du drame et de la passion, sont moins accessibles. La plus belle forme de l’idéal a toujours été pour lui la femme, et avec quelle religion amoureuse en a-t-il poli le contour, avec quelle virginale pureté en a-t-il modelé les délicates proportions ! La sculpture grecque dans ses marbres les plus achevés n’a rien fait de supérieur à la grande Odalisque, à la Vénus Anadyomène, à la Source, à l’Angélique, cette même Angélique que le maître souverain a isolée et séparée du Roger à l’armure d’or pour que le regard pût admirer sans distraction cette beauté suprême qui luit comme un ivoire de Phidias sur le bleu sombre de la mer. De cette adorable figure il a fait comme un médaillon pour fermer le bracelet de Vénus. Avoir l’Angélique, c’est posséder tous les charmants types de femme rêvés par Ingres fondus en une seule perle.
Un inestimable trésor, qui est à la fois un chef-d’œuvre que l’antiquité envierait aux temps modernes, et le souvenir d’un chef-d’œuvre à jamais disparu sous les mains sacrilèges des incendiaires de la Commune, c’est l’Apothéose de Napoléon, copié à l’encre de Chine sous cette forme de camée qui semble sa forme naturelle, par Ingres lui-même, avec une fidélité magistrale. On eût dit que l’artiste, si confiant dans l’avenir, en était cette fois inquiet et prenait ses précautions contre lui en multipliant sa composition immortelle.
Ce désastre, un des plus grands qui aient épouvanté l’art, est en partie réparé par ce merveilleux dessin qui a fait un camée du plafond. Sa pensée et sa forme sont restées intactes, la couleur seule s’est évanouie comme une ombre légère.
Lorsque le cercle d’azur, de lumière et d’or qui couronnait la salle de l’Hôtel de ville où planait le char triomphal de l’Empereur s’effondra et croula dans le gouffre de flammes, les barbares secouant leurs torches poussèrent un hurlement sauvage ; ils crurent avoir tué un chef-d’œuvre, éteint une splendeur, supprimé une âme, substitué une laideur à une beauté. Quoi de plus doux pour des natures basses, féroces et stupides, pour des monstrueux calibans qui n’ont plus peur de Prospère ! Mais ils ne voyaient pas, en attisant le feu, les étincelles rejaillir par tourbillons jusqu’au ciel emportant la pensée qu’ils espéraient avoir anéantie.
Quand nous allâmes visiter l’Apothéose de Napoléon pour la première fois, après avoir longuement contemplé l’œuvre admirable, nous terminions notre compte rendu par ce vœu timide : » Pour lui assurer l’éternité relative dont l’homme dispose, nous voudrions voir cette magnifique composition gravée sur une grande agate comme l’Apothéose d’Auguste du trésor de la Sainte Chapelle. Le camée moderne ne craindrait pas la comparaison avec le camée antique. «
À côté du dessin d’Ingres le camée antique n’aurait qu’à bien se tenir. Il lutterait à grand’peine contre ce style, cette noblesse, cette simplicité et cette perfection. Aucune roue de graveur en pierre fine ne vaut ce crayon ou ce pinceau. Heureuse la collection qui, avec l’Angélique a possédé, fût-ce un moment, ce camée à l’encre de Chine plus précieux mille fois que s’il était taillé dans l’agate, la sardoine ou l’onyx.
Un des plus célèbres, sinon le plus célèbre tableau de chevalet d’Eugène Delacroix : Le Tasse dans la prison des fous, tient avec l’Angélique la tête de cette collection si remarquable. Le Tasse a appartenu à Alexandre Dumas père et fils ; à Khalil-Bey qui, pour un Turc auquel sa religion défendait les objets d’art comme des idoles, s’y connaissait assez bien en tableaux.
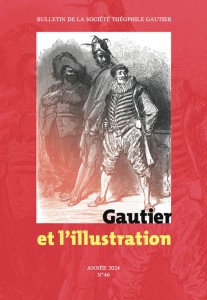

 Envoyer cette page à un ami.
Envoyer cette page à un ami.
